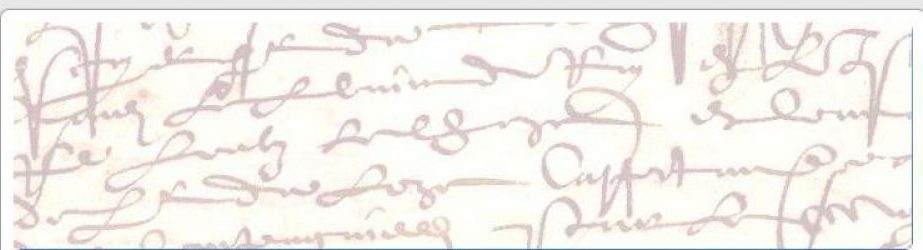Cette chanson de geste, long, très long poème à la gloire d’Olivier de Clisson et sa femme Jeanne de Bellevile, écrit par Emile Péhant, est numérisé sur GALLICA, et j’ai seulement remis en forme le texte après avoir corrigé les quelques erreurs de texte de la machine.
tome 1
ÉMILE PÉHANT
CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUÉ PUBLIQUE DE NANTES
CHANSON DE GESTE En plusieurs poëmes distincts
V. Forest et Grimaud (Nantes) A. Aubry (Paris)
1868
Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, YE-29702
OLIVIER DE CLISSON
CHANSON DE GESTE, EN PLUSIEURS POEMES DISTINCTS
Pour constater le succès de Jeanne de Belleville nous pourrions énumérer de précieux suffrages, dont plusieurs émanent des plus grands noms de la littérature contemporaine. Nous nous bornerons à détacher, des vingt pages consacrées à l’étude de ce poëme dans une des plus importantes revues parisiennes, par Victor de Laprade, l’immortel auteur de Pernette, les quelques lignes suivantes, en y supprimant à dessein les expressions qui pourraient paraître trop élogieuses :
« M. Émile Péhant a entrepris de faire revivre l’époque la plus glorieuse de la Bretagne, dans un tableau complet, auquel la vie du connétable Olivier de Clisson servira de cadre. Le premier poëme de ce cycle, Jeanne de Belleville, a paru l’été dernier… et sept poëmes pareils… nous sont promis. Voilà certes une héroïque entreprise et qui dénote bien l’audace et l’obstination bretonnes ! On ne croirait pas à une tentative semblable en 1869, si on ne la voyait sous ses yeux en partie réalisée, avec un talent égal à cette vaillance… L’Auteur a composé son poëme comme une chronique, en s’écartant le moins possible de l’histoire ; il a demandé la poésie aux faits eux-mêmes, à la peinture des caractères et des émotions, à ces deux sources éternelles de l’épopée : les événements vrais et le cœur humain… L’art du poëte, et il est très grand, c’est d’avoir développé l’élément dramatique de chaque situation, d’avoir introduit dans son récit la peinture des lieux, des moeurs, et tous les détails ressortant de l’action qui pouvaient animer les portraits de ses personnages… Saluons dans M. Émile Péhant un des poètes, qui avaient ému notre jeunesse, et qui reparaît après trente ans, avec une œuvre des plus considérables entre les œuvres poétiques de nos jours, un poëte qui va prendre place, dans cette noble pléiade bretonne, immédiatement après notre cher Brizeux… M. Émile Péhant n’atteint pas à cette perfection de la ciselure, qu’on admire chez ce Celte nourrisson d’Athènes et de Florence ; mais, comme l’épopée le comporte, il peint à fresque, et ses pages sont vivantes, pleines de mouvement et de couleur, etc. »
De Jeanne la Flamme, les éditeurs n’ont rien à dire, si ce n’est que, dans sa réalité rigoureusement historique, ce poëme offrira comme Jeanne de Belleville, tout l’attrait du roman le plus accidenté, sans jamais froisser les susceptibilités morales les plus ombrageuses. Les lecteurs y trouveront l’écho vivant des alternatives de joie et de désespoir qui ont assailli leur âme dans cette guerre néfaste de 1870.
Table des matières
AVANT-PROPOS. 4
PREMIÈRE PARTIE 6
L’ATTENTE 6
I- LE DONJON DE CLISSON 6
II. – LES ANCÊTRES. 9
III. – LE VIEIL HERBLAIN. 14
IV. – LA CALOMNIE. 16
V. – UN PRÉSAGE. 19
VI. -SOUVENIRS. 20
VII. – LA FÊTE DU RETOUR. 23
VIII. – LA VIE DE CHATEAU 27
IX- UNE LEÇON DE LOYAUTÉ. 28
X. – UNE LEÇON DE JUSTICE. 32
XI. – LA CULTURE D’UNE AME. 36
XIIN – LE TOURNOI. 37
DEUXIÈME PARTIE 39
LE SUPPLICE 39
I-LA PLACE DU GRAND-CHATELET. 39
II. – L’ACCUSATION. 41
III. – LA DÉFENSE. 44
IV. – LA CONDAMNATION. 48
V. – LA DÉGRADATION. 52
VI. – UN OURAGAN. 55
VII. – UN RAYON DE SOLEIL. 57
VIII. – LE PSAUME DES MALÉDICTIONS. 59
IX. – UNE ARME A DEUX TRANCHANTS. 62
X. – LE BAIN D’IGNOMINIE. 65
XIN – LA CIVIÈRE. 67
XII. – LES DERNIÈRES PRIÈRES. 69
XIII. – LA GRACE. 71
XIV. – LES CHAMPEAUX. 73
XV. – MONTFAUCON. 77
TROISIÈME PARTIE 78
LE RETOUR D’HERBLAIN 78
I- LA FÊTE DE FAMILLE. 78
II. – L’UNIQUE VŒU D’UNE MÈRE. 81
III. – LES EFFUSIONS D’UN CŒUR HEUREUX. 83
IV. – UNE LEÇON DE CHEVALERIE. 86
V. – LE BOURREAU DE NANTES. 89
VJ. – LA FUITE D’HERBLAIN. 91
VII. – LE RATEAU DE L’ERDRE. 93
VIII. – LES PONTS DE NANTES. 95
IX.- L’AUBERGE DU GRAND LION D’ARGENT. 99
X. – LE COMPLOT. 102
XI. – L’AUBERGISTE PRÉVOYANT. 105
XII. – UN DOULOUREUX MONOLOGUE. 106
XIII. – COMPLIMENTS ET BOUQUETS. 109
XIV. – HERBLAIN ET JEANNE. 113
XV. – LE RÉCIT D’HERBLAIN. 115
XVI. – LE DÉFI. 118
AVANT-PROPOS.
Pour oser publier en plein dix-neuvième siècle, au milieu d’un été asphyxiant et dans une ville de province ! un poème de huit mille et quelques cents vers, il faut être de cette vieille race celtique, que rien n’effraie, que rien ne décourage dès qu’elle a devant elle un noble but.
Eh bien! ce long poëme n’est qu’une sorte de prologue. Pour peu qu’il agrée à ce public spécial et choisi dont il envie les seuls suffrages, d’autres poèmes le suivront, à de courts intervalles : en quel nombre ? je ne sais, mais aussi nombreux qu’il le faudra pour exécuter. dans son entier, le plan que m’ont imposé les Muses, en répondant à mon appel après trente ans de bouderie et de silence.
Ce plan est simple, mais ne manque pas de grandeur.
Ma tâche est de retracer de ma vieille Bretagne, à l’époque la plus splendide de sa glorieuse histoire, un tableau complet, auquel la vie du connétable Olivier de Clisson servira de cadre.
Dans ces poëmes, indépendants les uns des autres, et qui pourtant formeront un ensemble plein d’unité, on ne fera ni de la chronique ni de l’épopée. On essaiera de glisser entre ces deux écueils, et, repoussant du pied cette friperie du moyen âge, heureusement passée de mode, on veut que les personnages revivent dans leur caractère plutôt que dans leur costume, dans leurs sentiments et leurs aspirations, plus encore que dans leurs actions réelles.
Il ne faudra pas à l’Auteur de grands efforts d’imagination, pour voir se dessiner dans son cerveau et se mouvoir dans son œuvre des héros que lui eussent enviés et Tasse, et Camoëns, et toute la phalange des poètes qui ont demandé leur inspiration à l’Histoire. Quels noms éblouissants ! Parmi les hommes, Du Guesclin, les trois Clisson, Beaumanoir, les deux Montfort, Charles de Blois, Gautier de Mauny, Jean
Chandos, Pierre de Craon, Louis d’Espagne ! Et sur l’arrière-plan, Edouard III, le Prince Noir, Philippe de Valois,Jean le Bon, Charles le Mauvais, et Charles V le Sage, et Charles VI l’Insensé ! Et parmi les femmes, Jeanne de Penthièvre, Jeanne la Flamme, Jeanne de Belleville, Marguerite de Clisson ! Toutes les nuances, toutes les couleurs !
Les actes valent les personnes : à chaque pas, des événements si grandioses, si merveilleux, si émouvants, que nos romanciers les plus hardis n’oseraient les inventer.
L’histoire que nous racontons aujourd hui au public lui donnera l’idée des trésors de poésie qu offrirait à une main plus forte ou plus expérimentée cette riche mine historique, jusqu’à présent laissée en oubli.
Malgré quelques longueurs, nous ne pensons pas que l’intérêt et l’émotiun fassent défaut à notre récit ; mais comme il a été écrit de verve et presque au courant de la plume, dans les rares loisirs dont il nous est permis de disposer, la versification en reste malheureusement entachée de nombreuses négligences : des oh ! des mais, des c’est que beaucoup trop fréquents, des rimes qui se répètent, des hémistiches qui se ressemblent, le Et bibIique trop souvent employé peut-être, et bien d’autres incorrections que nul ne signalerait mieux que nous.
Qu’importe ? Si la vie circule dans l’oeuvre, il sera facile d’en faire disparaître plus tard toutes ces bavures d’unc fonte trop hâtive. Si, au contraire, l’oeuvre manquée est destinée à un prochain oubli, à quoi bon perdre notre temps à des retouches sans profit pour personne ?
Quand une maison, quoique nouvellement construite, est menacée d’un arrêté de démolition, bien fou qui s’aviserait d’en gratter les tuffeaux, d’en ciseler les sculptures. Si le public ne prononce pas contre notre poëme une sentence de mort, oh ! alors, mais seulement alors, nous le polirons sans cesse et le repolirons, puisque Boileau l’exige. Pas trop cependant ; quelque peu de mousse ne messied pas aux troncs rugueux des chênes.
En parlant à nos juges de la précipitation avec laquelle cette composition a été conçue et écrite, nous ne songeons pas à solliciter leur indulgence. Pour les délits littéraires, il n’existe pas de circonstances atténuantes, et cette fois BOILEAU a raison :
« Il n’est point de degrés du médiocre au pire »
Pourtant, il ne nous paraît pas inutile de donner, avant l’arrêt rendu, quelques explications, qui peuvent en modifier, sinon le fond, au moins les considérants.
On ne doit juger un écrivain qu’en se plaçant à son point de vue et selon ce qu’il a voulu faire. Or, ceci n’est point un poëme épique ; qu’on ne lui oppose donc pas les règles de l’épopée, si tant est que chaque forme de poésie ait des règles uniformes et constantes. Nous avons voulu faire quelque chose d’intermédiaire entre le drame et l’épopée : le titre de DRAME ÉPIQUE aurait donc bien rendu notre pensée ; mais nous avons craint que le public ne crût avoir affaire à l’une de ces pièces avortées qui, après avoir frappé en vain à la porte de dix théâtres, viennent demander à l’impression un piédestal et n’y trouvent le plus souvent qu’un tombeau.
Quant au style de ce trop long poème, nous n’avons le droit d’en rien dire, sinon que nous avons essayé d’en changer le ton chaque fois que changeaient les situations ou les personnages ; mais qu’en tout cas et de parti pris, nous en avons partout écarté la métaphore. C’est peut-être tenter de peindre sans couleurs ; que voulez-vous ? nous restons fidèle à notre opinion de 1834, que, sauf pour la poésie lyrique, qui doit revêtir toutes les magnificences du langage, le mot le plus simple et le plus naturel est encore celui qui traduit le mieux l’idée, même la plus sublime.
Absorbé depuis longues années par mille occupations prétendues sérieuses, nous avons eu cette heureuse chance de n’avoir jamais lu un seul livre d’esthétique ; les questions d’écoles et de modes ne nous ont donc pas troublé l’esprit. Nous ne nous en préoccupons même pas.
La forme ! la forme! personne n’en admire plus que nous et n’en savoure mieux les délicatesses ; mais il y a en réalité des milliers de formes, et chaque œuvre doit avoir la sienne. Une toilette tirée à quatre épingles n’eût guère convenu à notre drame farouche et sanglant.
Avouons, toutefois, que l’art, nous dirions presque l’artifice, n’y manque pas autant que nous voudrions le faire croire ; certaine expression n’a été éteinte que pour en faire briller une autre ; telle platitude a été étudiée avec soin et n’a d’autre but que de faire mieux saillir quelque relief.
C’est que tout homme qui prend une plume ou un pinceau, est bien forcé d’avoir devant lui une philosophie de l’art, qui l’éclaire et le guide. Ne connaissant pas les systèmes que nos devanciers et nos maîtres sont censés avoir suivis, nous en avons créé un à notre usage, et, nous aussi, nous avons maximé notre pratique. Deux mots expliqueront complétement notre système. Ayant une égale horreur des chevilles et des fioritures, nous nous sommes imposé pour idéal la sobriété limpide de la prose, unie à la fermeté harmonieuse du vers.
Si cette ébauche, plutôt brossée que peinte, était ce que nous avions révé la faire, nous comparerions volontiers la poésie narrative, telle que mais l’avons comprise, à l’infanterie française en marche sur une terre étrangère et ennemie. L’uniforme de nos soldats pris isolément n’a rien peut-être qui séduise le regard, et nous ne poussons pas le patriotisme jusqu’à voir dans chacun de nos fantassins des Hercule ou des Antinoüs.
Mais que le tambour batte, que le clairon sonne qu’il faille emporter d’assaut une position difficile cette masse un peu terne, un peu confuse, où vous remarquiez à regret quelques traînards, voyez comme elle s’anime et combien vite le courant électrique l’a pénétrée tout entière. Tout cela prend le pas, tout cela court, tout cela vole, et le lecteur surpris et subjugué applaudit lui-même à sa défaite, sans songer désormais aux critiques de détail qui tout à l’heure encore excitaient ses sourires, peut-être ses dédains.
PREMIÈRE PARTIE
L’ATTENTE
I- LE DONJON DE CLISSON
Une femme, un enfant sont seuls dans le donjon,
D’où le regard découvre un immense horizon.
La femme, l’œil humide et la joue amaigrie,
Brode d’un doigt distrait une tapisserie,
Où, comme en un tableau, revivent les exploits
Du glorieux époux dont son cœur a fait choix.
L’enfant, épanoui dans le bonheur de vivre,
Feuillette, en souriant, le vélin d’un gros livre,
Où la couleur et l’or, artistement mêlés,
Font flotter dans l’azur de beaux anges ailés.
Mais l’enfant rose et blond fait semblant de sourire ;
Épiant en secret sa mère qui soupire,
Son oblique regard suit ses émotions.
Soudain, levant des yeux tout pleins de questions :
— « Vous avez renvoyé, dit-il, mes gouvernantes
Et je surprends toujours votre œil tourné vers Nantes. »
-« J’ai besoin d’être seule, enfant, pour qu’à mes pleurs,
Nul ne devine ici mes secrètes douleurs. »
-« Mère, pourquoi pleurer ? Vous êtes châtelaine,
Bien riche, bien puissante, et notre cour est pleine
De soldats, dont les bras sauraient nous protéger,
Si les Montfort osaient jamais nous assiéger.
Voyez comme les murs sont épais et solides . »
-« Oui, ce chastel est fort et nos gens intrépides :
C’est une âme robuste en un corps vigoureux ;
Le péril, quel qu’il soit, n’a pas d’effroi pour eux.
Votre peur, Olivier, n’est donc qu’une chimère. »
-« Ma peur ! Je n’ai jamais connu la peur, ma mère.
Chaque fois que j’entends des récits de combats,
Je tressaille et voudrais me mêler aux soldats,
Pour essayer un peu comment coupe la hache
Que je tiens de mon père. Oh ! je ne suis pas lâche ! »
-« Votre père !. Olivier, vous tenez trop de lui :
En parlant de combats, votre regard a lui.
Oh ! je ne voudrais pas éteindre en ta jeune âme,
Cher fils, l’ardent foyer dont j’admire la flamme ;
Mais se battre toujours! Mais n’aimer que le sang!
Si grand que soit le cœur, reste-t-il innocent ?
Ah! quand donc verrons-nous la paix enfin renaître ? »
Et la femme, en pleurant, penchée à la fenêtre,
Fouillait de son regard le lointain horizon ;
Mais rien que la poussière ou l’aride gazon,
Un brouillard lumineux, aussi vague qu’un songe,
Et le chemin désert, qui tourne et qui s’allonge.
Si sur ce tableau vide ainsi son œil se tend,
Qu’est-ce donc, ô mon Dieu ! que cette femme attend ?
-« Vous ne m’avez pas dit, mère, pourquoi vos larmes ;
Car vous n’avez pas peur, n’est-ce pas ? de nos armes.
Quand mon père, entouré de ses soldats nombreux,
Couverts de fer, souvent tout noirs ou tout poudreux,
Apparaissait là-bas sur la route de Nantes,
Sans vous inquiéter de vos robes traînantes,
Vous descendiez en hâte et, le pont abaissé,
Au-devant des soldats marchant d’un pas pressé,
Vous passiez au travers de leurs rangs, sans rien craindre,
Et, d’ici, je voyais mon père vous étreindre. »
-« Tu ne sais pas le mal que tu me fais.
Tais-toi, Tais-toi, cher Olivier. » — « Oh! dites-moi pourquoi,
Mère, vous pleurez tant, et je saurai me taire. »
-« Pour toi, fils bien-aimé, je n’ai pas de mystère.
Mais me comprendras-tu ?. Je pleure sans raison. »
Et la femme toujours regardait l’horizon.
-« Mère, vous me cachez sans doute quelque chose.
Vous savez que jamais on ne pleure sans cause ;
Moi, quand je vais pleurer dans un coin, tout boudeur,
C’est quelque gros chagrin qui m’oppresse le cœur…
Et vous en avez un ! vous avez beau sourire.
Oh ! je t’embrasserai, si tu veux me le dire ! »
La mère l’embrassa cent fois et puis cent fois ;
Et son cœur débordait dans ses yeux, dans sa voix,
Pendant que, sur son sein pressant la tête blonde,
Elle accablait son fils des plus doux noms du monde.
Se faisant un remords de l’avoir tourmenté,
Sa douleur sembla fuir devant sa volonté :
L’enfant vit sur son front la gaîté reparaître ;
Mais un dernier regard consulta la fenêtre.
-« Mes chagrins, Olivier, n’étaient que de l’ennui ;
Ta voix les a chassés; je veux rire aujourd’hui.
Pour te remercier, je vais te dire un conte
De quelque méchant ogre ou de quelque beau comte. »
-« Pas de contes! Oh! non, vois-tu, je n’y crois pas ;
J’aime bien mieux du vrai ! Parle-moi de soldats.
Quand sous les grands ormeaux, le soir, je t’accompagne,
Tu m’as souvent promis la guerre de Bretagne ;
Ou bien, si ce su jet t’arrache encor des pleurs,
Car tu dis que de là viennent tous tes malheurs,
Parle-moi de ces preux qui, la croix à leur lance ,
Ont pour le saint Tombeau fait assaut de vaillance ;
On y vit, n’est-ce pas, des sires de Clisson ? »
Un humide regard plana sur l’horizon.
-« Vous êtes, mon enfant, issu de noble race :
Vos aïeux dans l’histoire ont tous laissé leur trace ;
Mais si je vous disais ce qu’ont fait vos aïeux,
Oh ! n’allez pas lever un front trop orgueilleux :
L’orgueil est un péché. » — « Je le sais bien, ma mère ;
Je ferai, si je peux, mieux qu’eux… sauf à me taire. »
Je ne sais si l’orgueil est toujours interdit,
Mais, si c’est un péché, la mère le commit ;
Car, perçant l’avenir, déjà son espérance
Courbe aux pieds de son fils la Bretagne et la France.
II. – LES ANCÊTRES.
-« Allons, beau chevalier, pourfendeur de géants,
Seyez-vous près de moi, grand homme de sept ans
La maison de Clisson, qu’éclaire tant de gloire,
Cache son origine aux lointains de l’Histoire ;
Mais vos pères brillaient parmi ces fiers Germains
Qui conquirent la Gaule asservie aux Romains.
Qu’ils aient accompagné Clovis ou Charlemagne,
Ils prirent pour leur part ces marches de Bretagne . »
« Les nommait-on déjà les sires de Clisson ? »
« Ce fut Guy qui porta le premier ce grand nom…
Mais chez les Francs vainqueurs, quand on fit le partage,
Chaque homme obtint un fief égal à son courage.
Votre premier aïeul dut verser bien du sang,
Car nul soldat ne fut plus riche, plus puissant ;
Ses serfs et ses vassaux se comptaient par centaines :
Ses fils purent choisir, dans ses nombreux domaines,
Les noms qu’il leur plaisait d’illustrer aux combats. »
« Peut-être bien qu’alors Clisson n’existait pas? »
« Ce nom est, en effet, tout récent dans nos fastes ,
Et nos puissantes tours, nos murailles si vastes
N’ont guère que cent ans; mais sous notre manoir
Se cache un vieux chastel que le temps faisait noir.
» Les grands monuments seuls font les grandes ruines :
Aux débris imposants qui couvrent nos collines,
On devine quels forts, ici même, autrefois
Bâtirent les Romains, peut-être les Gaulois. »
-« Mais qui donc a détruit tant de choses si grandes ? »
-« Ne te souviens-tu plus de ces hordes normandes
Dont ma voix si souvent t’a fait de longs discours ? »
-« Si bien, mais vos récits m’ont toujours semblé courts. »
-« Pour en entendre encor, voilà que tu me flattes. »
-« S’ils se laissaient ainsi piller par des pirates,
Les hommes de ce-temps n’avaient donc pas de cœur ?
Si père eût été là, père eût été vainqueur,
N’est-ce pas, ô ma mère ? Et moi, pour te défendre,
Comme, la hache au poing, j’aurais su les pourfendre!
Leur sang aurait coulé partout en longs ruisseaux…
Je ris, en les voyant s’enfuir sur leurs bateaux. »
-« C’est beau, cher Olivier, c’est bien beau, le courage ;
Mais prends garde, ô mon fils, d’aller jusqu’à la rage .
Il ne faut pas verser le sang comme de l’eau :
Le manque de pitié ne convient qu’au bourreau. »
-« O ma mère, excusez l’ardeur où je me livre.
Est-ce ma faute à moi si la gloire m’enivre ?
Tuer ses ennemis, c’est l’honneur des soldats !
Peut-être, quand j’aurai connu de vrais combats,
Quand j’aurai bien fait voir que je suis bien sans crainte,
Des vaincus, des blessés j’écouterai la plainte :
En souvenir de toi, je leur tendrai la main ;
Mais je dois être brave avant que d’être humain. »
D’une telle fierté brillait son beau visage,
Que sa mère n’osa le gronder davantage :
— « Ils sont donc tous ainsi, ces barons de Clisson !
Dit-elle, en regardant tristement l’horizon.
Et rien, rien sur la route où ma vue est tournée !
Il faudra donc encor perdre cette journée.
Mais le temps aujourd’hui, non plus, ne marche point :
Le soleil est toujours, toujours au même point. »
-« Je t’en prie, ô ma mère, achève ton histoire.
Quels Clisson après Guy se sont couverts de gloire ?
Mais dis-moi donc pourquoi tous ces héros bretons,
S’ils étaient si puissants, sont-ils restés barons :
A leur place, j’aurais, moi, conquis un royaume. »
-« Baudry, Geoffroy, Gaudin, Aimeric et Guillaume
Brillèrent après Guy ; mais, de tous tes aïeux.
L’un des plus renommés fut Guillaume le Vieux.
Il était riche et beau, fier et plein de vaillance ;
Eudon de Pont-Château, pour sa fille Constance ,
Dans son château de Blain, le choisit pour époux,
Et c’est de leurs amours que vous descendez tous. »
Et la femme plongea son regard sur la route.
-« Mère, continuez; voyez comme j’écoute. »
-« Un jour, m’a dit ton père, un jour près des remparts
Guillaume promenait le grand Guy de Thouars ,
Qui, du chef de sa fille, était duc de Bretagne :
—Comment, duc, trouvez-vous ma petite campagne?
-Vous êtes assez riche et je vous fais baron.
-Baron ! Vrai ! Monseigneur ? Oh! vous êtes trop bon !
Personne ne dira cette grâce usurpée,
Car mes pères l’étaient du droit de leur épée,
Et ce droit en mes mains n’est pas tombé caduc :
Nous étions donc barons, que vous n’étiez pas duc. »
-« Oh ! la belle réponse, et comme elle était fière !
Je donnerais mes jours… Oh ! non, ma bonne mère,
Pas mes jours; mais, vois-tu, pour avoir dit cela,
Bien sûr, je donnerais le château que voilà :
Avec un pareil cœur, j’en aurais vite un autre. »
-« Comme il est généreux ! Voyez le bon apôtre !
Olivier, ce qu’on donne, il faut le posséder ;
Et votre frère Jean voudra-t-il vous céder,
Pour dégager un jour votre folle promesse,
Le château de Clisson et tous ses droits d’aînesse ?…
Mon pauvre et cher Maurice , hélas ! mort à sept ans,
Fait de vous le premier de mes autres enfants ;
Mais l’aîné, c’est le fils de Blanche de Bouville .
Ne vous effrayez pas : Jeanne de Belleville
Aux besoins de ses fils peut noblement pourvoir.
Montaigu, Palluau, La Garnache, Beauvoir,
Et d’autres fiefs encor que je tiens de mon père,
Vous assurent à tous un avenir prospère. »
-« O ma mère, merci, merci de vos bienfaits.
Vos aïeux aux Clisson sont égaux, je le sais ;
Mais si mon frère Jean, grâce à son droit d’aînesse,
Me surpasse en honneurs et sans doute en richesse,
Je veux, mère, attacher tant de gloire à mon nom,
Qu’on me prendra toujours pour le chef des Clisson. »
-« Puisses-tu, cher enfant, réaliser ton rêve !
Mais écoute-moi donc, si tu veux que j’achève.
Guillaume avait deux fils, dont l’un porta son nom
Et mourut pauvre d’ans, mais riche de renom.
Un noble cœur battait dans ces larges poitrines ;
Sur le Mont-Saint-Michel, comme aux champs de Bouvines,
La gloire couronna l’un et l’autre guerrier…
Leur splendide héritage enrichit Olivier. »
-« Olivier ! quel beau nom ! qu’il est doux à la lèvre ! »
-« Olivier fut l’époux de Plaisou de Penthièvre . »
-« Mais… » — « Si dans mon récit tu m’interromps toujours ;
L’histoire finira moins vite que nos jours. »
-« Est-ce cet Olivier, si vanté, que l’on nomme
Le Vieux ? » — « Oui, mon enfant, et ce fut un grand homme, »
Fatigué de repos, plus avide d’exploits,
En douze cent dix-huit Olivier prit la croix.
Quelque jour, quand j’aurai l’âme moins occupée,
Je te raconterai tous ses grands coups d’épée.
Tu verras qu’il était un glorieux baron
Et qu’il sut porter haut sa bannière et son nom.
» Après cinq ans de guerre aux champs de Palestine,
Son pied avec bonheur foula notre colline ;
Mais l’antique chastel qui lui donna le jour
Ne parut à ses yeux qu’un bien chétif séjour.
Rasant jusques au sol cette muraille noire
Que le Temps outrageait, mais qu’honorait la Gloire,
C’est lui, c’est Olivier qui bâtit ce château ,
Dont l’aspect réunit le terrible et le beau.
Sur des rocs de granit repose cette masse,
Dont l’énorme épaisseur brave toute menace ;
Mais l’architecte a fait sa part à la beauté,
Et d’élégantes tours, montant de tout côté,
Ornement et soutien de la forte muraille,
Comme une paludière à la puissante taille,
Étalent fièrement leurs beaux flancs arrondis,
Couronnés de crénaux et de mâchicoulis.
Souvenirs d’Orient, château de Césarée,
Vous revivez surtout dans la porte d’entrée .
» Heureux d’avoir pris rang parmi les paladins,
Clisson a reproduit la Tour des Pèlerins,
Pour que le voyageur, à ces lignes mauresques,
Se rappelât toujours ses faits chevaleresques
Et dit, émerveillé : Voilà bien ces Bretons!
Jusqu’au bout de la terre ils porteraient leurs noms. »
III. – LE VIEIL HERBLAIN .
La femme se penchait à l’étroite fenêtre…
Son regard s’éclaircit : elle voit apparaître,
Au fond de l’horizon, un point noir et mouvant.
N’est-ce qu’un arbre, hélas! que tourmente le vent?
Il approche, il grossit !… A travers la poussière,
Son œil a distingué des éclats de lumière !
Prenant avec transport son fils entre ses bras :
— « Enfant, regarde bien ! Qu’aperçois-tu là-bas ?
Je crains de me laisser tromper par un mirage. »
« Comme un point de soleil à travers un nuage,
Un tourbillon poudreux me montre un cavalier
Qui galope vers nous, tout éclatant d’acier. «
-« C’est bien lui, c’est Herblain, l’écuyer de ton père !
J’ai longtemps attendu ce jour, ce jour prospère…
IL va donc revenir!… Embrasse-moi, mon fils.
Tous mes maux et les tiens, tous nos maux sont finis.
Embrasse-moi plus fort !… Je vais devenir folle ;
Oh ! parle et calme-moi de ta douce parole. »
« Je ne vous comprends pas, ma mère. Qu’avez-vous ?
J’ai peur de vos regards, qui pourtant sont si doux.
Vous disiez ce matin que vous pleuriez sans cause ;
Mère, vous me cachiez quelque terrible chose. »
« Enfant, tu sauras tout, mes terreurs, mon espoir ;
Mais Herblain vient d’entrer… J’ai hâte de le voir.
Votre père m’a dit, en partant pour l’armée :
Jeanne, quand sur mon sort vous serez alarmée,
Chassez devant Herblain tous pensers douloureux;
Herblain seul portera mes messages heureux. »
Des pas ont retenti sur l’escalier de pierre…
Jeanne court vers la porte, et, couvert de poussière,
Herblain tombe à genoux, épuisé, sur le seuil ;
Mais son œil bleu rayonne et de joie et d’orgueil :
-« Oh ! dit-il, d’une voix où tout son bonheur vibre,
Madame, louez Dieu, car Monseigneur est libre,
Et dès demain sans doute il sera près de vous. »
-« Béni soit le Seigneur. s’il me rend mon époux.
Olivier, va jouer avec ton jeune frère,
Mais cache encore à tous le retour de ton père. »
-« Mon bonheur est trop grand pour qu’il n’éclate pas.
O mère, laissez-moi l’apprendre à nos soldats,
Et, la bonne nouvelle allant de proche en proche,
Vous entendrez beau bruit de trompette et de cloche. »
-« Mon fils, j’ai mes raisons pour garder le secret. »
-« C’est demain qu’il arrive ; et si tout n’est pas prêt… »
-« Tout sera prêt, enfant, croyez-en ma tendresse.
Allons, ne pleurez pas; je vous fais la promesse,
Pourvu que vous sachiez mériter ma bonté,
Que bientôt… dès qu’Herblain m’aura tout racontée
Si, comme je le crois, sa réponse est précise,
Si mon bonheur n’a plus à craindre de méprise,
Si ton père demain doit combler notre espoir,
Tu seras le premier à l’annoncer ce soir. »
L’enfant lui saute au cou, l’embrasse avec ivresse,
Mais lui jette, en sortant, un regard de tristesse:
IV. – LA CALOMNIE.
« Herblain, nous sommes seuls… Rien qu’à ton air joyeux
J’ai senti se sécher mes larmes dans mes yeux ;
Mais la joie en mon cœur peut avec peine éclore.
Je ne sais quelle angoisse, hélas ! y règne encore. » *
— « Oh ! Madame, chassez tout chagrin , tout souci :
Si le Ciel fut sévère, il s’est bien adouci.
Votre bonheur demain n’aura plus un nuage.
» Quand, sous les murs de Venne, un excès de courage
Dans les mains des Anglais fit tomber Monseigneur
D’une longue prison nous redoutions l’honneur.
Plus un soldat est brave et plus sa gloire est grande,
Moins on doit espérer que l’ennemi le rende.
Les hauts faits de Clisson, qui font votre fierté,
Tous ses hauts faits plaidaient contre sa liberté.
Vainement vous eussiez multiplié vos offres,
Vainement vos Trésors eussent vidé leurs coffres,
Vainement vous eussiez livré tous vos bijoux,
La paix seule pouvait vous rendre votre époux.
» Mais sous Vennes venu, pour en pousser le siège,
Edouard d’Angleterre — ah! que Dieu le protége,
En tout ce qui n’est pas contraire à nos drapeaux ! —
Ouvrit à notre espoir des horizons nouveaux :
J’avais dans sa prison rejoint mon noble maître.
» Comme entre eux les grands cœurs savent se reconnaître !
S’ils se craignaient l’un l’autre, Édouard et Clisson
S’estimaient, et leurs cœurs battaient à l’unisson.
Le roi, de votre époux admirait le courage ;
Lui rendant en public un éclatant hommage .
: — Une épée, Olivier, va bien à votre bras ;
Les fers du prisonnier ne lui conviennent pas.
Ce n’est pas à prix d’or qu’on rachète un tel homme,
Et puisque pour rançon tu n’as pas un royaume,
Sois libre de par Dieu, libre de par le roi.
-Sire, vous méritez et mon cœur et ma foi :
Mon cœur est désormais tout à vous, sans partage ;
Mais, qu’Edouard pardonne à mon libre langage,
Si longtemps qu’on verra le léopard anglais
Menacer de sa griffe ou Bretons ou Français,
Ma foi n’est pas à vous, ma foi ni ma vaillance,
Mais à Charles de Blois, à Philippe de France ;
Or, rien de son serment ne dégage un Clisson.
Mon admiration, oui ! mon dévoûment, non !
-Vrai Dieu ! serre ma main, car tu m’as su comprendre,
Olivier ; j’ai voulu donner et non pas vendre.
Tu peux rester fidèle à ton duc, à ton roi ;
Je ne t’en trouverai que plus digne de moi.
-Sire, mettez le comble à vos bontés royales :
Acceptez sans hauteur et de mes mains loyales,
Non pas comme retour, j’en rougirais bien fort,
Acceptez sans rançon le comte de Stafford.
C’est un brave soldat, un noble caractère ;
La France ainsi serait quitte envers l’Angleterre.
-Puisque tu l’aimes mieux, sois donc libre à rançon :
Oui, Clisson vaut Stafford, mais Stafford vaut Clisson
» Quand mon noble seigneur s’est vu libre, Madame,
Vers vous, vers ses enfants tournant toute son âme,
Il voulait sans retard venir entre vos bras
Goûter enfin la joie après tant de combats ;
Mais quand parlait l’honneur, l’amour a dû se taire.
Venne, assiégé toujours par le roi d’Angleterre,
Tient tête à ses assauts et brave ses efforts ;
Mais ses fiers défenseurs ont besoin de renforts.
Clisson, pour seconder leur vaillance hardie,
A Nantes a rejoint le duc de Normandie .
» Ce fils du roi de France, et mon noble Seigneur,
Qui de Venne, après tout, est toujours gouverneur
Vont conduire au secours de la ville en alarmes,
Vingt mille gens de pied et cinq mille hommes d’armes.
Tout sera bientôt prêt au gré de leurs désirs ;
Mais mettant à profit quelques jours de loisirs,
Mon maître, avant d’aller où le devoir l’appelle,
Veut puiser dans votre âme une force nouvelle :
— Va, dit-il; à ma femme annonce mon retour ;
J’appartiendrai demain tout entier à l’amour. »
-« Dans ma poitrine, Herblain, mon cœur bat à se rompre.
J’ai voulu te laisser parler sans t’interrompre :
Les beaux faits, les beaux mots que tu m’as racontés,
Comme des diamants mon cœur les a comptés ;
J’en garde le trésor au fond de ma mémoire.
Oui, mon époux est grand et mérite sa gloire ;
Mais son mérite même excite mon effroi.
Il a des envieux tout puissants près du Roi ;
Ce sont les hauts sommets qui provoquent la foudre.
» A t’ouvrir tout mon cœur dois-je enfin me résoudre ?
Oui, je n’ai pas besoin de tes nouveaux serments ;
Comme en un livre ouvert je lis tes sentiments :
Nul ne saura jamais, nul, pas même ton maître!
L’indjgne question que je vais me permettre.
Ce que je vais te dire est vraiment monstrueux :
Trahison et Clisson, ces mots hurlent entre eux !…
Herblain, comprends-moi bien ; Herblain, je suis sa femme
Ces mots sont sur ma lèvre et non pas dans mon âme ;
Mais, Herblain, réponds-moi sur ta foi de chrétien,
Ces bruits ont-ils couru ? Sois franc : n’en sais-tu rien ?
-« Par la croix de mon Dieu, par le nom de mon père,
Par tout ce qu’ici-bas comme au ciel je révère,
Si d’une bouche d’homme un tel mot fût sorti,
Herblain aurait crié : Vous en avez menti ! »
« Brave Herblain! J’applaudis à l’ardeur qui t’emporte :
L’indignation juste a toujours la voix forte.
Eh bien, ces bruits menteurs, que je hais comme toi,
Ces bruits calomnieux sont venus jusqu’à moi.
L’on feint de s’étonner, comme d’un grand mystère,
Qu’en vain Charles de Blois offre au roi d’Angleterre
Si haut prix qu’il voudra pour Hervé de Léon ,
Sans pouvoir l’obtenir par échange ou rançon ;
Et qu’au riche Olivier ce même prince rende
Sa pleine liberté, même avant sa demande.
Entre eux la paix est faite et l’on serait surpris
Que la France avant peu n’en payât pas le prix.
On dit cela. tout bas, mais on ose le dire ;
Et je ne sais pas qui, pour pouvoir le maudire ! »
« Il n’est plus de serpents à certaines hauteurs,
Madame: dédaignez ces bruits et leurs fauteurs;
Moi-même, je rougis d’avoir pu les admettre
Et d’avoir défendu contre eux mon noble maître.
Le duc de Normandie avant-hier, devant moi,
Parlant en son nom propre ainsi qu’au nom du Roi,
Au milieu des barons à cheval sous leurs armes,
Comme s’il eût voulu dissiper vos alarmes,
Tout haut de votre époux vantait la loyauté
Et pour un grand succès comptait sa liberté.
Madame, soyez donc tranquille, heureuse et fière ;
Clisson n’aura jamais de tache à sa bannière. »
Jeanne, enfin convaincue, est tombée à genoux :
— « Béni soit le Seigneur, qui me rend mon époux.
O mon Dieu, dissipez mes dernières alarmes
Et d’un peu de bonheur payez enfin mes larmes…
« Que mon fils de son père annonce le retour,
Et que notre étendard flotte sur chaque tour. »
V. – UN PRÉSAGE.
Nuit terrible! L’orage,
Fou de haine et de rage,
Hurlait sur le coteau ;
Et sa voix émouvante
Remplissait d’épouvante
La ville et le château.
Aux flancs de la ravine
La colère divine
Secouait les grands bois ;
Et, du fond des ténèbres,
Mille clameurs funèbres
Gémissaient à la fois.
Cherchez-vous donc des âmes
Pour vos lugubres flammes
O démons qui passez ?
Pour fuir ainsi vos bières,
Vous faut-il des prières,
Spectres des trépassés ?
Est-ce la fin du monde
Et la foudre qui gronde
Va-t-elle tout broyer ?
Ce cri de la tempête,
Est-ce donc la trompette
Du jugement dernier ?
Mais non, le ciel s’épure,
Et toute la nature
Que rassure le jour,
Reconnaissante envoie
A l’auteur de sa joie
L’hymne de son amour.
Comme un mystique vase,
L’âme s’emplit d’extase
Et d’admiration ;
Car elle prend, ravie,
Ce réveil de la vie
Pour la création.
VI. -SOUVENIRS.
De l’ouragan qui fuit la trace est effacée.
Tout s’éveille, joyeux de sa terreur passée.
Sur les tours, sur les toits et dans chaque jardin,
Gazouillent les oiseaux, gais hérauts du matin ;
Le cri du coq se mêle au chant si frais des merles ;
La pluie à chaque feuille a suspendu ses perles ;
La clarté, qui poind, rend, aux arbres comme aux fleurs,
La grâce de la forme et l’éclat des couleurs.
Mais tout est vague encore et les lignes se fondent :
Dans un lointain brumeux les objets se confondent,
Et l’œil surpris croit voir, tout au fond du ciel bleu,
L’Océan calme et rose et des îles de feu.
L’air est limpide et frais, la brise parfumée,
Et de la Sèvre monte une blanche fumée.
On n’entend d’autre bruit que le chant des oiseaux,
Le murmure des bois et la chute des eaux,
Ou, parfois, sur la tour le cri du guet qui veille.
Dans la ville, au château, tout le monde sommeille,
Même les cœurs blessés que le chagrin poursuit :
Tout cherche à réparer le trouble de la nuit.
Jeanne seule est debout à sa fenêtre ouverte,
Plongeant de longs regards sur la campagne verte,
Sur les coteaux boisés, sur les toits des maisons,
Sur la vallée ombreuse aux fuyants horizons,
Sur ces rocs de granit, gris et tachés de mousses,
Sur ces prés inclinés en longues pentes douces,
Sur la rivière brune au cours capricieux,
Écumant en cascade ou reflétant les cieux,
Puis franchissant d’un bond le rocher qui l’attarde.
Mais Jeanne ne voit rien de ce qu’elle regarde :
Ce ciel bleu, ces parfums, ce bruit vague et lointain,
Tout lui reste étranger des charmes du matin.
La nature pour elle est à l’état de songe.
C’est dans son propre cœur que cette femme plonge ;
C’est son propre destin qu’elle s’efforce à voir.
Sa mémoire, une fée au magique miroir,
Lui montre le tableau de sa vie écoulée,
Rayonnante d’éclat, mais triste et désolée :
Pas d’ombre ni d’eau vive; à peine quelques fleurs,
Dont un soleil brûlant dévore les couleurs.
Elle a tout, noble nom, richesse, honneurs, puissance ;
Mais ce n’est pas cela que rêvait son enfance.
Ame exaltée et tendre, il lui fallait l’amour,
Et l’amour n’a sur elle, hélas ! lui qu’un seul jour.
Un Anglais, jeune et beau, d’une noble famille,
Poétique et rêveur comme la jeune fille,
Avait conquis son âme et demandé sa main ;
Mais son père a noué pour elle un autre hymen.
Étouffe ton amour, Jeanne de Belleville !
Oui, l’amante a fait place à la fille docile,
Et Geoffroy , fils hautain des fiers Château-Brient,
L’emmène comme épouse en son manoir brillant.
Le cœur de Jeanne est pur, et Gautier Benthelée
N’y sera plus qu’une ombre incertaine et voilée :
Le sévère devoir règnera sur ses jours ;
Mais le bonheur a fui, peut-être pour toujours.
De plaisirs renaissants en vain sa vie est pleine ;
Un éternel ennui ronge la châtelaine.
Ces orgueilleux barons, aux armures de fer,
Ont le cœur à l’amour moins qu’à la gloire ouvert :
Geoffroy se montre heureux des grâces de sa femme,
Mais froisse, sans les voir, toutes les fleurs de l’âme.
Dieu, pour la consoler, accorde à Jeanne un fils
L’amour et le devoir portent les mêmes fruits ;
Mais ces fruits ont toujours des saveurs inégales,
Et le plus doux mûrit aux flammes conjugales.
Oui, le cœur a parfois besoin d’épanchements :
La femme la plus chaste a des rêves charmants,
Et, s’il lui faut toujours refouler sa tendresse,
En vain son jeune enfant l’embrasse et la caresse,
Cette joie innocente aggrave ses douleurs
Et souvent ses baisers sont tout mouillés de pleurs.
Mais Jeanne a l’âme brave et dompte sa souffrance :
L’oubli de son époux et son indifférence
Étendent sur sa vie un lourd nuage noir ;
Rien ne fera fléchir son respect du devoir.
Se donnant tout entière à sa jeune famille,
Car le Ciel à son fils daigne adjoindre une fille ,
Jeanne voit s’apaiser les troubles de son cœur,
Et la mère à l’épouse a rendu le bonheur.
Le bonheur ! En est-il, hélas! sur cette terre ?
Ses enfants adorés sont en deuil de leur père :
Château-Brient n’est plus, et, sur son fier manoir,
Flotte un grand étendard où pend un crêpe noir.
Sa navrante douleur prouve à la pauvre femme
Qu’une affection vraie avait crû dans son âme,
Et que, malgré leurs torts, les cœurs unis par Dieu
Ont des déchirements à leur dernier adieu.
Ses vœux appelleraient un éternel veuvage ;
Mais comment protéger ses enfants en bas âge ?
Dans ces jours de tourmente, où coule tant de sang,
Leur faiblesse a besoin d’un protecteur puissant.
Jeanne se sacrifie, et la tremblante veuve
D’un second hyménée accepte encor l’épreuve.
Cette fois, un grand cœur bat sous le dur acier :
Clisson, le haut baron, est un vrai chevalier.
Sa femme à lui s’attache, et de toute son âme,
Car l’admiration comme l’amour enflamme ;
Et cinq jeunes enfants, gages de leurs amours,
Font des jours de bonheur de chacun de ses jours.
Le bonheur ! En est-il, hélas! sur cette terre ?
Le père de ses fils, son noble époux, la guerre
L’arrache de ses bras, et ses chastes douleurs
Aux baisers maternels mêlent encor des pleurs.
Et ce n’est pas assez de l’effroi qui l’assiège,
Des périls du combat et des hasards d’un siège ;
L’envie a distillé son odieux poison :
Il circule dans l’air des bruits de trahison.
Clisson, trahir ! Clisson, la fidélité même !
Le penser est un crime, et le dire, un blasphème :
Son retour triomphal dément ce bruit menteur…
Et, je ne sais pourquoi, Jeanne pourtant a peur.
Est-ce un signe, ô mon Dieu, que ce terrible orage ?
Seigneur, ayez pitié ! chassez le noir présage :
Qu’en son château Clisson rentre et voie, à son seuil,
La femme dont il fait la douleur et l’orgueil.
VII. – LA FÊTE DU RETOUR.
Pendant que Jeanne ainsi, déroulant sa pensée,
Contemple les tableaux où sa vie est tracée,
Le jour remplit le ciel, et le donjon vermeil
Au-dessus des grands bois voit monter le soleil.
Alors de toute église, à rapides volées,
Les cloches de leurs sons inondent les vallées ;
Tout s’éveille au château : les clairons dans les cours
Mêlent leurs bruits aigus aux bruits sourds des tambours ;
Chaque tour fait flotter de longues oriflammes
Et tout jusqu’aux créneaux se pavoise de flammes.
Le bouillant Olivier préside à ces apprêts
Et n’a plus qu’une peur, c’est qu’ils ne soient pas prêts ;
A tout ce qu’il rencontre il annonce son père,
Va, vient, monte, descend, interroge sa mère.
Et, gourmandant les chefs, excitant les soldats,
Fait tout pour se lasser, sans jamais être las…
Et la mère à son fils rit, fière et satisfaite.
Mais dans la ville aussi tout prend un air de fête.
Les bourgeois, affairés au seuil de leur maison,
Après avoir scruté du regard l’horizon,
Après avoir causé longuement de l’orage
Et cité, l’un sa crainte et l’autre son courage,
Tendent de longs tapis au-devant de chez eux ;
Les herbes et les fleurs jonchent le sol pierreux,
Et, pour mieux célébrer le retour d’un bon maître,
Le drapeau des Clisson brille à chaque fenêtre ;
Pour tout peindre d’un mot, partout, de tout côté,
Chacun fait dans la ville assaut de loyauté.
Puis tout s’anime encor… Voyez ! de chaque rue
La foule endimanchée et se presse et se rue ;
Sur la route de Nante on court, et les enfants
Remplissent les échos de leurs cris triomphants.
Peut-être que Clisson ramènera ses troupes,
Et cet espoir secret fait, dans chacun des groupes,
Palpiter plus d’un cœur, briller plus d’un regard :
Les douceurs du retour consolent du départ.
Hélas! ces beaux archers et ces hardis gens d’armes
Qu’au départ on couvrit de baisers et de larmes,
Tous ne reviendront pas au foyer paternel :
La mort a préparé plus d’un deuil éternel ;
Mais, si le doute affreux fait pâlir chaque mère,
Tout cœur jeune est joyeux, car tout cœur jeune espère.
Celle pour qui l’espoir a les chants les plus doux,
C’est Jeanne, et ses baisers volent vers son époux.
Elle est impatiente et vers lui sa pensée,
Sur l’aile du désir, s’est vingt fois élancée :
Le voilà qui paraît sur son coursier fougueux ;
Du duc de Normandie il reçoit les adieux ;
Il part. Dieu ! que la ville est longue !… Il la dépasse
Et, d’un ardent galop, il dévore l’espace ;
Mais son cheval rapide et fumant de sueur
Lui semble mal répondre aux élans de son cœur ;
Son éperon d’acier à grands coups l’aiguillonne ;
La poussière autour d’eux s’élève et tourbillonne.
Il avance, il approche, il arrive. Hélas! non :
Le guet reste muet au sommet du donjon.
Jeanne y monte, et son œil plonge au loin sur la route.
Dans les champs, le silence, et dans son cœur, le doute !
Cependant le temps marche et, sous les feux du jour,
L’ombre s’est repliée au pied de chaque tour.
Midi ! déjà midi! c’est l’Angelus qui sonne,
Et Clisson ne vient pas ! Jeanne en secret frissonne,
Mais, cachant ses terreurs sous des dehors joyeux,
Elle vient se mêler aux soldats soucieux,
Les convie à la joie et, vantant leur tenue,
Leur fait verser à flots le vin de bienvenue.
Olivier court vers elle et, d’un air effaré :
— « Eh ! que fait donc mon père ? Oh ! je le gronderai. »
Et l’on attend toujours, et l’heure indifférente
Va de son pas égal, bien qu’on la trouve lente.
Le soleil moins ardent baisse vers l’horizon,
Et rien n’annonce encor le retour de Clisson !
Pourtant sur le chemin que la poussière masque,
Le guet a vu briller comme l’éclair d’un casque ;
Il donne le signal, et mille cris joyeux,
Comme une seule voix ont monté vers les cieux.
La châtelaine heureuse a les yeux pleins de larmes.
Le clairon retentit, le soldat court aux armes ;
Sous les drapeaux, marqués d’insignes différents,
Tous les chefs empressés ont fait former les rangs.
Olivier bat des mains et les passe en revue :
— « Hâtez-vous, leur dit-il, car mon père est en vue.
Ma mère, faites donc baisser le pont-levis :
Les premiers qu’il doit voir, sont sa femme et ses fils. »
Jeanne n’avait pas eu de temps pour sa réponse,
Qu’un varlet descendu des tours, tout triste, annonce
Que le guerrier là-bas par le guet découvert
Est seul ; derrière lui le chemin est désert.
C’est sans doute un courrier que Monseigneur envoie.
Jeanne au fond de son cœur sent se briser sa joie
Et, pour ne pas tomber s’appuyant à son fils,
De son collier de jais baise le crucifix :
— « Va, dit-elle, en riant malgré son regard terne,
Va, mon cher Olivier, fais ouvrir la poterne ;
Il me tarde d’apprendre, ô mon fils, la raison
Qui retient loin de nous le chef de la maison. »
Pauvre femme ! en disant ces mots à double entente,
Elle semblait en proie à quelque horrible attente :
Un péril inconnu, planant sur les Clisson ,
Menaçait leur château, leurs armes et leur nom.
Fendant les rangs pressés de la foule bruyante,
Que la garde écartait de la porte béante,
Le courrier de Clisson, avec peine introduit,
Devant la châtelaine est aussitôt conduit.
-« Où donc as-tu, dit-elle, abandonné ton maître? »
Et comme, haletant, il tendait une lettre,
Sa main impatiente a saisi le vélin
Qui contient dans ses plis sa joie ou son chagrin.
Pendant que son œil lit la missive si chère,
D’un bonheur grandissant son visage s’éclaire.
Tel un nuage épais fond, se dissipe et fuit,
A mesure qu’au ciel la lune monte et luit.
Et ce qui plonge Jeanne en cette heureuse ivresse,
Ce ne sont pas ces mots tout brûlants de tendresse,
Élans d’un cœur ardent qui cherche à s’apaiser
Et que la lèvre trouve aussi doux qu’un baiser ;
Ce n’est pas le serment de s’envoler près d’elle,
Sitôt que le devoir ne lîra plus son aile ;
Sort cruel ! ce n’est pas l’espoir même incertain
D’un grand péril qui cesse ou qui devient lointain ;
Non, pour longtemps encor l’absence se prolonge :
Ils ne se verront plus qu’en pensée ou qu’en songe ;
Non, de prochains combats attendent cet époux
Qu’enivrent les dangers et qui les brave tous.
Mais du loyal Clisson Jeanne connaît bien l’âme
Et n’a jamais douté de l’amour qui l’enflamme :
Si pendant de longs jours son mari reste absent,
Pour venir l’embrasser il donnerait son sang ;
Elle en est assurée, et son grand cœur pardonne
A l’honneur du soldat les chagrins qu’il lui donne.
Ce qui la rend heureuse et fait briller son œil
Des splendeurs de la joie… et d’un éclair d’orgueil,
C’est qu’admirant sa gloire incessamment grandie,
Le noble fils du roi, le duc de Normandie,
Accorde à son époux toute son amitié
Et n’a pour ses rivaux que dédain ou pitié.
Jeanne peut donc braver les trames de l’envie,
Et le bonheur encore est promis à sa vie.
Autour d’elle assemblant les chefs et les soldats :
— « Amis, dispersez-vous ; Monseigneur ne vient pas.
De son heureux retour si la joie est remise,
Une gloire nouvelle à son nom est promise.
Hier soir, au moment où mon illustre époux
Faisait tous ses apprêts pour revenir vers nous,
Le général en chef, le fils du roi de France
Apprit, par un courrier expédié d’urgence,
Que nos frères de Venne étaient serrés de près
Et qu’à les secourir si nous n’étions pas prêts,
Les Anglais sous cinq jours entreraient dans la place,
Tant la ville est souffrante et la garnison lasse.
Le duc de Normandie, écartant tout retard,
A de toute l’armée ordonné le départ ;
Et quelque ardent désir que Clisson eût dans l’âme
De revoir ses soldats, ses enfants et sa femme,
Devant l’ordre du prince il n’a pas hésité :
Le premier des devoirs, c’est la fidélité. »
« Ma mère, il a bien fait ; mais moi, quand donc pourrai-je
Combattre près de lui? Qu’un jour l’Anglais assiège,
S’il l’ose, ce château, sois sans peur, tu verras
Si le fils de Clisson se sert bien de son bras. »
-« Oh! le grand fanfaron ! » — « Qu’on me mette à l’épreuve ! »
_« Allons, petit ruisseau, tâchez d’être un grand fleuve. »
VIII. – LA VIE DE CHATEAU
La paix est revenue au manoir agité
Et la vie y reprend son uniformité.
Quand le maître est absent et que la châtelaine
N’admet que ses devoirs à consoler sa peine,
Le séjour des châteaux compte peu de plaisirs,
Et c’est tout un travail d’occuper ses loisirs.
Aux chevaux dans les cours faire faire des voltes,
Des Flamands imiter ou punir les révoltes,
Disputer à grands coups un carré de fumier,
Essayer au palet quel sera le premier,
Du fou de Monseigneur écouter les sottises,
Faire avec les jongleurs assaut de gaillardises,
Que sais-je? Tout cela n’est pas réjouissant,
Et l’on aimerait mieux verser un peu de sang.
C’est là le vrai plaisir pour des hommes de guerre ;
Mais tout homme n’a pas du bonheur sur la terre.
Gardiens de ce château, vous êtes en prison
Et, malgré les beautés qu’étale l’horizon,
Je ne m’étonne pas de l’ennui qui vous gagne :
Toujours la même ville et la même campagne !
Ah ! si c’était l’hiver, autour des feux assis,
On aurait la ressource au moins des longs récits.
Mais l’été ! Ce serait à se couper la gorge,
Sans ce bon petit vin de Vallet ou de Gorge .
Enfin! en attendant la chance d’un danger,
C’est quelque chose encor de boire et de manger.
Et puis, de temps en temps, quand on reçoit sa paie,
On peut risquer aux dés quelque peu de monnaie :
La vie est, après tout, passable en tout séjour,
Avec le jeu, le vin et… des rêves d’amour.
Jeanne, dans le donjon tout le jour retirée,
Savourait l’espérance en son âme rentrée :
Clisson délivrait Venne et chassait les Anglais ;
Bientôt par son courage il conquérait la paix ;
Charles de Blois vainqueur lui devait sa couronne ;
De Philippe de France il assurait le trône ;
Puis le triomphateur, suivi de ses guerriers,
A ses pieds accourait déposer ses lauriers.
Oh 1 que la vie alors leur sera bonne et douce 1
Comme un couple d’oiseaux cachés au nid de mousse,
Des voiles du mystère enveloppant leurs jours,
Ils seront tout entiers à leurs chastes amours.
Comme ils répareront les heures écoulées
Dans les larmes ici, là-bas dans les mêlées :
Pour elle plus d’effroi ; pour lui plus de dangers.
Aux querelles des grands désormais étrangers,
Satisfaits du bonheur qui sur leur tête brille,
Ils vivront pour eux seuls et leur jeune famille.
Jeanne a payé bien cher leur droit de vivre heureux,
Et Dieu, qui vit ses pleurs, Dieu veillera sur eux.
Plus tard, oh ! bien plus tard, si quelque juste guerre
Des Clisson aux combats rappelait la bannière,
Olivier serait grand , Olivier serait fort ;
C’est lui qui partirait, et son bras, sans effort,
Brandissant sur l’Anglais la hache paternelle,
Conquerrait à son nom une gloire nouvelle.
Sans reproche et sans peur, en tout lieu respecté,
Le plus grand des Bretons, le duc seul excepté,
Gagnant le plus haut prix promis à la vaillance,
Olivier deviendra connétable de France.
IX- UNE LEÇON DE LOYAUTÉ.
Pendant qu’on lui prêtait ces exploits merveilleux,
Le petit Olivier se livrait à ses jeux ;
Mais ses plaisirs d’enfant ne l’amusent plus guères
Et, pour lui plaire, il faut lui raconter des guerres.
-« Mère, vous m’avez dit comment, sur ce coteau,
Olivier le Vieux fit bâtir notre château :
A-t-il par d’autres faits mérité d’autre gloire ?
Puisqu’on en parle tant, contez-moi son histoire. »
-« Clisson vit son manoir en sept ans achevé.
A peine son drapeau, dans les airs élevé,
Brillait sur ce donjon et sur ces tours si hautes,
Que des hôtes royaux y vinrent, et quels hôtes !
Louis neuf , le grand saint et l’exemple des rois,
Et le dernier des preux qui portèrent la croix,
Honora de ses pas notre grande bastille,
Suivi, comble d’honneur ! de Blanche de Castille,
Sa mère, et cette mère était digne de lui.
Saluez ces deux noms, jamais plus grands n’ont lui.
Ce modèle accompli des mères et des reines,
Blanche, au nom de son fils enfant, tenait les rênes
Du royaume de France et, dans sa loyauté,
Veillait sur tous les droits qui font la royauté.
Les hauts barons jaloux voulaient y faire brèche,
Et leur ligue en secret dans les châteaux se prêche.
Blanche lève une armée et va marcher contre eux ;
Ils subissent l’affront d’un pardon généreux.
Notre duc seul, hélas! persiste dans la lutte
Et de Blanche sa haine à tout prix veut la chute.
Infidèle à l’Église, à son roi déloyal,
Pierre de Dreux pourtant était de sang royal !
Que son exemple, enfant, t’apprenne à quelles fautes
Peut entraîner l’orgueil d’ambitions trop hautes.
Le duc avait besoin d’un aide et, pour l’avoir,
Oublieux de son nom comme de son devoir,
Dédaignant tout souci de honte ou de dommage,
Au roi de l’Angleterre il alla rendre hommage ;
Et nous, que l’habitude a faits presque Français,
Nous Bretons, nous étions vassaux d’un prince anglais !
Dreux à son suzerain livrait ses places fortes,
Et Nantes dut ouvrir, en frémissant, ses portes.
« Plus d’un noble, sentant la rougeur à son front,
Refusa de subir cet odieux affront
De joindre sa bannière à la bannière anglaise . »
« De ceux-là soit Clisson, si tu veux qu’il me plaise. »
« Clisson fut de ceux-là. La reine au parlement
Cita Dreux, pour avoir violé son serment.
Le parlement lui mit le sceau de félonie
Et sa trahison fut de toute voix honnie.
Mais un glaive punit encor mieux qu’un arrêt :
Blanche accourt, et voilà son drapeau qui paraît,
Menaçant et vengeur. Chaque baron fidèle
Vient avec ses vassaux se ranger autour d’elle,
Et les traîtres tremblants se cachent dans leurs nids.
Blanche capture Oudon, Chantoceaux, Ancenis ;
Henri, roi des Anglais, reste enfermé dans Nantes !
Il entend les défis des trompettes sonnantes,
Et ne songe qu’à fuir. Mais comment et par où ?
Alors, pour lui barrer les portes du Poitou,
Olivier de Clisson ouvrit sa forteresse
A Louis, son vrai maître, à Blanche, sa maîtresse ;
Et sur ce fier donjon tous trois virent longtemps
Leurs drapeaux glorieux mêler leurs plis flottants.
Henri restait toujours retranché dans la ville ;
La reine, lasse enfin d’une attente inutile,
Reprit avec son fils le chemin d’Ancenis ;
Mais de sa loyauté Clisson reçut le prix.
Pour que cet aigle pût, du haut de sa montagne,
Protéger à la fois la France et la Bretagne,
Blanche avait, en partant, doublé sa garnison.
Nul étendard anglais ne souilla l’horizon.
Par de secrets détours conduisant son armée,
Henri trois menaça la Saintonge alarmée.
Ce roi, qu’humiliait une femme au grand cœur,
Crut cacher son affront sous un laurier vainqueur.
De Mirebeau d’abord il força les enceintes,
Mais son orgueil alla se briser contre Saintes ;
Et Clisson vit un jour, du haut de son château,
Revenir le vaincu, qui, longeant le coteau,
Suivait dans leurs détours les rives de la Sèvre,
Tout triste, et, les sourcils crispés comme la lèvre .
Pour défier le roi, le duc et ses barons,
Olivier fit sonner par trois fois les clairons,
Sur les tours qu’enflammait le soleil comme un phare.
« Quand le prince entendit la joyeuse fanfare,
Son cœur se souleva; son œil resta baissé.
Son armée après lui, comme un serpent blessé,
Déroulait lentement ses lignes onduleuses ;
La honte alourdissait ces troupes orgueilleuses,
Dont le pas cadencé sur ces rochers déserts
Troublait seul d’un bruit sourd le silence des airs ;
On les suivit longtemps aux éclairs de leurs armes.
On raconte qu’alors Henri versa des larmes :
Les splendeurs d’un beau ciel, chez des soldats vainqueurs,
Font flamboyer la joie aux yeux et dans les cœurs ;
Mais pour un roi vaincu, c’est presque une ironie. »
« Honte au roi dont le bras soutient la félonie !
Mais pourquoi donc ne pas leur barrer le chemin ?
J’aurais voulu contre eux tenter un coup de main. »
-« La vertu du soldat n’est pas qu’en sa vaillance,
Mon fils ; la valeur vraie a pour sœur la prudence.
Si Clisson peut braver les Anglais dans son fort,
Pour leur livrer bataille, il n’est pas assez fort ;
Mais c’est une action digne d’être acclamée,
Que son défi si fier à toute cette armée.
» Henri rentre dans Nante, et ses honteux loisirs,
Dérobés à l’honneur, sont donnés aux plaisirs ;
Puis à Blanche humblement il demande une trêve,
Et la Guerre au fourreau remet enfin son glaive. »
-« Et Dreux? tous ses méfaits furent-ils impunis ? »
-« Dégradé par les pairs siégeant dans Ancenis,
Dreux fit tous ses efforts pour rallumer la guerre ;
Mais trahi, délaissé par Henri d’Angleterre,
Il fut forcé d’aller, lui duc, la corde au cou,
Demander son pardon , le front sur le genou.
» Il faut être indulgent, mon fils, pour sa mémoire,
Car, malgré tous ses torts, ce duc n’est pas sans gloire :
La Bretagne lui dut de sérieux bienfaits
Et plus d’un ménestrel a chanté ses hauts faits.
Lorsque son fils majeur du duché prit les rênes,
Dreux, qui se fit alors nommer Pierre de Braines,
Se croisa par deux fois et, près de saint Louis,
Fit admirer sa force à nos preux éblouis.
Quand, dans un jour néfaste et près de la Massoure,
La victoire trahit lâchement la bravoure,
Quand Dreux fut prisonnier à côté de son roi,
Les Sarrasins vainqueurs tremblaient encor d’effroi.
Pour cette âme si brave et désormais loyale,
Louis, comme pour lui, paya rançon royale ;
Mais Dreux avait perdu trop de sang aux combats.
Doux pays de Bretagne, il ne te revit pas.
Mais chez nous, mon enfant, le cœur a sa mémoire,
Et Dreux sera toujours l’orgueil de notre histoire :
Son sang a bien lavé les taches de son nom. »
-« Mère, laissons ce traître et parlons de Clisson. »
-« O neige immaculée ! O pure conscience !
Cœur sans tache et sans ombre. et sans expérience !
Seigneur, garde à mon fils, même au prix du bonheur,
Ce sentiment exquis de l’inflexible honneur.
X. – UNE LEÇON DE JUSTICE.
Le temps avait fauché de nombreuses années
Et foulé sous ses pas bien des choses fanées.
Sous cet écroulement de printemps et d’hivers,
Tout ici-bas subit des changements divers,
Mais l’éternelle loi veut qu’ici-bas tout change.
Clisson et son château, par un contraste étrange,
Vieillis ensemble, offraient un aspect dissemblant :
Le castel était noir, le baron était blanc.
Mais Clisson portait bien sa vieillesse robuste ;
Redouté comme fort, respecté comme juste,
Pour le crime terreur, pour l’innocence appui,
Les fronts les plus hautains se courbaient devant lui.
» Jean le Roux, fils de Dreux, pour obtenir du pape
Son pardon d’attentats sur la mitre et la chappe ,
A l’Église octroya je ne sais trop quels dons
Qui froissaient tous les droits de nos barons bretons.
On vit se soulever plus d’une baronnie. »
-« Mais la guerre à son duc, c’est une félonie ! »
-« Non, car Jean violait un serment solennel.
Les nobles et le duc, en face de l’autel,
S’étaient juré, le jour où Jean prit la puissance,
Lui sa protection, eux leur obéissance.
L’une sans l’autre ? non, car nous avons nos lois :
Le noble ne doit rien à qui trahit ses droits.
» La Coutume est constante et n’a rien d’équivoque ;
Oui, du prince au sujet le nœud est réciproque.
Si les libres enfants des Francs ou des Germains
Laissent, dans leur hommage, un chef lier leurs mains,
Ils ne prêtent jamais leur foi que sous réserve,
Et le contrat n’est bon que si chacun l’observe.
Dès qu’un chef porte atteinte à quelque liberté,
Chaque front se redresse et reprend sa fierté.
Supporter l’injustice humblement et sans plainte,
C’est l’affaire des serfs qu’attache au joug la crainte ;
Chez les nobles, tout droit tué tue un devoir.
Dans ce faisceau de droits dont est fait le pouvoir,
Chacun fait son offrande à la chose publique
Et l’on met en commun ce que chacun abdique ;
Le roi, le duc, le comte en devient le gardien :
C’est le trésor de tous, mais ce n’est pas le sien.
Suzerain et vassal, vavasseur, homme-lige,
Un seul et même nœud les lie et les oblige :
Le faisceau dénoué, le droit passe aux plus forts…
Sous l’œil de Dieu, qui juge et qui punit les torts.
» Rejetant loin de lui le masque de l’intrigue,
Clisson se proclama bien haut chef de la ligue.
Jean le Roux, rassemblant ses bataillons épars,
Fit camper son armée aux pieds de ces remparts
On essaya de tout, balistes, sape et mine ;
On employa tout, force et ruse, assaut, famine,
Tout ce que la valeur ou l’adresse fournit.
Le maître était de fer, le château de granit.
Le siège n’avançait en rien ; c’était l’armée
Et non la garnison qu’on voyait alarmée ;
C’est que l’armée, enfant, n’avait pour chef qu’un duc,
Contre un héros, bien vieux, mais pas encor caduc.
» Parfois Clisson, guidant une troupe hardie,
Portait au camp breton la mort et l’incendie ;
Plus souvent il restait tranquille au haut des tours,
Aigle altier défiant des bandes de vautours :
Et l’ennemi tremblait sous son regard de flamme,
Car dans ce grand vieillard flamboyait toujours l’âme.
On eût dit un jeune homme, à part ses cheveux blancs.
Tels, dit-on, dans le Nord, on voit certains volcans
Lancer leurs feux au ciel, quoique couverts de neige.
» A bout d’efforts, le duc honteux leva le siège ;
Mais il cita Clisson, pour viol de serment,
Devant le roi de France assis en parlement.
A qui veut condamner, il ne faut qu’un prétexte :
Le parlement trouva facilement un texte,
Et, par arrêt, Clisson, pour d’apparents griefs,
Fut, en faveur du duc, dessaisi de ses fiefs…
Mais il avait, en fait, pour lui sa bonne épée.
Et, chaque forteresse étant bien occupée,
Le calme et fier vieillard ne s’inquiétait pas ;
Son bras était tout prêt pour de nouveaux combats.
» Le roi de France mit son armée au service
De ce que l’on osait appeler la Justice ;
Et la ligue effrayée accepta tout, oui, tout !
Clisson résista seul, inflexible et debout :
Duc et roi contre lui ! son âme était charmée ;
Mais, seul, que pouvait-il contre leur double armée?
Un par un ses châteaux, longuement défendus,
Éventrés et croulants furent pris ou rendus.
Le vieux loup s’en allait de tanière en tanière.
Tant qu’il eut une tour où dresser sa bannière,
Au haut de cette tour sa bannière flotta…
Clisson n’avait plus rien, lorsque Clisson traita.
Calme et majestueux comme un grand lion fauve,
Il tomba noblement et sa dignité sauve :
Bravant, avec hauteur, ducs, parlements et rois,
En cédant sur les faits, il maintint tous ses droits .
» La Bretagne soumise et ses troupes maîtresses,
Jean le Roux d’Olivier rase les forteresses ;
Car ce prince, que seul l’étranger fait vainqueur,
N’a pas plus de pitié que de courage au cœur.
Ce château de Clisson, par faveur spéciale
Laissé debout, reçut la garnison ducale.
» Louis neuf, le saint roi, daigna se souvenir
Qu’enfant, le vieux guerrier l’avait su soutenir.
De sa reconnaissance ô solennelle marque !
Louis se fait arbitre, et ce puissant monarque,
Élevant pour la paix un rameau d’olivier,
Obtient de Jean le Roux que le fils d’Olivier,
De son père vivant recevra la dépouille,
Pourvu qu’humble vassal, qui ploie et s’agenouille,
Il se lie à jamais, en termes bien formels,
Et paie en beaux écus les forfaits paternels.
Quant au vieil Olivier, que son fils vive ou meure,
Il ne doit plus rêver son château pour demeure :
Une somme d’argent pour vivre, et puis c’est tout !
Tout homme eût succombé sous un semblable coup.
Le noble et grand vieillard avait l’âme trempée
Comme sa hache d’arme et comme son épée ;
Vieillesse et désespoir sont deux fardeaux pesants :
Clisson ne ploya pas et vécut ses cent ans . »
-« Oh ! tant d’ingratitude est-elle donc croyable ?
Je t’ai laissé finir l’histoire lamentable :
Je voulais à tout prix l’apprendre jusqu’au bout.
Mais je suis indigné, mère, et le sang me bout. »
-« Ne sais-tu pas-, mon fils, que la reconnaissance
Fleurit, bien rarement sur la toute-puissance ?
Maîtres de tout par Dieu, les rois ne font état
Que de leur intérêt ou des raisons d’État.
Puis saint Louis, trompé par ses juges, put croire
L’arrêt juste et, qui sait ? peut-être méritoire :
Clisson avait pour lui sa conscience et Dieu ;
Mais qu’est-ce que cela contre un texte d’aveu ?
Dans tous les cas, il faut pardonner une injure. »
-« Je n’en pardonnerai jamais, moi, je le jure.
Si jamais quelqu’un ose attenter à mon droit,
Que Dieu l’ait fait roi, duc ou baron, quel qu’il soit,
Je ne le lâche pas qu’il n’en ait rendu compte :
Il faudra qu’à mes pieds il en boive la honte.
Contre le monde entier dussé-je lutter seul,
Eh bien ! je lutterai comme a fait mon aïeul.
Mon âme au déshonneur préfère la défaite. »
La chrétienne trouva la réponse mal faite,
Mais la mère, pressant son enfant sur son sein,
Scella d’un gros baiser ce serment peu chrétien.
XI. – LA CULTURE D’UNE AME.
C’est ainsi qu’au donjon Olivier et sa mère
Par de longs entretiens trompaient l’absence amère.
Tous les enfants de Jeanne ont part à son amour :
Chacun, sans l’épuiser, peut y boire à son tour,
Mais l’égalité même aux nuances se prête,
Et pour Olivier coule une source secrète.
S’il est le préféré, ce n’est pas sans raison,
Car il doit être un jour le chef de la maison,
Puisque la Mort, hélas ! dans un cruel caprice,
Est venue, à sept ans ! lui prendre son Maurice.
Les aînés ont leurs droits ; tous les vœux sont pour eux.
Puis son fils est si beau, si fier, si vigoureux !
Avec cet air hautain, qu’un sourire tempère,
Il rappelle si bien tous les traits de son père !
Et son âme ! Et son cœur ! Quels éclairs ! Quels élans !
Que de traits de bonté, de mots étincelants !
Comme dans cet enfant on sent bien le grand homme !
Cherchez-en un meilleur dans Athènes ou Rome.
Peut-être n’est-il pas tout à fait sans défaut :
Il s’emporte un peu vite et s’estime un peu haut.
La colère et l’orgueil ! C’est vrai : leurs fortes pousses
Menacent d’étouffer un jour les vertus douces ;
Mais prenez-les à temps, sachez les diriger,
Les défauts vont bientôt en vertus se changer :
L’orgueil ne sera plus que l’amour de la gloire
Et la colère aura pour fille la victoire.
Aussi, Jeanne, attentive, examine avec soin
Dans l’âme de son fils tout sentiment qui poind,
Et, pendant tout le jour, son active tendresse
Sarcle, émonde, soutient, développe ou redresse.
Ainsi le laboureur va voir chaque matin
Les progrès que la nuit a fait faire au jardin :
Si telle graine sort, si telle plante pousse,
Si le pois succulent se gonfle dans sa gousse,
Si la greffe prend bien sur l’arbre ou le rosier,
Si quelque rameau penche et réclame l’osier,
Si la sève s’emporte en pousse trop gourmande,
Si le plant de la veille a bien l’eau qu’il demande,
Que sais-je ? tant d’objets sollicitent ses soins !
Mais si sa main devine et remplit leurs besoins,
Pour le récompenser des peines qu’il se donne,
Que de fleurs au printemps, que de fruits à l’automne !
Comme lui, Jeanne espère et, triomphant déjà
Des vertus qu’en son fils son amour protégea,
Sa main dans ses cheveux avec volupté joue ;
Puis, attirant soudain la ronde et fraîche joue,
Jeanne y colle un baiser long et retentissant,
Épanchement d’un cœur trop plein et bondissant.
Dans son sein ce baiser semble allumer la fièvre :
Courbant sur ses genoux l’enfant qui rit, sa lèvre
Se pose avidement sur son cou gracieux,
Sur ses cheveux bouclés, sur ses deux beaux grands yeux.
De son époux absent sans doute la pensée
Ajoute à ses transports une ardeur insensée ;
Car ses baisers de flamme, entrecoupés de cris,
N’ont un moment cessé que pour être repris :
On dirait un autour qui dévore sa proie…
Mais les cris qu’on entend sont tous des cris de joie.
Enlevant dans ses bras le fruit de ses amours,
Jeanne le baise encore, et le baise toujours ;
Et l’enfant, enivré de ses chaudes tendresses,
La serre à l’étouffer et lui rend ses caresses.
Le soleil du couchant, traversant les vitraux,
Projette sur les murs leurs couleurs aux tons chauds,
Et Jeanne avec son fils rayonne de lumière,
Comme Jésus enfant sur le sein de sa mère.
Oh ! si l’époux qu’on pleure entrait dans ce moment,
Vous le verriez sourire à ce groupe charmant,
Puis, enlaçant ensemble et son fils et sa femme,
Sur leurs fronts rapprochés verser toute son âme.
Mais le bonheur complet est bien rare ici-bas :
Le groupe se sépare, et l’époux ne vient pas.
XIIN – LE TOURNOI.
Une trêve a mis fin à la guerre civile ;
Les ménestrels errants chantent de ville en ville,
Et Jeanne, sur la tour un soir assise au frais,
Écoute avec bonheur cet hymne de la paix :
Entendez-vous là-bas la cloche ?
Voyez-vous là-bas ces lueurs ?
Contre l’ennemi qui s’approche,
Brûlant les toits de proche en proche,
Est-ce un appel aux braves cœurs ?
Ce n’est pas la voix haletante
Du tocsin dans le clocher noir ;
Cette sonnerie éclatante
De bonheur semble palpitante :
Elle ne chante que l’espoir.
Le vent sur le feu qui flamboie
Ne tord aucun noir tourbillon ;
Ces brasiers, dont la cime ondoie,
Ce sont aux champs des feux de joie,
Déployant leur gai pavillon.
Et dans les villes, ces trompettes
Sonnant au coin des carrefours,
Elles n’annoncent que des fêtes
Pâles chagrins, fuyez et faites
Place au cortège des amours.
Voilà trop longtemps que nos guerres
Font porter le deuil au pays ;
Jeunes amantes, et vous, mères,
Vous toutes qui pleuriez naguères,
Revêtez vos brillants habits.
Ils sont passés les jours d’épreuve ;
L’arc-en-ciel a brillé sur nous :
Quitte l’église, ô pauvre veuve ;
Voici venir, en robe neuve,
La fiancée et son époux.
De vos champs arrachez les herbes,
Laboureurs, creusez vos sillons :
Vos moissons jauniront superbes ;
Ne redoutez plus pour vos gerbes
Le pied lourd des longs bataillons.
Car dans le ciel, ô ma Bretagne,
Plane la Paix aux tresses d’or ,
Et l’Abondance, sa compagne,
Dans tes villes, sur ta campagne,
Verse en souriant son trésor.
Oui, l’hymne avait raison, oui, la paix était faite,
Et pour Jeanne et ses fils ce fut un jour de fête ;
Pourtant le cher absent partait pour un tournoi.
Mais Jeanne sait qu’il part invité par le Roi !
DEUXIÈME PARTIE
LE SUPPLICE
I-LA PLACE DU GRAND-CHATELET.
C’EST un de ces matins si beaux, où tout flamboie,
Dans les cieux le soleil et dans les cœurs la joie ;
Le vent est doux et frais, l’air est d’un bleu profond ;
Il semble qu ‘on va voir passer Dieu dans le fond.
Sa bonté se répand partout : pas un coin sombre ;
Tout prend un air de fête et sourit, même l’ombre,
Et l’horrible prison, le Grand-Châtelet noir
A ces rayons s’égaie et laisse entrer l’espoir.
Tel l’homme au cœur glacé que l’ambition ronge ;
Si quelque intrigue heureuse, une promesse, un songe
Rapproche de sa main son but, le noir sillon
De son front dur s’éclaire, et vous le croiriez bon.
Hommes, femmes, enfants accourent sur la place,
Où deux échafauds sont dressés et se font face.
La foule incessamment s’accumule et s’accroît.
—Est-ce une fête? — Non. — Un supplice ? — On le croit.
On va couper un cou ? — Tout au plus va-t-on pendre ;
Voyez-vous ce drap noir qu’on s’empresse d’étendre ?
Le sang le tacherait. — Qu’est-ce enfin ? Le sait-on
— Oui ! l’on va dégrader un chevalier breton.
J’étais là, quand hier on l’amena du Temple
Au Châtelet . On dit qu’on veut faire un exemple…
Le pauvre homme ! il pliait sous le poids de ses fers.
Il doit être jugé ce matin par ses pairs.
—Qu’a-t-il fait ? – Je ne sais.— Et son nom ? – Je l’ignore.
Et le marteau battait sur le poteau sonore :
Les charpentiers, pressés, se hâtaient d’en finir,
Car, dit-on, le cortège allait bientôt venir.
Mais rien ne vient, et l’heure ermuyeusement coule.
Les voilà ! —Grand tumulte et grands cris dans la foule.
On se presse, on se pousse, on s’étouffe. On veut voir :
Être alors trop petit, c’est presque un désespoir.
Oh ! comme on porte envie aux gentes damoiselles,
Qui, sous leur coiffe haute et leurs riches dentelles,
Ornent chaque croisée et peuvent, en causant,
Suivre en tous ses détails ce spectacle imposant.
Une troupe d’archers à cheval — dans la place
Débouche, et, refoulant ces flots de populace,
Ouvre un libre chemin jusqu’aux deux échafauds.
Le peuple, se garant comme il peut des chevaux,
Forme une double haie, où passe le cortège.
Sur un des échafauds, qu’un riche dais protège,
Montent, d’un pas égal et lent, vingt chevaliers,
Tous richements vêtus et fiers de leurs colliers :
Cœurs braves et loyaux, sans taches, sans alarmes .
Derrière eux un héraut et deux poursuivants d’armes.
Chacun a pris son rang; les juges sont assis :
L’or de leurs éperons brille sur les tapis.
Sur l’autre échafaud, grimpe, à l’aide d’une échelle,
Un homme grand et fort, et qui pourtant chancelle,
Comme si quelque chaîne alourdissait son pied,
Ou que dans la torture on l’eût estropié.
Cet homme est revêtu d’armes éblouissantes,
Et le soleil y met des flammes jaillissantes.
L’armure est au complet : du heaume à l’éperon,
Rien n’y manque; on voit bien que c’est un haut baron.
Et voici son écu que sur l’échelle on hisse :
L’écu déshonoré suit son maître au supplice ;
Sur un ignoble pal il doit être attaché ;
Mais, l’homme n’étant pas légalement taché,
L’écu restera droit pendant une heure encore,
Et d’un dernier reflet la gloire le décore.
Par un large escalier, où s’étend le drap noir
De l’infâme échafaud, qu’hélas! le désespoir
Et la honte ont trempé trop souvent de leurs larmes,
Sont montés un héraut et trois poursuivants d’armes,
Ornés de leurs émaux et richement parés.
Ils vont s’asseoir au fond, sur des bancs séparés.
Le spectacle est si beau, si douce est la journée,
Que l’âme est au plaisir plus qu’à l’effroi tournée,
Et tous ces chevaliers, tous ces hérauts brillants,
N’excitent que la joie et les propos bruyants :
La foule émerveillée applaudit leur costume.
Un des poursuivants tient un grand bassin qui fume :
Beau sujet pour causer et rire, car pourquoi
Cette eau bouillante aux mains d’un officier du roi ?
On en rit sur la place, on en rit aux fenêtres.
Mais les rires bientôt se glacent ; douze prêtres,
Pâles, en surplis blancs, tenant en croix leurs mains,
Gravissent, front baissé, les lugubres gradins.
Tous sont silencieux ; plusieurs versent des larmes.
Au signe que du doigt leur fait le héraut d’armes,
Ces fantômes muets vont lentement s’asseoir
Autour de l’inconnu debout sur le drap noir.
Comptez-les : ils sont six à gauche et six à droite.
D’une froide sueur toute chair devient moite ;
Car on comprend enfin, malgré ce ciel brillant,
Qu’ici va se passer quelque drame effrayant.
II. – L’ACCUSATION.
Aux bancs des chevaliers, le premier par son grade
Fait un signe ; un héraut s’avance sur l’estrade.
De son clairon de cuivre il sonne par trois fois,
Puis dans ce grand silence il élève la voix,
Menaçant de la hart, de la geôle ou des verges,
Serfs, manants et bourgeois, soit mariés, soit vierges.
Quiconque, par émeute ou propos sonnant mal,
Troublerait dans ses faits le noble tribunal.
Il se tait et s’assied. — Sur l’échafaud infâme,
L’autre héraut s’avance à son tour et proclame,
Après avoir trois fois sonné de son clairon,
Que les hommes et Dieu vont juger le félon.
Alors, au nom du Roi, son seigneur et son maître,
Il accuse tout haut l’homme que voilà, d’être
Noble faux, déloyal, foi-mentie, à la fois
Vers Philippe de France et vers Charles de Blois.
« Charles avait reçu son serment d’homme-lige,
Le lien le plus fort par où l’homme s’oblige ;
Philippe, qui l’aimait, l’avait fait chevalier :
Et tous ces nœuds sacrés qui devaient le lier,
Son pied les a foulés comme choses profanes.
Un jour, par les Anglais pris au siège de Vannes,
Avare de son or, ce fut la trahison
Qui lui servit de clef pour ouvrir sa prison.
Croyant s’être assuré les profits du mystère,
Il a vendu la France au prince d’Angleterre :
Heureusement le Roi fut à temps informé
Et put rompre le plan par le traître formé.
La mort serait trop peu pour tant de félonie :
Il faut déshonorer le lâche. En vain il nie ;
Tous ses actes honteux, on les a retrouvésn
Son scel est reconnu, tous les faits sont prouvés.
Aussi, sans que jamais nulle prière y serve,
Le Roi l’a condamné sans merci, sans réserve.
Devant ce tribunal si le félon paraît,
Ce n’est pas pour chercher si le traître a forfait :
C’est sûr; la mission qui vous est confiée,
C’est de voir si la foi lâchement oubliée
Permet que ce faux noble, en mourant, laisse ou non
Son blason sans souillure et sans tache son nom.
En un mot, s’il est là, tremblant sur cette estrade,
C’est pour que vous jugiez s’il faut qu’on le dégrade.
— « Oui, je tremble, c’est vrai! mais ce n’est pas de peur,
C’est d’indignation, héraut lâche et trompeur !
Tu tortures les faits sans honte ni vergogne ;
Mais, puisqu’on t’a payé, remplis donc ta besogne.
Seulement je le crie à tous : Cet homme ment. »
— « Baron, défendez-vous, mais pas d’emportement ;
Discutez les griefs dont ce héraut vous charge :
Si votre crime est grand, notre indulgence est large,
Et vous pouvez parler en toute liberté ;
Mais écartez l’injure et l’excès d’âpreté,
Sinon le tribunal ne saurait vous entendre. »
— « Chevalier, vous raillez ! A quoi bon me défendre ?
Vous croyez-vous le droit de rendre un jugement ?
Ce héraut vous l’a dit pourtant bien clairement :
Cette cérémonie est tout extérieure.
Le Roi m’a condamné, le Roi veut que je meure ;
Je mourrai. Nul ne peut rien pour ou contre moi.
Vous êtes une hache entre les mains du Roi :
Frappez, sans recourir à de vains subterfuges,
Et qu’au moins les bourreaux ne se disent pas juges ! »
Dans la foule à ces mots courut comme un frisson,
Et quelqu’un s’écria : « Très-bien, brave Clisson ! »
Les juges à leur front sentent monter la honte ;
Mais leur chef plus adroit ou la cache ou la dompte :
— « Sergents d’armes, veillez, et, s’il crie à nouveau,
Saisissez le coupable et livrez-le au bourreau.
Quant à vous, accusé, le tribunal pardonne
Les mots durs échappés d’une tête bretonne ;
Mais en nous respectant faites-vous respecter :
On voit bien rarement l’innocent s’emporter.
Serait-il vrai, d’ailleurs, que votre mort fût sûre,
Puisque du tribunal dépend la flétrissure,
Expliquez-lui les faits qui vous font accuser :
S’il ne peut vous absoudre, il peut vous excuser. »
— « O mes nobles aïeux, dont l’origine antique
Se perd dans les splendeurs de la fable héroïque ;
Quand, aux bords de l’Escaut, vous vous faisiez des rois
D’un de vos compagnons porté sur le pavois ;
Quand vous veniez chasser les Romains de la Gaule ;
Quand l’Empire croulait au choc de votre épaule ;
Quand vous vous partagiez le pays en vainqueurs
Et que vous mesuriez votre part à vos cœurs ;
Quand, imposant à tous le droit de votre épée,
Vous brisiez d’un bras fort toute force usurpée ;
Quand votre gloire était le prix de cent combats ;
O mes nobles aïeux, vous ne prévoyiez pas
Qu’un jour un tribunal aurait la hardiesse
De venir marchander à vos fils la noblesse !
» Chevaliers, votre espoir est vraiment peu sensé.
Dieu même est impuissant, oui, contre le passé.
Il peut à tout jamais en effacer la trace ;
Le fait survit, et seul le souvenir s’efface :
Sous l’oubli, ce qui fut n’en a pas moins été.
Mais vous, la force manque à votre volonté,
Et vous n’effacez rien !… L’arbre de ma noblesse,
Vous pouvez le couper, si sa grandeur vous blesse ;
Contre son souvenir vous êtes impuissants :
La gloire a des rameaux sans cesse renaissants.
Quand vous m’enlèveriez et mes fiefs et mes titres,
Du renom qui m’attend vous n’êtes pas arbitres ;
Malgré tous vos arrêts, puisqu’il a lui, mon nom
Est un astre éternel promis à l’horizon,
Et tous mes descendants, jusqu’à ce que tout croule,
Brilleront d’un reflet que n’aura pas la foule. »
— « Non ! quand un noble aux lois de l’honneur a forfait,
Il efface ou salit ce que sa race a fait. »
III. – LA DÉFENSE.
« Je laisserai tomber à mes pieds cette injure.
Je me dis innocent et le suis, je le jure.
Oui, soyez mes témoins, soleil brillant, ciel bleu…
Mon serment va plus haut et j’en atteste Dieu.
Mais puisque vous voulez qu’ici je me défende,
Écoutez, et voyez si l’injustice est grande.
Pour Philippe de France et pour Charles de Blois,
J’ai versé bien du sang et fus blessé vingt fois.
Quand un excès d’audace et le sort de la guerre
Me firent prisonnier d’Edouard d’Angleterre,
Si son cœur généreux m’offrit la liberté,
Le mien, en acceptant, conserva sa fierté.
Ce ne fut pas un don, ce ne fut qu’un échange :
Stafford fut ma rançon… Vraiment, c’est chose étrange
Qu’aux nobles actions on cherche un motif bas.
J’admirais Edouard, mais ne lui cachai pas
Que je le combattrais et toujours et quand même,
Tant qu’il ferait la guerre aux deux pays que j’aime.
» L’entretien avait lieu devant plus d’un témoin.
Qu’on en fasse venir… Plusieurs ne sont pas loin !
Si dans ce tribunal aucun d’eux n’a de siège,
Il en est au tournoi, ce tournoi , lâche piège,
Où l’on m’a fait tomber surpris et désarmé !
Ah! l’on aurait eu peur d’un Breton alarmé !
En effet, notre main, pourvu qu’elle soit prête,
Sait bien, et contre tous, protéger notre tête ;
Et j’ai de mes aïeux pris plus d’une leçon. »
La voix de l’inconnu cria : « Très-bien, Clisson ! »
— « Accusé, calmez-vous; surtout pas de menace :
La honte prend souvent le masque de l’audace…
Nous ne ferons ici venir aucun témoin :
Pour des faits évidents il n’en est pas besoin.
Oui, vos discours publics ont été magnanimes :
Ce n’est pas au grand jour que poussent les grands crimes.
Mais si l’ombre a couvert le traité déloyal
Où, faussant les devoirs d’un fidèle vassal,
Vous vendiez aux Anglais, pour de l’or, l’espérance
De vaincre un jour, par vous, la Bretagne et la France,
Vous ne pouvez nier ce dessein criminel,
Car voici votre pacte et voici votre scel. »
— « Mais cette pièce est fausse, et tu le sais, parjure!
On a, contre moi noble, employé la torture ;
L’infâme brodequin, oui ! m’a broyé le pied ;
Le bourreau, moi baron ! m’a tout estropié ;
Et, dans tous ces tourments qu’ordonnait votre maître,
J’ai renié ce scel. Pour me le faire admettre,
L’on m’a promis pardon, l’on m’a promis merci ;
Eh bien ! j’ai dit là-bas, comme je fais ici,
Et je dirais encor sur le bord de ma fosse,
Et je dirai toujours que cette pièce est fausse.
» Je ne sais pas pourquoi le Roi veut mon trépas ;
Mais enfin qu’il me tue et ne m’outrage pas.
Lui, qui m’ose imputer une œuvre déloyale,
A-t-il donc respecté sa parole royale ?
Quand son fils m’invitait, en son nom, au tournoi,
Je devais me fier pleinement à leur foi,
Et je vins seul : j’aurais rougi même d’un doute.
Lorsqu’un prince convie un noble à quelque joute,
Pour quiconque prend part au glorieux déduit,
Une invitation, mais c’est un sauf-conduit !
Quitte à régler plus tard ou la faute ou l’offense.
Et l’on est venu, moi, m’arrêter sans défense,
Au moment où sortant de la lice, vainqueur,
Je laissais reposer et mes bras et mon cœur.
Pour un roi, l’action n’est ni juste, ni belle. »
— « Baron, vousvous trompez ; l’ordonnance est formelle :
Que la preuve soit faite ou qu’on n’ait qu’un soupçon,
Quiconque a commis faute et taché son blason,
Si d’entrer au tournoi il a la folle audace,
Non-seulement il peut être arrêté sur place,
Mais on doit le chasser, après l’avoir battu. »
— « Oui, quand il vient pour voir; non, s’il a combattu.
Il fallait m’arrêter à l’examen des armes .
Le duc de Normandie a répandu des larmes,
En voyant vos soldats porter la main sur moi,
Car ce méfait tachait non pas moi, mais le Roi.
Il s’est jeté plus tard aux genoux de son père,
Et, s’il n’a pu fléchir une aveugle colère,
Pardonnez-lui, mon Dieu, de m’avoir amené :
Il ne connaissait pas le félon couronné…
» Laissez-moi !… Je n’ai plus que quelques mots à dire.
Sur le bord du tombeau je ne veux pas maudire,
Mais Dieu remplit mes yeux d’une étrange clarté :
De l’avenir pour moi le voile est écarté.
Quel est là-bas ce spectre à la face hagarde ?
Philippe de Valois, roi de France, prends garde :
Ma vengeance te suit en tout temps, en tout lieu,
Et tu vieilliras vite à son regard de feu.
» Toi, de qui l’on vantait l’humeur sans cesse égale,
Ton œil est toujours sombre et ton front toujours pâle ;
Toi, qu’on voyait partout vainqueur et tout-puissant,
Tu fuis, et ton pied glisse en des mares de sang.
Puisqu’il te plaît de voir tomber de nobles têtes,
Sois content, car la Mort te prépare des fêtes
Oui, par milliers un jour tes barons tomberont,
Et ton cercle royal branlera sur ton front .
Ah! tu regretteras ton inj uste colère,
Cruel, qui vas priver mes enfants de leur père.
» Et vous, beaux chevaliers, plus prudents que hardis,
Qui, courbant sous le joug des fronts abâtardis,
Vous laissez atteler aux fonctions de juges,
Hâtez-vous de chercher quelques secrets refuges.
» Je laisserai deux fils, orphelins de par vous ;
Leur mère leur dira : Si je n’ai plus d’époux,
Si vous êtes privés des caresses d’un père,
Si tous nous n’avons plus que honte et que misère,
C’est que vingt chevaliers ont, pour plaire à leur roi,
Pris ses désirs pour règle et ses ordres pour loi ;
Et notre unique ami, leur lâche complaisance
L’a tué, sans pitié, malgré son innocence…
» Tremblez, beaux chevaliers, car mes fils ont grandi :
Leur corps est vigoureux et leur cœur est hardi.
Vous leur appartenez, oui, tous tant que vous êtes !
Sous leur glaive vengeur tomberont vos vingt têtes.
Vous vous cachez en vain : ils vous reconnaîtront
Aux taches de mon sang qui marquent votre front…
» Jouissez de ma honte et n’en soyez pas sobres ;
Car votre mort à vous sera pleine d’opprobres
A ce point, que vos fils, honnis et dépouillés,
Rougiront de porter des blasons trop souillés.
Ne pouvant les laver, malgré toutes leurs larmes,
Ils quitteront vos noms, ils quitteront vos armes.
Personne ne saura quels vous avez été ;
L’on ne connaîtra plus que votre lâcheté…
» L’oubli vous offrira ses ignobles refuges :
En racontant ma mort, si l’on cherche mes juges,
L’Histoire répondra, dans ses justes dédains :
On ne sait plus les noms de ces vingt assassins ! »
Et cet homme avait pris une pose si fière,
Que ses juges n’osaient relever leur paupière.
Ils avaient peur de voir, s’ils entr’ouvraient les yeux,
L’Ange exterminateur planant au-dessus d’eux.
Ils sentaient se débattre en eux leur conscience ;
Mais, esclaves liés à la toute-puissance
Et voulant obéir à n’importe quel prix,
Ils tremblaient d’épouvante et s’avouaient maudits.
Et l’accusé sur eux fixait son regard calme !
On eût dit un martyr assuré de sa palme.
La foule palpitante avait comme un frisson,
Et l’inconnu cria : « Très-bien, brave Clisson ! »
Ce cri, retentissant dans l’effrayant silence,
Rompt enfin la stupeur.
— « Oh! c’est trop d’insolence!
Amenez le coupable au pied de l’échafaud,
Et qu’il soit châtié… Je le veux; il le faut. »
On rechercha longtemps l’inconnu dans la foule,
Qui, comme l’Océan tourmenté par la houle,
Heurtait dans tous les sens ses flots tumultueux.
Quelques hommes voulaient, d’un choc impétueux,
Renverser l’échafaud et sauver la victime,
Debout, les bras croisés, fière et vraiment sublime ;
Mais le peuple avait peur des soldats bien armés :
Le tumulte et les cris furent bientôt calmés…
Le peuple ! oh ! non ! tremblant sous le pied qui le foule,
Ce n’était pas un peuple, hélas ! mais une foule.
L’inconnu, dont la voix , bravant le tribunal,
Lançait à l’accusé son salut cordial,
Déjoua les sergents par sa pose immobile.
Le juge fit cesser la poursuite inutile ;
Mais aux plis de sa lèvre, à son œil en courroux,
Les sergents, revenus près de lui, tremblaient tous.
Brave et loyal Herblain, sois content, car ton maître
Sous ton habit d’emprunt a su te reconnaître :
Ton regard, avec lui fréquemment échangé,
Lui dit qu’il est compris et qu’il sera vengé.
IV. – LA CONDAMNATION.
Cependant le clairon réclame le silence.
Des vingt juges l’on va lire enfin la sentence ;
Car entre eux, pour la forme, ils ont délibéré,
Mais depuis plusieurs jours l’arrêt est préparé.
Le héraut, se tournant vers la foule anxieuse,
Lit tout haut cet arrêt d’une voix lente et creuse :
« Au nom du roi de France, et le Ciel invoqué,
Le tribunal, suprême et dûment convoqué ;
Vu le procès instruit dans la prison du Temple
Et sans qu’il soit besoin d’une enquête plus ample ;
Ouï l’accusateur en ses conclusions
Et l’accusé lui-même en ses négations ;
Considérant qu’il est notoire et manifeste
Que ledit accusé, lequel sans droit proteste,
A commis félonie envers son souverain,
Par un pacte nié, mais scellé de sa main
Et qui, représenté, fait preuve de sa trame ;
Déclare devant tous le susdit traître infâme,
Atteint et convaincu de lèse-majesté ;
Par quoi, voulant punir ce félon détesté,
Prononce contre lui la peine capitale,
Proclame tous ses biens propriété royale,
Ordonne que ses fils, de noblesse déchus,
Seront de tous honneurs à tout jamais exclus ;
Enfin dit que celui qui vendait sa patrie
Doit être dégradé de sa chevalerie.
Le présent jugement sera, selon la loi,
Exécuté ce jour… et Dieu sauve le Roi ! »
Quand le héraut se tut, la joie et l’épouvante
Soulevèrent les flots de la foule mouvante.
Cent avis opposés, éclatant à la fois,
Se choquaient bruyamment dans ce chaos de voix :
Tumulte de forêts que le vent bouleverse.
L’émotion était profonde, mais diverse :
Quelques cœurs généreux bondissaient indignés ;
Un grand nombre attendaient, doutants ou résignés ;
Mais la masse, soumise aux décrets de son maître,
Cria : « Vive le Roi ! Honte et mort à ce traître ! »
Le condamné lui jette un regard de dédain
Et commande du doigt silence au vieil Herblain,
Dont le visage pâle est sillonné de larmes.
Sur l’ordre de son chef, un des poursuivants d’armes,
Prenant l’écu qui brille au bord de l’échafaud,
Le renverse et le pend au pal la pointe en haut.
Le maître de l’écu sous cette flétrissure
Frémit, mais cache à tous sa profonde blessure.
Le clairon du héraut de nouveau retentit ;
On se tait. De la cour le chef se lève et dit :
« Condamné, je vous dois un avis. Votre crime
Vient d’être constaté, d’une voix unanime ;
Cet arrêt, sans appel, ne peut se discuter :
Vous n’avez pas le droit même de protester.
Donc, à moins que le Roi, pardonnant votre offense,
Ne daigne sans retard déployer sa clémence,
Priez Dieu, car ce soir vous serez devant lui ;
Votre sort est fixé : vous mourrez aujourd’hui.
Mais, condamné, la cour consent à vous entendre
Sur le genre de mort que vous devez attendre.
A crime avilissant châtiment vil est dû,
Et la loi stricte veut que vous soyez pendu ;
Toutefois, par égard pour votre noble épée,
Vous ne serez pendu que la tête coupée. »
— « Vraiment, beaux chevaliers, vous êtes indulgents !
Veuillez me pardonner mes propos outrageants ;
Quand on le connaît bien, le tribunal y gagne.
» Un des plus hauts barons qu’honore la Bretagne,
Un acte déloyal le livre entre vos mains ;
Ce noble est innocent ; vous en êtes certains :
Et vous dites lui faire une faveur bien grande
De lui trancher la tête avant qu’on ne le pende !…
Une épée ! un champ-clos ! et contre tous je tiens
Que c’est vous qu’on devrait pendre comme des chiens !
» Pardonnez-moi, mon Dieu, je crois que je m’emporte. »
Et tombant à genoux, il dit d’une voix forte :
« Jésus-Christ, mon Sauveur, vous qu’on vit autrefois
Mourir déshonoré sur une infâme croix,
Et mourir innocent, pour les péchés des hommes,
Pour nous plaindre après vous,qu’est-ce donc que nous sommes ?
» A Charles, à Philippe ayant promis ma foi,
Je n’ai jamais trahi ni ce duc, ni ce roi ;
Pour la dernière fois, devant tous je le jure :
Que l’enfer, si je mens, punisse mon parjure !
Mais, si je fus toujours un fidèle vassal,
Un soldat courageux, un chevalier loyal ;
Si mon bras défendit partout, fier et robuste,
Ce qui me semblait vrai, ce qui me semblait juste ;
Si je puis défier les jugements humains :
Je dépose, en tremblant, mon âme entre vos mains,
O mon Dieu; car, hélas! en actes, en pensées,
Vos lois furent par moi trop souvent offensées.
Frappez ; j’ai mérité toute punition :
Ma mort infâme n’est qu’une expiation.
» Que je doive périr par le glaive ou la corde,
Jésus, je me confie en ta miséricorde.
Où pourraient nos péchés trouver juge plus doux
Qu’un Dieu qui nous aima jusqu’à mourir pour nous ?
Intercédez pour moi, douce Vierge Marie !
Mais pour d’autres encor souffrez que je vous prie.
Ma femme, mes enfants , mes uniques amours,
Ma mort va les laisser aujourd’hui sans secours…
Quand chacun pleurera soit l’époux, soit le père,
Que votre douce voix leur dise encore : Espère ! »
Et l’homme agenouillé se relevant alors :
— « Chevaliers, j’ai fini ; je vous livre mon corps.
» Lorsqu’au prêtre hier soir j’ai confessé mes fautes,
Mon âme a pris son vol vers des cimes si hautes,
Que j’avais en mépris tous les honneurs humains ;
Rois, ducs et chevaliers, tous me semblaient des nains,
Ou plutôt des cirons disputant un atome :
La gloire n’était plus, pour moi, même un fantôme ;
Et je fis sans regret à mon saint confesseur
Le serment que, malgré tout propos agresseur,
Tout traitement inique… et même tout outrage,
Je saurais mettre un frein à mon ancien courage
Et supporterais tout, en souvenir de Dieu.
Ce matin, malgré moi, j’ai violé mon vœu ;
Me taire m’a paru la plus lourde des tâches,
Quand je vous ai trouvés si menteurs et si lâches.
» Vous ne me verrez plus m’emporter désormais :
Baron, j’ai protesté; chrétien, je me soumets.
Oui, je me défirai de ma tête bretonne ;
Pardonnez-moi donc tous, comme je vous pardonne.
» Toutefois, n’espérez du serment que je fis,
Ni le pardon de Dieu, ni celui de mes fils :
Je ne puis arrêter ce qui sur vous doit fondre,
Et de moi seul ici, juges, je peux répondre.
» Prodiguez contre moi l’outrage et les tourments :
Pour vous, je ne vis plus ; vous verrez si je mens !
Que ma décision vous semble grande ou folle,
De moi vous n’aurez plus une seule parole.
Allons, acharnez-vous sur mon corps ou mon nom ;
Moi, je vous ferai voir ce que c’est qu’un Breton. »
V. – LA DÉGRADATION.
Les vingt juges restaient cloués sur leur estrade ;
Leur chef balbutia tout bas : « Qu’on le dégrade ! »
Et dans l’affreux silence on entendit alors
Les prêtres qui chantaient les vigiles des morts.
Sous ce soleil ardent, sous ce ciel bleu sans ombre,
Leur voix effrayait plus que dans l’église sombre.
L’épouvante glaça tous les cœurs, quand ces chants
Remplirent l’air de sons lugubres et traînants.
Dans l’église du moins l’espérance se glisse :
Là , c’est une prière ; ici, c’est un supplice.
L’âme, pour qui l’on dit les vigiles des morts,
Dieu ne l’a pas jugée… Elle est là, dans ce corps
Que vous voyez debout, grand, fier, calme et robuste,
Et qui vous fait pâlir sous son regard auguste.
Cet homme, est-ce un martyr et non un criminel ?
L’échafaud va-t-il donc se changer en autel ?
Le chœur fit une pause après le premier psaume.
Le héraut, se haussant, dépouille de son heaume
Le condamné muet, qui ne se défend pas.
Son front nu reste haut ; ceux des juges sont bas,
Et leur chef seul emprunte à l’audace son masque.
Le héraut montre à tous, par son cimier, le casque,
Et crie à pleine voix : « Peuple loyal et bon,
Ce casque, c’est celui d’un chevalier félon,
Le casque d’un soldat lâche et traître à son maître. »
Sur la place des voix crièrent : « Honte au traître ! »
Les juges à ces cris levèrent leurs regards,
Mais leurs yeux effrayés demeurèrent hagards ;
Ils avaient espéré voir enfin, sous sa honte,
Le condamné rougir; mais rien, rien ne le dompte :
Sous ses beaux cheveux gris son grand front détesté
Se dresse toujours calme et plein de majesté.
Alors sous le marteau l’on fit briser le heaume ;
Et le lugubre chœur chanta le second psaume.
Un silence se fit, dès qu’il fut terminé.
Le héraut, s’avançant, enlève au condamné,
Muet sous le dédain qui gonfle sa narine,
Le riche collier d’or flottant sur sa poitrine :
Puis crie à toute voix : « Vous voyez ce collier ?
C’est celui d’un félon et mauvais chevalier,
Le collier d’un soldat lâche et traître à son maître. »
Quelques voix seulement crièrent : « Mort au traître ! »
Le héraut, du collier brisant les longs anneaux,
Le jette, et fait semblant d’en fouler les morceaux ;
Mais on voit qu’il les suit d’un œil ivre de joie,
Car ce collier rompu, c’est son prix, c’est sa proie.
Le condamné sourit et, près d’entrer aux cieux,
S’étonne qu’un peu d’or semble si précieux.
Mais du troisième psaume, hélas! le chant commence ;
Il est bientôt suivi d’un troisième silence.
Le héraut hésitant va vers le condamné,
Mais du collier son œil ne s’est pas détourné.
Il se hâte d’ôter la riche cotte d’armes
Et la déchire… Herblain seul en verse des larmes.
Quand ce cri retentit : « Peuple loyal et bon,
Cette cotte appartient au chevalier félon
C’est celle d’un soldat lâche et traître à son maître » :
Nulle voix cette fois ne cria : « Mort au traître! »
L’austère condamné, de son œil fier et doux,
Glaçait les spectateurs ou les dominait tous.
Les juges s’indignaient de sa pose si grave ;
Mais comment triompher du dédain qui les brave ?
Il leur est interdit de hâter les moments
Où doivent commencer enfin les vrais tourments.
La justice est en eux désarmée et honnie,
Mais il leur faut subir cette cérémonie ;
Leur arrêt est formel : cet homme, on ne peut pas,
Sans qu’il soit dégradé, le livrer au trépas.
Juges, soyez heureux! sous son air froid et calme,
Croyez-moi, le martyr a bien gagné sa palme ;
Car le supplice est grand, pour le cœur d’un Breton,
De s’entendre appeler déloyal et félon.
Juges, si vous osiez le regarder en face,
De son àpre douleur, oui, vous verriez la trace.
Que ce soit patience ou que ce soit orgueil,
Sa mâle volonté cache à tous son grand deuil ;
Mais sous ses cheveux gris, le long de chaque tempe,
D’une froide sueur son front brûlant se trempe :
L’orage gronde au cœur et souvent monte aux yeux.
Cet homme souffre bien, quoique silencieux !
Cependant sous le chant monotone et lugubre,
Qui répand tant d’effroi dans l’air tiède et salubre,
Qu’il glace plus le sang que ne ferait la nuit,
La dégradation lentement se poursuit.
Le héraut, sans pitié, pièce à pièce dépouille
Le glorieux baron, que le déshonneur souille
Et sur qui sont fixés mille avides regards.
Ce sont les gantelets, puis ce sont les brassards,
Puis c’est le baudrier et la riche ceinture ;
Maintenant c’est la dague et l’épée… O torture !
En les voyant ainsi flétrir aux yeux de tous,
Le fier Breton ne peut réprimer son courroux :
Il arrache au héraut son épée, et la baise…
Puis, regardant le ciel, il la rend et s’apaise.
Le héraut, la brisant en deux sous son talon :
— « C’est le glaive, dit-il, d’un chevalier félon,
Le glaive d’un soldat lâche et traître à son maître. »
La foule se taisait, mais regardait le traître,
Les yeux levés au ciel, immobile et priant.
Et le chant reprenait, toujours plus effrayant :
Plusieurs prêtres émus versaient de grosses larmes.
Poursuivant son office, alors le héraut d’armes,
Marchant au condamné dès qu’on suspend les chants.
Brise à coups de marteau la hache à deux tranchants
Qui, dans ses fortes mains, à son manche nouées,
Ouvrait devant ses pas de si larges trouées…
Oh tant d’exploits flétris ! flétris dans un seul jour !
Oui, le héraut cruel enlève tour à tour
A ce vaillant soldat, vainqueur dans dix batailles,
Et le haubert d’acier, et les chausses de mailles,
Et les éperons d’or, dont il était si fier ;
Puis il rompt tout cela sous le maillet de fer :
Répétant, chaque fois qu’il enlève une pièce,
Le terrible refrain de la loi vengeresse
Qui soufflette en public le chevalier félon.
Mon Dieu ! que ce supplice est effroyable et long
Le patient se tait, mais il courbe la tête ;
Voyez son œil humide et son flanc qui halette,
Et ses cheveux collés de sueur à son front…
Juges, soyez contents: il sent bien chaque affront !
Il évite vos yeux dont le regard le faille.
Le gambison de cuir qui lui serrait la taille,
Son dernier vêtement de soldat, le héraut
L’en dépouille et le foule aux pieds sur l’échafaud.
Le voilà presque nu ! jouissez du spectacle :
La hache du bourreau frappera sans obstacle.
Cet orgueilleux baron est donc enfin vaincu !
Plus rien à lui briser, si ce n’est son écu.
Le chef, le désignant du doigt, dit : « Qu’on le rompe! »
VI. – UN OURAGAN.
Le héraut a sonné par trois fois de sa trompe,
Puis, marchant lentement vers le pal abhorré,
Où pend, la pointe en haut, l’écu déshonoré,
Remet la pointe en bas, puis à deux bras l’enlève
Et, faisant un effort, sur sa tête l’élève.
Cet écu, qu’aux combats portait le chevalier,
Serait pour le héraut un trop lourd bouclier,
Car ses deux mains ont peine à le soutenir seules.
Le grand lion d’argent s’y dresse au champ de gueules,
De triomphe et d’orgueil tout palpitant encor,
Langue ardente, ongle aigu, le front couronné d’or.
Le soleil sur l’écu reluit, comme un symbole,
Et de sa gloire antique on croit voir l’auréole.
Le héraut crie à tous : « Peuple loyal et bon,
Cet écu, c’est celui d’un chevalier félon,
C’est l’écu d’un baron lâche et traître à son maître.
Puisse être châtié comme lui chaque traître ! »
Alors, faisant le tour du sinistre échafaud
Et ployant sous le poids de l’écu qu’il tient haut,
A tous les spectateurs lentement il le montre.
Tout à coup il pâlit. C’est que son œil rencontre,
Immobile et fixé sur lui, l’ardent regard
Du condamné, qui s’est redressé tout hagard.
Bien qu’il soit désarmé, cet homme-là vous glace :
En lui tout est colère, en lui tout est menace.
Dans sa haute stature il se tient là debout ;
La sueur de son front vous dit que son sang bout ;
Ses cheveux tout mouillés se dressent sur sa tête ;
De sa gorge s’exhale un souffle de tempête ;
Sous ses sourcils froncés ses yeux sont pleins d’éclairs
Et l’ongle de ses poings s’enfonce dans les chairs.
Un indicible effroi plane sur l’assemblée ;
Jusqu’en ses profondeurs l’âme se sent troublée :
Il semble qu’on ait vu se dresser un géant
Dont un geste pourrait vous plonger au néant.
Immobile de peur, le héraut, qui frissonne,
Laisse glisser l’écu, qui lugubrement sonne.
Clisson a fait un pas : le héraut terrassé
Tombe à genoux, de crainte et de respect glacé.
Il se traîne à ses pieds, mains jointes, tête basse,
Et sa voix, s’il l’osait, lui demanderait grâce.
C’est qu’il a reconnu sur le front de ce preux
Toute la majesté de ses vaillants aïeux…
Et le spectacle est beau de voir, sur cette estrade,
Le dégradé courbant celui qui le dégrade.
Sur les juges alors le sombre condamné
Fixe ses yeux brûlants, et leur chef consterné,
Le cœur gros des terreurs que son front dissimule,
Crie au héraut : « Poltron, répète la formule.
Cet homme à moitié nu peut-il te faire peur ?
Ne sais-tu pas qu’il est lâche autant que trompeur ? »
Le patient bondit sous le trait qui le blesse :
— « Pardonnez-moi, mon Dieu, d’oublier ma promesse.
J’ai besoin de crier. Cet homme en a menti ! »
Ce cri dans tous les cœurs terrible a retenti.
Les regards anxieux attendent une lutte
Et pour un siècle entier comptent chaque minute.
Les juges sont tout près d’appeler le bourreau,
Pour leur venir en aide et dompter ce taureau ;
Leur chef surtout, tachant l’effroi de ridicule,
Se rejette en arrière et malgré lui recule.
Le héraut, qu’il menace et qui craint son courroux,
Veut en vain se lever… il reste à deux genoux.
Eperdu, fasciné, tremblant, ployant la tête,
Il laisse sur son front passer cette tempête.
Tous sont pétrifiés, jusqu’au dernier archer :
Clisson eût voulu fuir, nul n’eût pu l’empêcher ;
Mais ce grand cœur n’en eut pas même la pensée :
Sa mort l’occupe moins que sa gloire offensée.
VII. – UN RAYON DE SOLEIL.
Parfois, quand l’ouragan bouleverse les mers,
Dont les flots affolés vont défier les airs,
S’il éclate soudain quelque grand coup de foudre,
Vous voyez la tempête aussitôt se dissoudre.
Tout se calme, et ces flots, naguère furieux,
Offrent leur clair miroir au pur azur des cieux.
Tel le noble Breton sent tomber sa colère ;
Son visage crispé s’adoucit et s’éclaire.
Si quelque long soupir, quelque tressaillement,
Vous rappellent encor son grand rugissement,
Ne vous effrayez pas de ce reste de houle :
Son indignation s’est fait jour et s’écoule.
Un terrible combat s’est livré dans son cœur ;
Mais la lutte a cessé : le chrétien est vainqueur.
Il tombe à deux genoux, et là, du sacrifice,
A l’exemple du Christ, acceptant le calice,
Malgré son amertume, il le boit tout entier.
S’il nous conduit à Dieu, qu’importe le sentier ?
Quand de l’église au loin la cloche nous invite,
On coupe à travers champs pour arriver plus vite :
Et cette douce image éveille en son esprit
Maint souvenir charmant qui gazouille et qui rit;
Et son âme se fait de plus en plus sereine.
Ainsi le cerf blessé, s’il trouve une fontaine,
De la meute cruelle oubliant les abois,
S’abreuve, et fuit heureux sous la fraîcheur des bois.
Pour le récompenser de la volonté saine
Qui dompte en lui l’orgueil et chasse enfin la haine,
Dieu verse au condamné cette divine paix
Qui fait tout accepter comme autant de bienfaits.
La résignation vaut mieux que le courage ;
Pourquoi craindre la mort ? pourquoi craindre l’outrage ?
Non, Dieu ne choisit pas parmi les glorieux :
Ses élus les plus chers, ses préférés aux cieux,
Sont les justes qu’ici l’on raille et l’on bafoue,
Joyaux étincelants ramassés dans la boue.
Oui, vous aimez, Seigneur, ceux que vous corrigez !
Jésus, le doux Jésus , l’ami des affligés,
Après l’avoir ainsi consolé sur lui-même,
Ramène sa pensée à ceux que son cœur aime,
Sa femme, ses deux fils et leurs deux jeunes sœurs,
Groupe aimé, rayonnant d’ineffables douceurs.
Dans son œil attendri, voyez ! le bonheur brille :
Ses deux bras font un nid à toute sa famille.
Ils sont là tous les cinq, sur son sein se pressant,
Tous les cinq caressés, tous les cinq caressant.
Sa Jeanne, elle a toujours ce doux sourire aux lèvres,
Qui de son sang fougueux sait apaiser les fièvres.
Que de grâce et d’attraits dans son calme maintien !
Et ses fils, qu’ils sont forts et comme ils poussent bien !
Ses filles, deux boutons naissants et pleins de charmes.
Son Olivier surtout, le grand manieur d’armes,
Voyez comme il est fier et comme son œil luit,
En portant cette épée aussi haute que lui.
L’ heureux père sourit à ce jeune courage :
Quel brillant avenir l’attend dans un autre âge !
L’avenir ! Ah ! ce mot est vraiment déchirant !
Qu’est-ce que l’avenir pour cet homme mourant ?
L’avenir pour Clisson, c’est le temps du supplice ;
Car il faut qu’aujourd’hui son destin s’accomplisse.
O ses chers adorés, Dieu serait sans merci,
Si Dieu leur faisait voir ce qui se passe ici.
Non, la bonté de Dieu, qui partout se révèle,
Saura leur adoucir la navrante nouvelle.
Quand Herblain leur dira qu’il est mort résigné,
Eux diront que là-haut son pardon est signé
Et que pour eux au ciel un père, un époux prie.
Qu’ils soient heureux, Seigneur ; Clisson vous les confie :
Si vous aimez toujours la veuve et l’orphelin,
Le bonheur peut encor fleurir sur leur chemin.
— « Pour moi, Seigneur, pour moi, je chante ta louange.
De mes nombreux péchés ta bonté ne se venge
Qu’en m’envoyant, Seigneur, l’Espérance et la Foi
Me prendre sur leur aile et m’emporter vers toi.
Mes actions de grâce, eh bien, j’irai moi-même
Les offrir à Jésus, que j’adore et qui m’aime. »
VIII. – LE PSAUME DES MALÉDICTIONS.
Pendant qu’ainsi Clisson, chrétien vraiment contrit,
Laissait monter vers Dieu, qui du ciel lui sourit,
Les transports enflammés de son âme en extase,
Comme les doux parfums que l’encensoir embrase,
Le héraut, le voyant, le front dans les deux mains,
Étranger comme un mort à tous soucis humains,
Se hâte d’obéir à l’ordre de son maître,
Une seconde fois tout haut flétrit le traître,
Puis, faisant sur l’écu retentir le marteau,
Le brise en trois et foule aux pieds chaque morceau,
Criant : « Vive Philippe et que Dieu nous protège ! »
Alors sur l’échafaud où le tribunal siège,
L’autre héraut s’avance et dit à haute voix :
« L’homme que vous voyez là parut autrefois
Digne, par son cœur brave et sa main aguerrie,
Des saints éperons d’or de la chevalerie.
Il les reçut du Roi, son maître et son seigneur ;
Mais avant d’être admis à ce suprême honneur,
Pour écarter de lui l’ombre même d’un blâme,
Il dut purifier et son corps et son âme.
Un bain limpide et froid purifia le corps ;
Dans la confession l’âme lava ses torts :
Alors, pur devant Dieu, dans sa candeur première,
Il passa dans l’église une nuit en prière,
A genoux sur le marbre et tout vêtu de blanc.
» Vous le voyez encore à genoux et tremblant,
Et peut-être ses yeux pleurent-ils ; mais ces larmes
Ne sont plus les pleurs purs de la veille des armes.
Chevalier déloyal, il s’est déshonoré :
Soit son nom à jamais et partout abhorré !
Sa carrière d’honneur est aujourd’hui finie,
Et l’on va lui donner le bain d’ignominie. »
Les prêtres, se levant et marchant deux par deux,
Se rangent en silence autour du malheureux,
Et, l’âme en pleurs devant cette grandeur tombée,
Tous ont posé la main sur sa tête courbée.
Le peuple avec effroi contemple ce tableau.
Le doute et la pitié se heurtant de nouveau,
Prêtres et spectateurs ont les yeux pleins de larmes.
Au-devant de l’estrade, un des poursuivants d’armes,
Debout, tient le bassin, dont l’onde exhale encor
Sa légère fumée, où joue un rayon d’or,
Comme fait le soleil dans un brouillard d’automne.
Le signal est donné : le chœur funèbre entonne
Le Cantique effrayant des malédictions,
Où David flagellait de ses prédictions
Et le traître Judas et ceux qui lui ressemblent.
Pour que chacun comprenne et que les félons tremblent,
On chante tour à tour les terribles versets,
Six prêtres en latin, six prêtres en français.
Les âmes de terreur pourraient devenir folles,
Car l’air est effroyable autant que les paroles.
Oh ! c’est trop d’épouvante ! Et tout cela, mon Dieu,
Sous ton soleil si gai, sous ton ciel pur si bleu !
« Dieu qu’a loué ma voix, romps enfin le silence.
Le pécheur et le fourbe ont avec impudence
Ouvert leur bouche contre moi.
Ils parlent contre moi d’une langue félonne ;
De discours venimeux leur haine m’environne ;
Ils m’attaquent sans bonne foi.
» J’ai fait tous mes efforts pour gagner leur tendresse ;
Mais leur ingrate voix m’a déchiré sans cesse ;
Et pourtant je priais pour eux.
Ils barrent mon chemin, et leur malice oppose
Le mal à mes bienfaits, et leur haine sans cause
Aux élans d’un cœur généreux. »
Le condamné priait à genoux, en silence.
Il tressaille à ce chant qui vers le ciel s’élance :
Les accents désolés du lamentable chœur,
C’est la voix d’un ami qui console son cœur.
Ce n’est pas contre lui que cette plainte est faite ;
Il pourrait répéter les cris du Roi-Prophète :
Le fourbe et le pécheur le déchirent aussi,
Et ce n’est pas son front que l’on maudit ici.
Sans effroi, sans orgueil, son âme reposée
Bénit le doux David de sa douce rosée.
Il se rappelle alors le vœu du saint Pater
Et, levant son visage aussi calme que fier,
Il jette un long regard de pardon à ses juges.
Leur chef a pâli, mais, fécond en subterfuges,
Il crie à toute voix : « Misérable, écoutez
Les arrêts que Dieu même a contre vous dictés. »
Les prêtres, indignés de ce cri sacrilège,
Ont cloué d’un coup d’œil le juge sur son siège,
Puis reprennent leurs chants, où tremblent des sanglots.
La foule sur la place alors calme ses flots.
« Pour le punir des maux que le traître convoite,
Qu’il ait le grand Pécheur pour maître, et qu’à sa droite
Se tienne toujours le Démon.
Que chaque jugement le condamne et me venge ;
Qu’à jamais sa prière en un péché se change ;
Que Dieu lui dise toujours non.
» Soient ses jours peu nombreux et soit sa vie infâme ;
Soient ses fils orphelins et veuve soit sa femme ;
Qu’un autre succède à leurs droits.
Que ses enfants tremblants, rongés de maladie,
Soient transportés bien loin et que leur main mendie ;
Qu’ils soient chassés hors de leurs toits.
» Que l’avare usurier dévore sa substance ;
Que l’étranger le pille et disperse ou dépense
Les fruits par ses mains entassés ;
Qu’il crie et que personne à son aide n’accoure ;
Que personne jamais ne plaigne et ne secoure
Les pupilles par lui laissés.
» Que ce soit pour la mort qu’il lui naisse une race ;
Qu’elle s’éteigne vite et que son nom s’efface ;
Que de ses aïeux les forfaits
Soient devant Dieu toujours un objet de colère ;
Qu’à jamais rappelé, le péché de sa mère
Ne puisse s’effacer jamais.
» Que leurs crimes toujours contre le ciel se dressent ;
Qu’ils soient exterminés ; que leurs noms disparaissent
De la mémoire des vivants.
Puisqu’oubliant la loi d’où la bonté déborde,
Cet homme n’a pas su faire miséricorde,
Que sa cendre aille à tous les vents.
» Il a persécuté qui mendie et qui prie ;
L’homme contrit de cœur, son aveugle furie
A voulu le faire mourir.
La malédiction qu’il chérissait l’accable ;
La bénédiction que fuyait le coupable,
Loin de lui se hâte de fuir.
» La malédiction ! cet homme l’a vêtue.
Elle pénètre en lui comme l’eau qu’il a bue
Et comme l’huile dans ses os.
Oh! qu’elle soit pour lui l’habit dont il se couvre ;
Qu’elle soit sa ceinture et que sa boucle s’ouvre
Pour serrer ses reins sans repos.
» Oui, de mes ennemis tel sera le salaire ;
Voilà ce que mon Dieu réserve en sa colère. »
IX. – UNE ARME A DEUX TRANCHANTS.
— « C’est assez, dit le juge ; arrêtez, s’il vous plaît,
Et suspendez le psaume à ce dernier verset. »
— « Dieu ne se prête pas aux caprices des hommes ;
Sa justice pour tous est égale, et nous sommes,
Nous ses prêtres, tenus de respecter sa loi,
Comme vous êtes, vous, soumis à votre roi.
Nous sommes la prière ici, vous le supplice :
Ce psaume tel qu’il est appartient à l’office,
Et c’est vous qui l’avez fait traduire en français ;
Nous en devons pour tous chanter tous les versets,
Sans chercher à savoir qui de nos chants s’offusque. »
— « Eh bien! poursuivez donc vos chants,» dit d’un ton brusque
Le juge, qui cacha dans ses deux mains son front,
Comme pour dérober la rougeur d’un affront :
C’est que le condamné, qui relevait la face,
De son calme regard terrassait son audace.
Le peuple devenait de plus en plus bruyant ;
Mais il se tut encor quand on reprit le chant.
« Oui, de mes ennemis tel sera le salaire ;
Voilà ce que mon Dieu réserve en sa colère
A ceux qui parlent mal de moi.
Et toi, Seigneur, Seigneur, dans ta douce clémence,
Fais de ton nom divin éclater la puissance
Et de mon côté range-toi.
» Délivre-moi : je suis plongé dans la misère ;
Je suis pauvre, et mon cœur qui de douleur se serre,
Dans mes entrailles s’est troublé.
J’ai disparu, semblable à l’ombre qui s’efface ;
Comme la sauterelle, hélas ! que le vent chasse,
Je fuis au hasard, essoufflé.
» Mes genoux, affaiblis par le jeûne, s’affaissent,
Et, comme l’huile manque aux nerfs qui s’en repaissent,
On voit ma chair se dessécher.
Je leur suis devenu comme un opprobre horrible ;
Aussitôt qu’ils m’ont vu, sous un signe invisible,
Leurs fronts se sont mis à hocher.
» Toi que je dis mon Dieu, Seigneur, viens à mon aide ;
Que ta miséricorde apporte mon remède ;
Délivre-moi, fais-moi merci.
Qu’ils sachent que ta main a fait toutes ces choses,
Que toi seul es le maître et la cause des causes,
Que toi seul as fait tout ceci.
» Quand ils me maudiront, que ta voix me bénisse ;
Par toi soit confondu qui cherche mon supplice ;
Ton serviteur sera joyeux.
Que qui me calomnie à la honte succombe ;
Que leur confusion sur leurs épaules tombe,
Double manteau jeté sur eux.
» Et je chanterai Dieu dans ma reconnaissance !
Je le célébrerai de toute ma puissance,
Devant de nombreux auditeurs ;
Car, pauvre, je l’ai vu se tenir à ma droite,
Pour relever mon âme et la maintenir droite
Contre tous mes persécuteurs. »
Les prêtres terminaient le chant de ce long psaume,
Quand soudain sur leurs fronts se dresse un grand fantôme :
C’était le condamné, qui, se levant tout droit,
Immobile, montrait ses vingt juges du doigt,
Ses juges fascinés et tout transis d’alarmes.
Le héraut, assisté des deux poursuivants d’armes,
S’élance et balbutie : « A genoux ! à genoux ! »
D’un geste et d’un regard il les maîtrise tous :
— « J’ai promis le silence, oui, c’est vrai; mais arrière !
Car je ne me suis pas interdit la prière.
Peuple, et vous chevaliers, traîtres et gens de bien,
Ecoutez-moi : je vais prier en vrai chrétien. »
Tous l’écoutent ; et lui, de sa voix foudroyante,
Fait retentir au loin sa prière effrayante :
Il parle lentement, voulant être entendu,
Et vers le tribunal son bras reste étendu.
— « Oui, de mes ennemis tel sera le salaire ;
Voilà ce que mon Dieu réserve en sa colère
A ceux qui parlent mal de moi.
Et toi, Seigneur, Seigneur, dans ta douce clémence,
Fais de ton nom divin éclater la puissance
Et de mon côté range-toi.
» Quand ils me maudiront, que ta voix me bénisse ;
Par toi soit confondu qui cherche mon supplice ;
Ton serviteur sera joyeux.
Que qui me calomnie à la honte succombe ;
Que leur confusion sur leurs épaules tombe,
Double manteau jeté sur eux.
» Et je chanterai Dieu dans ma reconnaissance !
Je le célébrerai de toute ma puissance,
Parmi de nombreux auditeurs ;
Car, pauvre, je l’ai vu se tenir à ma droite,
Pour relever mon âme et la maintenir droite
Contre tous mes persécuteurs. »
Alors le condamné, croisant ses bras, regarde
Ses juges, qui restaient tremblants, malgré leur garde.
Juges, ne tremblez pas : son front est triomphant,
Mais ses yeux sont plus doux que les yeux d’un enfant ;
La charité chrétienne y brille tout entière.
Son pardon est complet, son pardon est sincère…
Il en cache la cause et je vais la trahir :
Il vous méprise trop, pour pouvoir vous haïr.
Les prêtres sont allés se rasseoir à leur place,
Et pour le malheureux chacun prie à voix basse :
A leur compassion son titre est de souffrir ;
Mais quelques-uns en lui révèrent un martyr.
Bientôt le patient, courbant sa noble tête,
S’agenouille et reprend sa prière muette ;
Dans le peuple courut encore un long frisson
Et l’inconnu cria de loin : « Très-bien, Clisson ! »
L’âme du vieil Herblain n’est pas la seule émue :
Je ne sais quel projet dans la place remue ;
A la haine, au mépris succède la pitié :
Dans l’admiration va fleurir l’amitié ;
Et plus d’un spectateur, les yeux baignés de larmes,
S’inquiète où trouver des pierres ou des armes.
Cependant le clairon fait retentir sa voix,
Et l’agitation tombe encore une fois ;
Mais on sent que la foule est toute palpitante
Et qu’un courroux grondant se mêle à son attente.
X. – LE BAIN D’IGNOMINIE.
Un mouvement s’est fait sur les deux échafauds.
Au bord de chacun d’eux se rangent les hérauts,
Leur trompe en main, suivis de leurs officiers d’armes :
Leur costume éclatant brille de tous ses charmes.
Le héraut, de l’estrade où le vent encor frais
Joue avec les glands d’or et le velours du dais,
Dit alors par trois fois, de sa voix la plus forte :
— « Héraut au riche émail, héraut à mine accorte ;
Quel est l’homme à genoux sur ce fatal drap noir,
Qui courbe ainsi la tête et semble au désespoir ?
Si tu connais son nom, que ta voix le proclame. »
Et le héraut, debout sur l’échafaud infâme,
Aux deux premières fois resta silencieux,
Morne, les bras croisés, n’osant lever les yeux ;
Mais, quand la question se fit encore entendre,
Vers l’homme qui priait on vit son bras s’étendre,
Et sa voix retentit comme un son de clairon :
— « Héraut trop curieux, tu veux savoir son nom ?
Cet homme à moitié nu, dont tu vois la dépouille
Et qui sur ce drap noir humblement s’agenouille,
C’est un puissant baron, un noble chevalier.
Ce guerrier valeureux, qu’on appelle Olivier,
Est sire de Clisson, seigneur de Blain, de Gorge
Et de vingt autres fiefs. » — « Ou tu mens par ta gorge,
Héraut, ou tes amis t’ont renseigné bien mal :
Cet homme est un félon, un soldat déloyal,
Foi-mentie à son roi, foi-mentie à son prince,
Et l’opprobre éternel de toute une province.
» Or, pour que ce bon peuple, autour de nous groupé,
Par tes discours menteurs ne puisse être trompé,
O loyaux chevaliers, qui siégez comme juges,
Je vous prends à témoins, parlez sans subterfuges,
Que nous faut-il penser de l’homme que voici ? »
Le président se lève, et d’un ton adouci :
« Le tribunal, dit-il, n’a pas droit de clémence.
Pour la dernière fois, héraut, lis la sentence. »
Et le héraut, debout sur l’estrade au drap noir,
A ce peuple assemblé répète et fait savoir
Qu’Olivier de Clisson n’est plus qu’un traître infâme
Et que, laissant à Dieu le souci de son âme,
Son corps doit, ce jour même, être au bourreau livré
Quand le dernier affront l’aura déshonoré.
— « Eh bien ! donnez-lui donc le bain d’ignominie :
Sa dégradation sera close et finie. »
L’ordre du président à peine est prononcé,
Qu’au front du patient le bassin est versé :
Le long de tout son corps cette eau fumante coule…
Il se redresse et jette un coup d’œil dans la foule,
Fait ostensiblement le signe du chrétien,
Et retombe à genoux, muet. S’il ne dit rien,
On voit à coups pressés tressaillir ses épaules,
Larges à supporter, comme Atlas , les deux pôles…
Oh ! s’il ne bondit pas, le terrible lion,
C’est qu’il est enchaîné par la Religion.
Et le peuple restait menaçant, mais tranquille !
— « Les lâches! dit Herblain. Foule ignoble et servile !
A l’entendre, on dirait qu’elle est prête à marcher ;
Mais son courage tombe à l’aspect d’un archer. »
Le fidèle Breton découragé s’évade.
XIN – LA CIVIÈRE.
Les juges cependant descendaient de l’estrade
Et, cachant les habits qui paraient leur orgueil,
Sous des chaperons noirs et des robes de deuil,
Ils vont en double file à l’église prochainé,
Où leur garde leur fraie une voie à grand’peine.
La colère du peuple autour d’eux gronde haut.
Le reste des archers protège l’échafaud
Où le condamné prie. On entend une cloche
Sonner des glas. Alors un des hérauts s’approche
Et lui dit : « Levez-vous, il est temps de partir » ;
Et l’on voit se lever le grand et doux martyr.
Ce serait trop d’honneur que l’infâmante échelle ;
D’une corde aux gros nœuds, passant sous chaque aisselle,
Le noble et fier baron à terre est descendu ;
Puis sur une civière on le couche, étendu
De toute sa longueur, comme on fait d’un cadavre.
Sur son visage pâle et dont la douceur navre,
On jette un long drap noir, où se découpe en blanc
Une croix. Ni le corps, ni le cœur n’est tremblant ;
Si parfois quelque pli du suaire remue,
C’est la brise qui passe, et non l’haleine émue.
Les prêtres deux par deux, tous le front découvert,
Descendent les degrés de l’échafaud désert.
Ils entourent, muets, la civière lugubre.
Chacun d’eux à longs flots aspire l’air salubre,
Pour soulager un peu son pauvre cœur gonflé ;
Le héraut insensible est lui-même troublé
Et soupire ; il n’est pas jusqu’aux poursuivants d’armes
Qui ne sentent monter à leurs yeux quelques larmes :
Tant c’est chose terrible et douloureuse à voir
Que ce baron couché vivant sous ce drap noir !
Les archers à cheval, rangés en double file,
Font un large sillon dans la foule mobile,
Qui referme ses rangs et se presse autour d’eux.
Aussitôt deux sergents, de leurs bras vigoureux
Enlèvent la civière et se mettent en marche :
La lourdeur du fardeau ralentit leur démarche ;
Et les prêtres, chantant les prières des morts,
Escortent ce cadavre ou, disons mieux, ce corps,
Jusqu’à l’église sombre où les juges l’attendent.
Sur le seuil, des archers bien armés en défendent
L’entrée, à qui n’est pas du cortège fatal.
Pour comble de prudence, une troupe à cheval
Écarte du parvis le peuple et le refoule,
Comme si l’on craignait quelque émeute en la foule !…
La curiosité la pousse, mais c’est tout :
La terreur, désormais épuisée, est à bout.
Plus que le vent et l’eau la foule est variable :
Compter sur son appui, c’est bâtir sur le sable.
Lorsque le fier Breton se dressait sous ses yeux,
Tour à tour résigné, tour à tour furieux,
Mais imposant toujours, son geste ou sa parole
Bouleversait les flots de ce peuple frivole ;
Mais sur cette civière à l’appareil mesquin,
Ce n’est plus qu’un spectacle et qui touche à sa fin.
Qui sait même ? Clisson, avant longtemps peut-être,
Doit entendre hurler les cris de : « Mort au traître ! »
Ce n’est pas sous le drap qu’il est enseveli,
C’est sous l’indifférence et bientôt sous l’oubli.
A ce peuple inconstant ne jetez pas le blâme,
O lecteurs ! Descendez avec moi dans votre âme :
Vous êtes déjà las de vos émotions
Et mes vers sont pour vous des déclamations !
Eh bien ! dussiez-vous tous refuser de me suivre,
Moi, que la passion de la justice enivre,
J’irai jusques au bout de ce drame de sang,
J’irai flétrir le crime et venger l’innocent.
Cependant la civière et son morne cortège,
Que la troupe d’archers accompagne et protège,
Sont entrés dans l’église, où sonne encor le glas.
Cette église est déserte et l’on entend les pas,
Comme de sourds sanglots, résonner sur les dalles.
Dans le bas de la nef tremblent les lueurs pâles
Des cierges, dont le jour brillant ternit les feux :
Du crime qu’on commet on les dirait honteux.
Ils forment un carré dont un côté s’éventre,
Pour qu’on puisse aisément pénétrer dans le centre,
Où se dressent, couverts d’un lugubre tapis,
Deux tréteaux, dont les pieds brillent au bas des plis.
Noire et de pleurs d’argent semée, une tenture
Forme à la nef en deuil une longue ceinture.
La lumière à grands flots entre par le portail ;
Le soleil radieux rit à plus d’un vitrail ;
Mais flambeaux et soleil n’ont pu qu’éloigner l’ombre,
Qui plane et sur l’abside étend son aile sombre.
Six cierges, allumés sur l’autel principal,
Rayonnent faiblement d’un éclat sépulcral.
On aperçoit au fond, sous leurs clartés funèbres,
Les juges, qui du chœur ont cherché les ténèbres.
Sous leur robe de deuil et leur noir chaperon,
Ont-ils donc peur encor, qu’ils courbent tous le front ?
C’est qu’ils viennent de voir s’avancer la civière.
Ah ! si le grand baron, rejetant son suaire,
Se redressait terrible, et là, sous l’œil de Dieu,
Allait les souffleter, pour son dernier adieu !
Et voilà qu’en effet la civière s’approche,
Sous les chants du clergé, sous les glas de la cloche.
Les sergents sur son socle ont mis leur lourd fardeau
Et sèchent de leurs poings leur front ruisselant d’eau.
Mais hors du long drap noir nul spectre ne se lève.
Juges, rassurez-vous, votre peur n’est qu’un rêve :
Le martyr vous oublie et Dieu remplit son cœur…
Oh ! non, juges, tremblez, Dieu lui garde un vengeur !
Continuant toujours leurs chants, les prêtres, pâles
Et les yeux baissés, vont remplir au chœur leurs stalles.
On voit alors entrer, entouré de soldats,
Un des prévôts du roi, grave et comptant ses pas.
Il s’avance et s’assied près des officiers d’armes.
Dans un coin de l’église était un homme en larmes.
XII. – LES DERNIÈRES PRIÈRES.
Après un court silence, au repos consacré,
Le clergé, dérogeant au rituel sacré,
Dit, quoique fatigué de la cérémonie,
Les chants habituels pour l’homme à l’agonie,
Chants parfumés d’espoir, à la fois doux et forts ;
Puis, élevant la voix pour l’office des morts,
Recommande cette âme au Créateur des êtres.
Quand le dernier verset fut chanté, tous les prêtres
Revinrent, sur deux rangs, précédés de la croix,
Bénir le moribond pour la dernière fois.
O prêtres, puisqu’il faut que cet innocent meure,
C’est bien de lui montrer la céleste demeure ;
Mais comme il serait beau que, levant son drap noir,
Un de vous lui rendît même ici-bas l’espoir,
Et, dédaignant les cris d’un haineux entourage,
Lui dît : « Que font au juste et la mort et l’outrage ?
La mort ! mais un Breton ne la redoute pas :
Ne l’as-tu pas bravée en plus de cent combats ?
Tu l’affrontais alors aux risques de ton âme ;
Ici, c’est le salut, le creuset où la flamme
De la vile scorie épure le métal :
Souvent un échafaud devient un piédestal.
Ils te jettent en vain et la honte et l’injure,
Ils t’appellent en vain et félon et parjure ;
Le temps lave toujours l’outrage immérité :
Clisson peut faire appel à la postérité.
» Mais ce n’est pas assez d’espérer pour toi-même
Et d’attendre de Dieu le salaire suprême :
Ne sois pas inquiet pour tes jeunes enfants.
Quand la guerre rugit, les partis triomphants
Outragent sans pitié qui leur a fait obstacle ;
Mais quand les passions se taisent, doux miracle !
Les noms les plus maudits, s’ils sont maudits à tort,
Reprennent leurs rayons dans la nuit de la mort :
Chacun veut effacer leurs taches sous ses larmes…
Tes fils retrouveront tes châteaux et tes armes.
Monte donc vers le ciel, libre de tout souci,
Et souviens-toi de nous qui t’absolvons ici. »
Vain espoir ! le doyen, trop fidèle aux saints rites,
Se borne à réciter les prières prescrites…
Après qu’il eût trois fois secoué l’aspersoir
Et balancé l’encens fumant dans l’encensoir,
Les prêtres vers le chœur lentement remontèrent,
Puis dans la sacristie, en priant bas, rentrèrent ;
Mais bien des yeux en pleurs ont jeté leur adieu
Au martyr, qui n’a plus pour défenseur que Dieu.
Le silence se fait et les cierges s’éteignent.
Délivrés des témoins qu’au fond du cœur ils craignent,
Les juges, déposant leurs vêtements de deuil,
D’un pas majestueux ont regagné le seuil ;
Mais leur chef, s’arrêtant auprès de la civière.
Dit tout haut, d’une voix qui voulait être fière :
« Les juges ont fini; noble prévôt du roi,
C’est à vous maintenant de remplir votre emploi » ;
Puis, d’un pas grave et lent, il marche vers la porte.
Au parvis de l’église aussitôt on emporte,
Sur l’ordre du prévôt, la civière au drap noir ;
Et cet homme, qu’on croit glacé de désespoir,
Mais qui bénit son Dieu de la lèvre et de l’âme,
On l’enlève, on l’étend sur une claie infâme,
Par les pieds et les reins solidement lié,
Toujours couvert du drap avec soin replié,
Mais conservant toujours, sur son noble visage,
Chrétien, toute sa foi, soldat, tout son courage.
XIII. – LA GRACE.
On attelle à la claie, en signe de mépris,
Une cavale ignoble, aux longs flancs amaigris.
Sur le parvis s’amasse à flots bruyants la foule,
Mais la garde nombreuse avec soin la refoule :
Un large espace est libre, où les hommes du roi
Peuvent vaquer en paix chacun à son emploi.
Montés sur leurs chevaux, les trois officiers d’armes
Y font avec orgueil parade de leurs charmes ;
Mais le plus fier de tous, c’est le grave prévôt :
Comme il s’agit de mort sa dignité prévaut.
Les chevaliers armés, rangés en double haie,
Entourent la cavale et son ignoble claie.
Le signal est donné : tous partent au grand trot,
Et la claie a bondi sous plus d’un dur cahot.
Ils courent aux Champeaux, cette place des Halles,
Où tomba plus d’un front fameux dans nos annales.
Au milieu du marché se dresse un échafaud,
Comptant neuf pieds de large et douze pieds de haut.
Sur le devant, un bloc, déjà taché de rouge,
Et trois hommes debout, dont l’ombre seule bouge.
Partout des spectateurs, du pavé jusqu’aux toits ;
Tout cela crie, ou cause, ou murmure à la fois ;
Et le soleil, qui veut prendre part à ces fêtes,
Envoie un doux sourire à ces milliers de têtes :
Le spectacle du soir vaut celui du matin,
Mais il sera moins long… la fête est à sa fin !
La claie est là. Déjà du bourreau les deux aides,
Levant le drap, qui tremble aux vents du soir tout tièdes,
Ont délié Clisson. Ses membres détirés,
Calme et les yeux au ciel, il monte les degrés,
Et de son agonie apercevant le terme,
Il jette au billot rouge un coup d’œil doux et ferme.
Dans la foule soudain se fait un mouvement.
C’est qu’au loin dans la rue on entend vaguement
Des battements de mains mêlés de cris de joie,
Et ce bruit sourd augmente, approche et se déploie.
Tous les yeux sont tournés vers le même côté.
« Des applaudissements!… C’est de la cruauté ! »
Mais non ! écoutez bien, car d’espace en espace,
On distingue ce mot, ce doux mot : « Grâce ! grâce ! »
Chacun respire à l’aise et, sans savoir pourquoi,
Crie instinctivement : « Vive notre bon Roi ! »
Oh ! oui, Philippe est bon : sans doute sa clémence
Vient arracher Clisson à la dure sentence
Qu’ont prononcée à tort des juges inhumains…
Et sur la place aussi le peuple bat des mains.
Herblain lui-même espère, et sa tête alourdie
Se redresse, en songeant au duc de Normandie.
Ce prince est généreux : son âme aura frémi
Du destin qui menace Olivier, son ami,
Son compagnon de gloire, hélas ! et sa victime.
C’est lui! c’est lui qui vient empêcher un grand crime !
Herblain lance à son maître un regard de bonheur
Et de ses bras croisés le presse sur son cœur.
Le condamné sourit, mais, secouant la tête,
Lui montre le billot et cette hache prête,
Qui semble, pour frapper, n’attendre qu’un signal.
Cependant on entend le galop d’un cheval ;
Les cris ont redoublé d’ardeur sur son passage.
Pour lui faire un chemin le peuple se partage,
Et l’on voit sur la place apparaître un héraut.
Qui s’avance, muet, vers le haut échafaud.
En voyant sur son sein les fleurs de lys de France,
Herblain sent, malgré lui, fléchir son espérance :
Le duc de Normandie est-il traître à sa foi ?
Ses pleurs ont-ils enfin pu triompher du Roi ?
Sous les ongles cruels du doute qui le ronge,
Dans les yeux du héraut son regard ardent plonge ;
Mais ce héraut muet garde un visage froid :
Rien ne trahit en lui son secret, quel qu’il soit.
Son doigt hautain fait signe au bourreau de descendre.
En deux bonds le bourreau s’est hâté de se rendre
Près du coursier fringant du messager royal.
Celui-ci, de la main caressant son cheval,
D’un air indifférent comme au champ de manœuvres,
Glisse à l’exécuteur sanglant des hautes œuvres
L’ordre… de mettre à part la tête de Clisson.
Le bourreau, qui n’a pu réprimer un frisson,
Promet oui par un signe, et, tout rouge de honte,
Sur le sombre échafaud à pas lents il remonte,
Pendant que le héraut, flegmatique et discret,
Repart au grand galop et bientôt disparaît.
Au fond du désespoir le pâle Herblain retombe
Et, sans sa mission, il envîrait la tombe :
Herblain se donnerait la mort, quoique chrétien.
XIV. – LES CHAMPEAUX.
Pendant le court moment que dura l’entretien,
La foule se taisait ou parlait à voix basse ;
Mais bientôt retentit de nouveau le cri : « Grâce ! »
De tous les spectateurs, pas un n’a soupçonné L’ordre qu’au nom du Roi, le héraut a donné ; Clisson a compris seul quelque nouvel outrage…
Sans qu’un muscle ait frémi sur son noble visage.
Le bourreau s’approchant lui dit : « N’espérez plus. »
— « Merci, mais tes avis, maître, sont superflus.
Car je n’espérais pas ; du moins mes espérances
Se préoccupaient peu du coup auquel tu penses. »
— « Tant mieux donc ! mais j’ai cru devoir vous prévenir :
Mon métier est cruel, et je dois obéir.
N’allez pas m’en vouloir, car ce n’est pas ma faute. »
— « J’ai pour te pardonner une raison plus haute :
Quand tu vas à mon corps donner le coup mortel,
C’est toi qui m’ouvriras, à ton insu, le ciel. »
Le peuple, s’indignant d’une trop longue attente,
Mugissait comme fait la mer dans la tourmente,
Quand son ressac se brise aux flancs noirs des rochers.
Quelques pierres volaient déjà sur les archers.
Au bord de l’échafaud le condamné s’avance
Et d’un geste imposant commande le silence :
— « Tous ces archers ne font qu’obéir à leur roi ;
Dieu seul doit prononcer entre Philippe et moi,
Et, dût, sous tant d’affronts, mon vœu paraître étrange,
Mon Dieu, fais que jamais personne ne me venge !
Qu’amis, épouse, enfants, tous ceux qui m’ont aimé,
Sachent bien que mon cœur à la haine est fermé.
Je n’ai pas cet-espoir : oh ! non, quoique sincère,
Ni les hommes ni Dieu n’entendront ma prière.
Quand le juge trahit sa sainte mission,
Quand pour règle il subit ou prend la passion,
Tous les droits violés, intérêt ou tendresse,
Se courbent; mais bientôt chacun d’eux se redresse :
La Vengeance les suit, et son emportement
Met souvent la fureur auprès du châtiment.
Dieu ne s’emporte pas, lui, dans son calme auguste ;
Mais si c’est le Dieu bon, c’est aussi le Dieu juste,
Et tout crime lui doit une expiation :
Le roi la paie ici, là c’est la nation ;
Quelquefois tous les deux la subissent ensemble…
Oh ! que de flots de sang ! Je me tais, car je tremble :
Je tremble pour la France et Philippe son roi ;
Chère Bretagne, hélas ! je tremble aussi pour toi.
La guerre est pour longtemps de retour à son poste .
» Seigneur, accepte-moi pour unique holocauste :
Que mon sang innocent, désarmant ton courroux,
Fasse pour ces ingrats luire des jours plus doux. »
La foule tressaillante écoutait en silence
Cet élan de bonté qui du tombeau s’élance :
Clisson, au-dessus d’elle étendant les deux bras,
La bénit, puis marchant, le front calme, au trépas,
Il s’approche à pas lents du billot, s’agenouille,
Prie. et place son front. Le bourreau le dépouille,
Sous le cri des ciseaux raccourcit les cheveux,
Et dit : « Êtes-vous prêt ? » — « Oui, maître, si tu veux. »
Que ne puis-je cacher des détails dont j’ai honte !
Mais mon dégoût, lecteurs, il faut que je le dompte,
Car ces affreux détails, Herblain les a tous vus ;
Et votre excuse y germe , ô châtiments prévus!…
Le bourreau des deux mains lève la lourde hache
Et frappe… Au second coup, la tête se détache,
Et le corps convulsif se dresse presque droit,
Puis tombe. Tout honteux de son bras maladroit,
L’exécuteur saisit par les cheveux la tête,
La présente à la foule. et dans un sac la jette ;
Car il doit la garder pour un but inconnu.
Quant au sang, qui jaillit du corps à moitié nu
Et de ses rouges flots teint la chemise blanche,
Dans des masses de son comme on peut on l’étanche.
Lorsque le sang s’épuise et se fige en caillots,
Un garçon du bourreau prend le corps sur son dos,
Descend… et le remet sur la claie infamante ;
Puis, pour cacher du cou l’ouverture béante,
Replace le drap noir… Bientôt le drap rougit,
Et sur la blanche croix la tache s’élargit.
Pauvres enfants! voilà ce qui reste d’un père!
Ils n’auront plus d’appui que le cœur de leur mère,
Car leur noble maison, aux aïeux éclatants,
N’a désormais pour chef qu’un enfant de sept ans.
Dieu bon, veillez sur eux! Dieu bon, veillez sur elle !
En vous Clisson eut foi. Vous lui serez fidèle !
Oh! c’est assez, c’est trop d’horreurs pour un seul jour :
Les cœurs vont succomber sous ce fardeau trop lourd.
Tout est fini, l’on peut respirer, et la foule
En causant bruyamment se disperse et s’écoule.
Non, tout n’est pas fini, car voilà le héraut
Qui monte les degrés sanglants de l’échafaud.
Il sonne du clairon, et le peuple s’arrête;
Une foule nombreuse à l’écouter est prête.
D’où sort-elle ? On ne sait, mais elle a recouvert
Le marché, qui semblait tout à l’heure désert :
Voyez! dans chaq ue rue elle accourt et serpente.
La curiosité creuse à ces flots leur pente :
Dès que l’ordre ordinaire est un moment troublé,
Le peuple en un clin d’œil s’y trouve rassemblé…
Le héraut tend son bras et dit d’une voix haute :
« Clisson vient de subir la peine de sa faute ;
Mais la trahison, peuple, est un crime si grand
Que la tache du père entache aussi l’enfant.
» Donc, au nom de mon roi, de Philippe de France,
Sachez que, par l’effet de sa juste sentence,
Tous les fils de Clisson et tous ses descendants,
A partir de ce jour dans la suite des temps,
Sont, ainsi qu’il le fut, dégradés de noblesse,
Sans pouvoir alléguer leur sexe ou leur faiblesse.
En présence de tous, je les déclare ici
Ignobles, roturiers, taillables à merci,
Indignes de porter des blasons et des armes,
Indignes de servir dans les rangs des gens d’armes,
Indignes de paraître aux joutes, aux tournois,
Dans les cours et partout où commandent nos rois ;
Et ce, sur peine d’être, au cas où leur audace
Oserait dédaigner la présente menace,
Arrêtés à l’instant dans les lieux défendus,
Dépouillés en public et de verges battus,
Comme vilains qu’ils sont et nés d’un père infâme.
J’ai dit… Honte aux Clisson, mais le ciel ait leur âme !
Et le héraut sonna de nouveau du clairon.
Eh bien! moi je vous dis, moi, poëte breton,
Mais rattaché de cœur à la France que j’aime :
Honte à vous tous, héraut, juges, roi, peuple même!
Quoi ! ce n’est pas assez pour un crime douteux
– Et quelle part je fais à vos arrêts boiteux !
De juger, de tuer ou de souffrir qu’on tue
Le soldat qui commit la faute prétendue ;
Quoi ! ce n’est pas assez d’entasser sur son front
Tout ce qu’on peut rêver de plus poignant affront !
Roi, juges et héraut, et peuple, osent s’en prendre
A de pauvres enfants, dans l’âge le plus tendre !
Si leur père est coupable, ils sont innocents, eux !
Oh! je vous le répète à tous, oui, c’est honteux !
Vous parlez de devoirs ? Rappelez-vous, ô lâches,
Que d’autres à leur tour sauront remplir leurs tâches !
Tenez, voyez courir, plus encor que marcher,
Cet homme, ce vieillard, vêtu comme un archer.
C’est Herblain. Quand s’est tu l’éloquent héraut d’armes,
Il s’est vers Montfaucon enfui, cachant ses larmes ;
Sa curiosité dompte son désespoir :
Car, pour tout raconter, cet homme veut tout voir.
XV. – MONTFAUCON.
De l’horrible gibet la haute et large masse,
Pour qui déplaît au prince éternelle menace,
Apparaît au Breton, dès qu’il sort de Paris.
Il compte de ses yeux effrayés et surpris
Les seize gros piliers, que des poutres énormes
Unissent, deux par deux, et qui, spectres difformes,
S’embrassent… Herblain voit, en approchant plus près,
Et les chaînes de fer et les hideux crochets
Où pendent, plus ou moins décharnés, des squelettes ;
Et quelques-uns, hélas! n’ont pas gardé leurs têtes.
Herblain entend au loin des chevaux galoper.
Sous des buissons épais se hâtant de ramper,
Il se signe trois fois, pour que Dieu le protège.
C’est l’infamante claie et son nombreux cortège.
Les chevaux au galop passent comme le vent.
Herblain reprend sa marche et peut, en arrivant,.
Voir, de loin, ce qu’on va faire enfin de son maître.
Sur une pierre gît le cadavre du traître.
Novice dans son art, le valet du bourreau
S’inquiète par où l’accrocher au poteau :
Comment exécuter ce que l’arrêt commande ?
Le corps n’a plus assez de cou pour qu’on le pende!
Oh ! la difficulté rend l’homme industrieux.
De l’ironie ici ? Ce serait odieux !
Le valet du bourreau par-dessous chaque aisselle
Fait passer une corde et, gravissant l’échelle,
Il réussit enfin à suspendre au crochet
Ce corps… dont Jeanne attend le front sur son chevet.
Que le ciel pleure ou bien que le soleil flamboie,
Des caprices du temps ce cadavre est la proie :
Le Roi le veut ; c’est là que Clisson doit pourrir,
A moins que les corbeaux ne viennent s’en nourrir.
Ah ! laissez-moi pleurer en terminant ma tâche :
Ce châtiment posthume est odieux et lâche.
Persécuteur d’enfants, ô Philippe, ô grand roi,
Un tel acharnement était digne de toi !
Du côté du couchant, là-bas, vers la Bretagne,
Au point où l’horizon s’unit à la campagne,
Voyez-vous ces lueurs, rouges comme du sang ?
Seraient-ce les reflets du soleil qui descend ?
Est-ce un spectre de feu qui de l’enfer s’élance ?
Ce n’est pas le soleil; oh! non!… c’est la Vengeance.
TROISIÈME PARTIE
LE RETOUR D’HERBLAIN
I- LA FÊTE DE FAMILLE.
Le mois aux jours brûlants, le mois aux fraîches nuits,
Qui colore la grappe et qui mûrit les fruits,
Qui fait sous le fléau sonner la gerbe blonde,
Qui, mêlant la rosée à la séve féconde,
Rend leur couronne verte aux rosiers des jardins,
Août nous donnait encore un de ces doux matins
Tout remplis de soleil, de parfums et de brises.
Le château de Clisson, le grand fort aux tours grises,
Semblait, sous ce ciel clair, rayonner de bonheur.
Vingt enfants égayaient sa grande cour d’honneur,
Bambins en qui la vie à peine encor boutonne
Et dont les plus âgés ont vu neuf fois l’automne ;
Ceux-ci fils de soldats, ceux-là fils de bourgeois,
Mais tous par Olivier convoqués à la fois,
Pour fêter avec lui le doux anniversaire
Du jour trois fois béni qui vit naître son père.
Pour commencer les jeux le maître est attendu ;
Mais monseigneur n’est pas encore descendu :
Monseigneur est aux mains, aux mains très-caressantes,
Mais trop lentes, hélas! de ses deux gouvernantes.
On habille Olivier, on boucle ses cheveux ;
Il a beau dire : « Assez! laissez-moi, je le veux.
Ils m’attendent en bas. Ce sera malhonnête » ;
Il faut qu’il soit brillant pour la brillante fête ;
Et le couple acharné, s’inquiétant d’un rien,
Jamais, quoique charmant, ne le trouve assez bien.
Cependant ses amis, ennuyés de l’attendre,
Sur le choix de leurs jeux ont fini par s’entendre.
Désir de liberté, peut-être excès de soin,
Les plus sages ont mis leurs surcots dans un coin ;
Et voilà tout l’essaim qui court, qui rit, qui crie,
Et trouble le silence avec effronterie.
Aux douves de Guérande et sur les longs roseaux
Que le vent du matin balançait sur les eaux,
J’ai vu jadis ainsi de leurs rapides ailes
Se croiser, en criant, les jeunes hirondelles.
Au haut de chaque tour, on voit de vieux soldats
Se pencher, et sourire à ces bruyants ébats.
Voix d’oiseaux, voix d’enfants ne font qu’un doux vacarme :
Aussi, dans le château tout en subit le charme.
Le gardien de la cour, bras croisés sur son seuil,
Se souvient, et s’égaie, et suit les jeux de l’œil ;
Si, même, à la croisée apparaît quelque duègne,
Qui rechigne d’abord, qui gronde et qui se plaigne,
Tant de vrai plaisir coule et semble déborder,
Que la vieille s’apaise et reste à regarder.
A quels jeux jouaient-ils ? Je ne sais, mais qu’importe,
Si la joie était grande et l’émotion forte ?
Or voici que soudain l’héritier des Clisson
Saute en la cour d’honneur de la cour du donjon.
Tous l’entourent déjà qu’il n’a fait que paraître.
Il est aisé de voir qu’Olivier est le maître,
Non par son rang, l’enfance a l’instinct peu flatteur,
Mais Clisson porte au front le sceau dominateur.
— « Fi de vos jeux ! dit-il ; n’avez-vous donc pas honte?
Il s’agit bien, vraiment, d’avoir la jambe prompte ;
C’est au bras le plus fort qu’il faut nous essayer :
La guerre est le seul jeu qui puisse m’égayer.
Qui m’aime bien me suive ! Allons, mes camarades,
Volons en Terre-Sainte et jouons aux Croisades.
Ce côté de la cour est le camp des Chrétiens ;
Les Sarrasins sont là… Dieu maudisse ces chiens !
Vite! divisons-nous en une double bande.
Moi, je ferai le chef des Croisés.
Qui demande A faire le Soudan, pour se battre avec moi ? »
Mais voilà le héros qui tressaille d’effroi…
Devinez le danger que son regard redoute :
De la cour du donjon il a vu, sous la voûte,
Apparaître et courir vers lui, d’un pas tremblant,
Sa vieille gouvernante et son couvre-chef blanc.
—« Laissez-là tous vos jeux, monseigneur, le temps presse :
Vous verrez qu’aujourd’hui nous n’aurons pas la messe.
Si j’en crois le soleil, neuf heures vont sonner,
Et nous n’avons qu’une heure au plus pour déjeuner. »
— « C’est toujours, dit Clisson, toujours la même chose!
Madame à tous les jeux qui me plaisent s’oppose :
Pour cette raison-ci, pour cette raison-là.
Quand reviendra mon père, il mettra le holà.
J’ai sept ans bien comptés. A cet âge, madame,
C’est honteux de plier sous la main d’une femme.
J’aurai pour gouverneur quelque vieil écuyer :
Alors plus de sermon qui me vienne ennuyer.
Des récits de combats, des chevaux et des armes ! »
Soudain voyant la duègne essuyer quelques larmes,
L’espiègle enfant s’apaise et lui sautant au cou :
— « Vraiment, vous êtes folle autant que je suis fou ;
Allons, ne pleurez plus, et baisez-moi, ma bonne :
Je vous garde en mon cœur une place, et bien bonne ! »
Et la vieille sourit : — « 0 le méchant garçon !
Comme on le haïrait, s’il n’était pas si bon.
Mais venez sans retard, beau général d’armée :
Le déjeuner attend votre troupe affamée. »
Les guerriers au teint rose hésitent par orgueil ;
Mais, échangeant entre eux un éloquent coup d’œil,
Bientôt chacun reprend son surcot et se pare ;
Oublieux des lauriers promis, on se prépare
A fêter comme il faut le friand déjeuner.
Se laissant par la faim lui-même aiguillonner,
Olivier, de son père imitant la démarche,
Va se placer en tête et crie : « En avant, marche! »
Sarrasins et Croisés, devant la table assis,
Immolent au plaisir la gloire et ses soucis.
Le repas est joyeux, le repas est splendide ;
Mais la Prudence même en personne y préside :
La gouvernante est là, qui surveille, et sa main
Sait tempérer la soif et modérer la faim.
Aucun excès ici ne trouvera passage
Et, jusqu’au plus gourmand, chacun restera sage.
Une joue un peu rouge, un œil un peu brillant,
Parfois, peut-être, un geste un peu trop sémillant,
Quelque soudain éclat de rire qui s’envole,
C’est tout ce qu’on permet à cette troupe folle ;
Mais cette retenue ajoute à sa gaîté :
Le tombeau du plaisir, c’est la satiété.
Les cloches cependant sonnaient à Notre-Dame .
— « Amis, dit Olivier, l’église nous réclame
Et l’objet de la fête est un doux aiguillon ;
Mais avant d’obéir au pressant carillon,
Pour la dernière fois remplissons notre verre,
Et trinquons tous ensemble au retour de mon père.
Qu’il vienne, et je réponds qu’à ses côtés assis,
Vous pourrez écouter de beaux et longs récits ;
Car voilà bien longtemps qu’il cueille de la gloire,
Et vous ne pourriez pas boire à chaque victoire. »
Chaque enfant applaudit, et tous à l’unisson,
Verre en main, ont crié trois fois : « Vive Clisson ! »
II. – L’UNIQUE VŒU D’UNE MÈRE.
La salle tout à coup s’ouvre, et la châtelaine
Apparaît sur le seuil, souriante et sereine.
Jeanne, hélas! n’est plus jeune et les soucis cuisants
L’ont effleurée ; eh bien, les soucis ni les ans
A sa grave beauté n’ont pu porter atteinte :
Seulement elle a pris un peu l’air d’une sainte.
Dans son port imposant, sur son front, dans son œil,
Règne la majesté, mais exempte d’orgueil
Et laissant deviner la bonté de son âme,
Comme à travers l’albâtre on voit luire une flamme.
— « Enfants, je vous bénis, » dit-elle, en s’avançant ;
Puis, leur jetant à tous un regard caressant :
— « La loyauté me plaît sur une jeune bouche ;
Votre long cri d’amour part du cœur et me touche.
Je vous en remercie au nom de mon époux. »
Et prenant une coupe : « Enfants, je bois à vous.
Puissiez-vous être heureux ! Puisse pour vous la vie
S’écouler sans douleurs, sans remords, sans envie !
» Le maître et le vassal, d’après nos vieilles lois,
Ont chacun leurs devoirs comme chacun leurs droits ;
Les services reçus doivent toujours se rendre :
Si nous vous protégeons, vous devez nous défendre,
Mais à qui nous défend nous devons sûreté.
A ces antiques mœurs gardez leur pureté :
Que l’avenir vous trouve, imitant nos ancêtres,
Vous , fidèles vassaux, et mes enfants, bons maîtres.
» Oh ! ce n’est pas assez de nos serments humains :
Dieu seul lie à jamais les cœurs comme les mains.
Prions donc, chers enfants, et les uns pour les autres ;
Vous, priez pour les miens, je prîrai pour les vôtres.
Tenez ! mon Olivier est votre jeune ami,
Et jamais son grand cœur rie se donne à demi ;
Eh bien, quand nous serons ensemble à Notre-Dame,
Unissez-vous à moi de la bouche et de l’âme.
Je n’adresse pour lui qu’une prière à Dieu ;
Joignez vos vœux ardents à mon unique vœu :
Puisse mon fils avoir le destin de son père ! »
— « Je lui ressemblerai, sois-en sûre, ô ma mère. »
Et les enfants émus criaient : « Vive Clisson ! »
— « Madame, pressons-nous ! voici le dernier son.
Et c’est pour Monseigneur que la messe se chante ! »
— « Oh! nous avons le temps, ma chère gouvernante.
Dit Olivier, d’un ton aussi fier que moqueur ;
Les Clisson ont leur banc à la droite du chœur. »
Bientôt vers Notre-Dame, en pompeux équipage,
Avec clairons sonnants, force archers et maint page,
Tout Clisson vit passer, au milieu de ses cris,
Jeanne, que précédaient ses filles et ses fils.
Dans l’enceinte du chœur, clos d’élégants balustres
Et paré des tombeaux de ses aïeux illustres,
La maison de Clisson prend place au banc d’honneur.
Clisson à Notre-Dame est patron et seigneur :
Aussi, pour Olivier quels indicibles charmes !
Aux vitraux comme aux murs resplendissent ses armes.
Son front devient hautain , ses yeux éblouissants,
Lorsque devant sa mère il voit fumer l’encens,
Mais surtout quand le prêtre entonne la prière
Où retentit le nom de son glorieux père.
Quel bonheur, quel orgueil d’être né de celui
Que le ciel et la terre acclament aujourd’hui
O vanité de l’homme! O nuage! O fumée!
Paille un instant brillante et bientôt consumée !
Ces soldats , ces blasons, ces pompeux attributs,
Ces honneurs dont l’orgueil savoure les tributs,
Ces vœux de longue vie et d’avenir prospère,
La Mort en rit de loin, ô pauvre enfant sans père.
Quand le cortége fut rentré dans le château
Et de la haute porte eut dépassé l’arceau :
— « Enfants, dit Jeanne, allez sur les bords de la Sèvre ;
Ce soleil trop ardent vous donnerait la fièvre.
Pour courir à votre aise ou pour dormir en paix,
Vous aurez dans le parc des ombrages épais ;
Mais songez, chers petits, à vos mères craintives
Et n’allez pas jouer follement près des rives.
Mon fils vous rejoindra dans quelques courts instants ;
Nous avons à causer de sujets importants. »
III. – LES EFFUSIONS D’UN CŒUR HEUREUX.
Quand la mère et le fils, dans leur course inégale,
Eurent atteint tous deux la vaste et riche salle,
Dont le soleil ardent enflammait les vitraux,
Jeanne amortit ces feux sous les épais rideaux,
Et, serrant dans ses bras, comme une douce proie,
Cet enfant bien-aimé, son orgueil et sa joie :
— « Te souviens-tu, dit-elle, Olivier, de ce jour
Où d’Herblain, avec toi, j’attendais le retour ?
Comme mon cœur navré cachait mal ses alarmes !
Comme mes pauvres yeux étaient noyés de larmes ! »
— « Oui, ma mère adorée, oh ! oui, je m’en souviens,
Et tu sais que mes pleurs se mêlèrent aux tiens. »
« Eh bien, cher Olivier, à cette même place,
Seule avec mon enfant, que dans mes bras j’enlace,
J’attends encore Herblain ; mais mon œil est joyeux
Et, comme ce beau ciel, mon cœur est radieux.
Cet invincible effroi dont j’étais consumée
S’est dissipé dans l’air, sans laisser de fumée.
» Je suis brave : j’entends autour de nos crénaaux
Croasser tout le jour des bandes de corbeaux ;
J’entends hurler des chiens, j’entends crier l’orfraie :
Je suis toute à l’espoir, et rien, rien ne m’effraie.
Il ne me manque plus, pour être en plein bonheur,
Que ton père à mes pieds, ou plutôt sur mon cœur.
» Cette joie, où mon âme est sans cesse tourné,
Ne saurait, doux ami, longtemps être ajournée ;
Elle approche, elle approche, et je la sens venir.
Oui, nos pressentiments devancent l’avenir.
Comme un marin, voguant vers des îles lointaines,
Sans les voir les salue, aux odeurs incertaines
Qui viennent jusqu’à lui sur les ailes du vent,
Mon bonheur se devine aux parfums qu’il répand,
Et mon cœur enivré les boit et les savoure.
» Ton père, déployant sa force et sa bravoure,
A conquis à son bras les honneurs du tournoi,
Devant ses envieux ! et sous les yeux du Roi ! ! !
Ses lettres m’ont appris la lutte et la victoire.
» Et maintenant qu’il est rassasié de gloire,
Maintenant que la Paix, descendue à nos vœux ;
Nous permet d’espérer des jours moins orageux,
Mon époux, affamé de nos douces caresses,
Répondra sans retard au cri de nos tendresses.
Pour ne plus nous quitter désormais réunis,
Nous verrons fuir nos jours tranquilles et bénis. »
— « Je me reprocherais toute pensée amère,
Mais pourquoi donc Herblain revient-il seul, ma mère ? »
« Il vient nous apporter quelque gage d’amour,
Et le jour qui l’amène est toujours un beau jour.
» Cher fils, qui consolas souvent ma solitude,
Pour charmer tes ennuis et t’adoucir l’étude,
J’aimais à te montrer les splendides dessins
Dont j’ai fait imager pour toi nos Livres saints.
Tu te souviens que Dieu, bon mais sévère juge,
Sur l’univers coupable étendit le déluge.
Tu vois cette maison, que porte un grand bateau
Et qui flotte à tous vents sur les déserts de l’eau.
Noé seul était juste, et le vieux patriarche
Put, avec ses enfants, se sauver dans cette arche,
Asile ouvert par couple à tous les animaux,
Qui vécurent en paix dans ses flancs colossaux .
» Ne vois-tu pas voler vers la fenêtre ouverte
La colombe, tenant au bec sa branche verte ?
Le doux oiseau disait à ces pauvres reclus
Que les eaux s’abaissaient et qu’il ne pleuvait plus.
La justice divine était donc satisfaite,
Et rien qu’à cet espoir tout leur cœur fut en fête ;
Car l’espoir leur montrait, après un long adieu,
La terre sous leurs pieds, sur leurs fronts le ciel bleu.
» Eh bien, l’oiseau béni, la charmante colombe,
Qui me rendrait l’espoir même au bord de la tombe,
Devines-tu qui c’est ?… Ce n’est pas vous, seigneur :
Vous n’êtes pas l’espoir, vous êtes le bonheur !
C’est… mais je ne sais pas si je dois te le dire ;
Je vois ton œil malin qui s’apprête à sourire.
» Malgré son front austère et ses sourcils épais,
Herblain est pour mon âme un messager de paix.
Oui, quand le bon vieillard apparaît, ma souffrance
Se calme et tout mon cœur resplendit d’espérance ;
Car ton père m’a dit, au moment des adieux :
Herblain vous portera mes messages heureux.
Voilà pourquoi, mon fils, quoiqu’il soit seul, j’espère ;
Et si sa lettre omet de parler de ton père,
C’est qu’en ami fidèle, il veut de vive voix
Nous conter en détail ses splendides exploits.
» Et qui sait ? cher enfant, je me trompe peut-être,
Mais peut-être qu’aussi, s’il quitte ainsi son maître,
C’est que dans ce château vit un jeune seigneur,
Qui hait sa gouvernante et veut un gouverneur.
Depuis qu’il est sorti de sa septième année,
Sa fierté rougit d’être aux femmes condamnée :
Pour la soumettre au joug et la faire plier,
Il faut un vieux soldat au gantelet d’acier.
Tu ne supportes plus cette plaisanterie
D’un balai pour cheval, d’un coin pour écurie. »
— « Fille des Belleville et femme des Clisson,
Ma mère, respectez l’honneur de votre nom…
Je t’aime, et tu le sais sans que je te le jure,
Mais le sang dont je sors ne souffre pas l’injure.
Peux-tu parler de joug en parlant de ton fils ?
C’est bon pour les vilains ou pour nos ennemis.
Devant ce mot honteux, oh ! tout mon cœur tressaute
Un joug ! pour le porter, j’ai la tête trop haute ;
Il n’est pas né le bras qui la fera plier. »
Sa mère l’embrassant : « Pardon, mon Olivier,
J’ai tort; j’ai voulu rire… Oui, ta fierté, je l’aime.
Au beau front que je baise il faut un diadème. »
— « Non, ma mère, la gloire est tout ce que je veux. »
— « Oh ! tu n’as pas besoin pour cela de mes vœux :
Garde la noble ardeur qui bouillonne en tes veines,
Et tes ambitions ne resteront pas vaines.
IV. – UNE LEÇON DE CHEVALERIE.
» Pour endurcir ton corps et pour te préparer
Au poids des grands honneurs dont Dieu veut te parer,
O mon bel enfant blond, ô mes chères délices,
Herblain va te soumettre à de durs exercices.
Tous ces périls , je sais qu’ils te plairont à toi ;
Mais, mon fils, sois prudent et songe à mon effroi. »
— « Mère, la lâcheté ressemble à la prudence
Et je ne saurais pas faire la différence.
Prudentj non, mais adroit; ainsi donc, ne crains rien,
Car ce qui plaît à faire, on le fait toujours bien ;
Et pour m’encourager aux choses les plus belles,
Mon père et mes aïeux seront de bons modèles.
Mon bon père surtout, la fleur des chevaliers,
Puisque la paix le rend enfin à nos foyers,
M’offrira ses leçons et son expérience,
Pour monter à cheval, pour manier la lance,
Et l’épée, et la hache, et la masse d’airain,
Tout ce qui d’un soldat peut illustrer la main.
Un héros comme lui, que toute voix renomme,
Saura de son enfant aisément faire un homme.
» Si la guerre alors souffle aux clairons redoutés,
Quel bonheur de pouvoir combattre à ses côtés !
» Plus tard, si, les cheveux blanchis dans la victoire,
Il trouve le repos permis à tant de gloire,
Eh bien, mère, aux combats je le remplacerai,
Et je ferai, crois-moi, du mieux que je pourrai ;
Puis, si je réussis autant que je le pense,
Un baiser de vous deux sera ma récompense. »
— « Va donc, ô noble enfant ; suis ta vocation
Et joins à mon amour mon admiration.
Mais pendant que je tiens ta joue aux teintes roses,
Je veux, je dois ici te commander trois choses.
Comprends bien, c’est un ordre et non un simple vœu.
» La première est, mon fils, de craindre et servir Dieu.
Que jamais de plein gré ton âme ne l’offense.
Dis-toi toujours, partout : Je suis en sa présence ;
L’acte que je médite à ses yeux est-il bien ?…
Et ne l’accomplis pas, si le doute te vient.
» Il nous a tous créés et lui seul nous fait vivre ;
Du mal et du péché c’est lui qui nous délivre ;
Sans sa grâce, aucun bien ne peut germer ici,
Et là-haut, de lui seul nous espérons merci.
Le soir et le matin fais-lui donc ta prière,
Et sa main t’aidera partout dans ta carrière,
Dont le but est l’honneur, mais surtout le devoir. »
— « Mère, je prîrai Dieu le matin et le soir. »
— « Mon second ordre, c’est, si haut qu’on te renomme,
D’être doux et courtois envers tout gentilhomme.
Sois humble sans bassesse et digne sans orgueil ;
Qu’on trouve ouverts toujours et ton cœur et ton seuil;
Sois serviable à tous et plein de complaisance ;
Ne permets à ta lèvre aucune médisance ;
Juge tout avec calme et sans sévérité ;
Quoi qu’il puisse advenir, aime la vérité,
Ne mens jamais, jamais ! mentir est un opprobre.
Dans la soif et la faim montre-toi toujours sobre
» Étouffe en toi l’envie et, comme un noble cœur,
Estime tes rivaux, au besoin, ton vainqueur.
Mais ne t’abaisse pas jusqu’à la flatterie ;
Pas de méchants rapports et pas de fourberie :
Délateurs et flatteurs sont toujours méprisés,
Vils instruments qu’on brise, à peine utilisés.
N’engage pas ta foi pour un sujet frivole,
Mais quand tu l’as donnée, ami, tiens ta parole ;
Dans tes faits, dans tes dits, sois à ce point loyal,
Qu’un seul mot de toi vaille engagement royal ;
Que le pauvre orphelin, la veuve misérable,
Quand ils t’invoqueront, te trouvent secourable,
Et sois certain que Dieu t’en récompensera. »
— « Ce que vous avez dit, ma mère, on le fera…
Je ne vois que l’orgueil qui puisse un jour me mordre :
Je le surveillerai. »
— « Voici mon troisième ordre.
La loi de Jésus-Christ est une loi d’amour :
De tous les biens que Dieu peut t’accorder un jour,
A tous nécessiteux fais une part bien large ;
La charité n’est pas une onéreuse charge,
Et donner pour l’ honneur et l’amour de son Dieu,
N’a jamais appauvri nul homme en aucun lieu.
Va ! c’est un bon calcul que d’être charitable ;
A l’âme comme au corps l’aumône est profitable. »
— « Chaque fois qu’on tendra la main à votre fils,
Votre fils donnera, sans songer aux profits. »
— « Au nom des malheureux je recois ta promesse.
Voilà, mon cher enfant, tout ce que ma tendresse
Désirait épancher de mon cœur dans ton cœur.
S’il me faut te céder aux soins d’un gouverneur,
La séparation en sera moins amère. »
— « Oh ! laisse-moi tomber à tes genoux, ma mère :
J’accepte avec bonheur ton bon enseignement
Et je t’en remercie, ô ma mère, humblement.
Aussi longtemps que Dieu voudra me faire vivre.
Tes conseils bien-aimés, je veux en tout les suivre.
Que Dieu me vienne en aide, et j’engage ma foi
Qu’un jour ton Olivier sera digne de toi. »
Sa mère le couvrit de baisers et de larmes :
— « De quelle douce fée as-tu reçu tes charmes,
Pour m’émouvoir ainsi jusqu’au fond de mon cœur ?
Mon bonheur trop complet me ferait presque peur :
Heureuse comme mère, heureuse comme épouse,
Quelle femme de moi ne serait pas jalouse ?
« Allons, va retrouver tous tes jeunes amis ;
Ils t’attendent là-bas et tu leur es promis. »
Olivier l’embrassa sur l’une et l’autre joue,
Puis, lui faisant de loin une joyeuse moue,
Gai gonflement de lèvre où chante le baiser,
Comme ces nids d’oiseau qu’avril entend jaser :
— « J’y vais, mais vienne Herblain, je le saurai, j’espère ;
Je tiens au long récit des exploits de mon père. »
— « Partez, petit despote, on vous obéira :
Sitôt Herblain venu, l’on vous en préviendra. »
— « Je pars, mais n’allez pas pleurer en mon absence…
Ou bien je vous mettrai, Madame, en pénitence ;
Car vous m’avez déjà trompé plus d’une fois. »
— « Oui, mais je ne suis plus triste comme autrefois
Et je n’ai plus besoin de forcer mon courage :
Mon cœur rasséréné n’a plus un seul nuage,
Et, comme l’alouette en un ciel éclatant,
L’espérance y gazouille et s’élève en chantant. »
V. – LE BOURREAU DE NANTES.
Le même jour où Jeanne, autrefois si peureuse,
Reprochait presque à Dieu de trop la rendre heureuse,
Le bourreau, s’arrachant aux douceurs du sommeil,
Devançait sur sa tour le lever du soleil ;
Et là, seul et debout, il voyait, grand et sombre,
Le nord dans les lueurs et le midi dans l’ombre ;
Car l’on était encor dans un de ces longs jours
Où l’astre roi des cieux élargit son parcours.
Il regarde pâlir la lune et les étoiles,
A la clarté de l’aube entr’ouvrant ses longs voiles,
Faits des blanches vapeurs qu’exhale le Marais ;
Sa poitrine avec joie aspire cet air frais.
Il écoute, à ses pieds, le murmure de l’Erdre,
Dont l’eau va lentement dans la Loire se perdre
Et, tout autour de lui, ce bruit vague, incertain,
Qui monte de la ville ou qui vient du lointain.
Le ciel resplendissait d’une beauté si pure,
Tout était si charmant dans toute la nature,
Que le bourreau restait lui-même émerveillé
Et ne regrettait pas trop de s’être éveillé.
Mais on n’est pas bourreau pour rêver comme un homme ;
Secouant la langueur qui reste d’un long somme,
Le sombre exécuteur bientôt se rappela
L’ordre qui de son lit l’avait fait venir là.
Le bras chargé d’un bois long et d’un sac difforme,
On vit son spectre noir quitter la plate-forme.
Bientôt il reparut au sommet de l’arceau
Qui, découpant dans l’air son quadruple créneau,
L’une à l’autre liait les deux tours de la porte
Qu’au-devant du Marchix ouvrait la ville forte ;
Car dans ces temps anciens, moins loyaux qu’on ne croit,
Où la force usurpait trop souvent sur le droit,
Nantes s’était armé d’un corselet de pierre,
Qui venait se boucler à la Porte Saint-Pierre.
Déposant sur le mur son sac brun, le bourreau
Glisse aux anneaux de fer destinés au drapeau
Dans les jours de combat ou de réjouissance,
Son long bois, qui, debout, reprend son air de lance ;
Puis du sac il retire, oh ! l’horrible trésor !
Une tête coupée et qui suinte encor ;
Et, sans être effrayé de son pâle visage,
La soupèse en sa main et dit : « Ah ! c’est dommage !
Cet homme-là devait être bien vigoureux…
Mais ces barons sont fiers et c’est bien fait pour eux. »
Et l’aube souriait à ces choses funèbres !
Lui, mettant à profit les restes de vertèbres,
Dans le fer de la lance, aiguisée avec soin,
Fait entrer cette, tête, en la frappant du poing ;
S’assure, d’une main que l’art a faite habile,
Qu’au bout du bois infâme elle est bien immobile
Et pourra résister aux rafales du vent ;
Puis, jetant un coup d’œil du côté du Levant,
Dont la blanche lueur s’anime et devient rose :
— « C’est bien ! le soleil dort et la ville repose ;
Personne n’a pu voir ce que j’ai fait ici.
De ce qu’il adviendra je n’ai pas de souci :
L’important est pour moi que mon œuvre soit faite,
Sans qu’un maudit caillou vienne troubler la fête.
Les Nantais n’aiment pas à me voir travailler
Et sans cesse avec eux il me faut chamailler :
Sous ma tour dans une heure ils aboîront encore…
Je crois que j’ai bien fait de devancer l’aurore. »
Comme il allait partir, un énorme caillou
L’atteignit en plein cœur, lancé je ne sais d’où,
Mais lancé d’une main forte, quoique perverse,
Car le bourreau tomba du coup à la renverse,
En poussant un grand cri que l’écho quadrupla.
Quand il reprit ses sens, Herblain n’était plus là.
Des bourgeois, des marchands, des gens de toute sorte
Causaient, les yeux levés sur l’arceau de la porte,
Et chacun demandait, mais en baissant la voix,
Quelle était cette tête au haut de ce long bois.
A qui donc et pourquoi servait-elle d’exemple ?
La foule, à chaque instant plus pressée et plus ample,
Accourait de la ville et surtout du Marchix.
Les questions bientôt dégénèrent en cris.
Laissant à qui de droit le souci d’y répondre
Et redoutant de voir sur lui l’orage fondre,
Le bourreau remonta se cacher dans sa tour :
Les animaux de proie ont, dit-on, peur du jour.
O ma chère Bretagne, ô ma noble patrie,
La trahison chez nous fut en tout temps flétrie ;
Comme sur ton écu, que le temps a rouillé,
On peut lire en nos cœurs : « Plutôt mort que souillé ! »
Mais que Clisson fût traître, on ne pouvait le croire :
Si noble, si puissant, si riche, et plein de gloire,
Qu’avait-il à gagner en trahissant le Roi,
Auquel il n’engagea que librement sa foi,
Car ce roi n’était pas légalement son maître ?
Sur d’autres que Clisson tombe ce nom de traître ;
Son jugement n’a pas taché sa loyauté ;
Pour les Bretons, sa mort n’est qu’une cruauté.
Et comme ces propos couraient tout haut dans Nante,
On récolta la haine, en semant l’épouvante.
VJ. – LA FUITE D’HERBLAIN.
Herblain, dès que sa pierre eut puni le bourreau,
Gagna d’un pas furtif la pente du coteau,
Que nos aïeux, suivant la mode alors dévote,
Nommaient parfois la Butte et plus souvent la Motte
Saint-Nicolas, et qui, planté d’ormeaux épais,
Offrait aux promeneurs la fraîcheur et la paix.
Se glissant d’arbre en arbre et protégé par l’ombre
Du feuillage touffu que l’aube laissait sombre,
Il atteignit bientôt, sans qu’on eût pu le voir,
L’étroite rue à pic tombant à l’Abreuvoir.
Un bateau l’attendait dans un repli de l’Erdre.
Sachant que tout moment perdu pouvait le perdre,
Il saute dans l’esquif et, de la tête aux reins
Se couvrant du caban que portent les marins,
De sa gaffe, appuyée avec force à la rive,
Dégage son canot, qui s’ébranle et dérive ;
Puis de deux avirons maniés avec art
Promptement et sans bruit nage au pied du rempart,
Qui, se tournant soudain vers les eaux, les traverse
Sur l’arcade d’un pont, clos la nuit d’une herse.
La herse était baissée, et sur les cieux obscurs
Un homme apparaissait au haut des Petits-Murs .
Sous cet œil vigilant et devant cet obstacle,
Nul ne peut en secret passer, sans un miracle.
Mais le gardien du pont, du vieil Herblain connu,
Fait remonter la herse au signal convenu ;
Et le bateau , glissant entre la double pile,
S’élance sans encombre au milieu de la ville.
Nul ne soupçonnerait ce qu’était l’Erdre alors.
Son nom seul, chez quiconque a visité ses bords,
Évoque un souvenir de rives enchantées,
Qui disputent le prix aux eaux les plus vantées ;
Mais, après la Chaussée, œuvre de saint Félix,
L’Erdre prenait soudain l’air lugubre du Styx.
On eût dit qu’aux abords de la ville, son onde
Se gâtait au contact de quelque lèpre immonde,
Et la rivière calme aux paysages frais,
S’étalant dans les joncs, n’était plus qu’un marais
Où, le long des remparts, se traînaient des eaux lentes,
Couvertes tout l’été de vapeurs pestilentes,
Et qui, dans Nantes même, offrait èncor l’aspect
D’une mare croupie et d’un cloaque infect.
Aussi des Petits-Murs au Carrefour du Change,
Tous les pignons tournaient le dos à cette fange ;
Sauf sur un pont de bois, dont les vieilles maisons
Respiraient forcément cet air lourd de poisons.
Un peintre en eût peut-être admiré les façades,
Mais à leurs bois pourris on les sentait malades.
Telle se montrait l’Erdre au temps de mon récit.
Descendant le chenal que l’été rétrécit,
Herblain, tout en ramant, scrute au loin chaque rive,
S’arrêtant dès qu’un bruit à son oreille arrive ;
Mais tout se tait encor dans la grande cité ;
D’ailleurs le caban brun dont il est abrité
Écarte tout soupçon, si quelqu’un le remarque.
Le pêcheur apprêtant ses filets dans sa barque,
L’ouvrier qui se lève et regarde le jour
Et le soldat de veille au haut de chaque tour,
Tous suivent d’un coup d’œil curieux, mais tranquille,
Et cette eau qui s’éclaire et cet esquif qui file.
Gagnant, entre deux ponts, une sorte d’étang
Qu’un lourd brouillard couvrait.de son voile flottant,
Herblain, presque invisible à travers cette brume,
Avait passé sans bruit dans la verdâtre écume
Amassée aux piliers du premier des deux ponts,
Ouvrant sa rue oblique à deux rangs de pignons
Et qu’on nommait alors pont de la Mercerie.
Déjà sa barque touche au pont de Casserie,
Qui, simple et nu, permet de regarder sur l’eau ;
Quand un homme, enfermé dans un vaste manteau,
Au garde-fou se penche et lui crie à voix basse :
« Herblain, oh ! si c’est vous, arrêtez-vous, de grâce ! »
Herblain, qui n’est pas sûr de déguiser sa voix,
Sans même dire non, franchit le pont de bois
Et, de toute sa force appuyant sur sa rame,
S’éloigne en toute hâte et le trouble dans l’âme.
VII. – LE RATEAU DE L’ERDRE.
Mais d’où vient que sa main ralentit son bateau ?
C’est qu’il voit devant lui les barres du râteau
Qui clôt pendant la nuit l’embouchure de l’Erdre.
Tant de soins et d’efforts, hélas ! vont donc se perdre !
Car, large de vingt pieds sur vingt pieds de hauteur,
L’immense grille en bois a trop de pesanteur,
Pour que, malgré sa force, Herblain seul la soulève.
D’ailleurs , sous les clartés de l’aube qui se lève,
Quand même ses efforts parviendraient à l’ouvrir,
Si le guet, qu’il entend, vient à le découvrir,
Le vieux et noir Bouffay, dont l’imposante masse
A sa gauche se dresse et semble une menace,
Peut refermer sur lui les murs de sa prison :
Et qui donc préviendra la veuve de Clisson ?
Mais Herblain moins que nous du râteau s’inquiète ;
Miaulant faiblement comme fait la chouette,
Il écoute, et bientôt sur la Loire il entend
Se répéter le cri que son oreille attend ;
Puis, un instant après, il voit contre la herse
Un homme en un canot, que le flot montant berce.
—« Guéneuf, est-ce bien vous? — Oui, maître Herblain, c’est moi.
Depuis une heure au moins ici je me tiens coi ;
Mais je vous appartiens tout entier, corps et âme
Depuis que vous m’avez fait épouser ma femme. »
« C’est bien. Approchez-vous en travers du râteau. »
Et lui-même à la grille amarrant son bateau,
Pour qu’il offre à son pied un appui plus solide,
Herblain saisit sa gaffe et, d’un effort rapide,
Pesant sur le barreau qui semble le moins neuf,
Se fait un jour et passe au bateau de Guéneuf.
Comme il veut de sa fuite écarter toute marque,
Il laisse son caban sur les bancs de sa barque,
Et, des mains de Guéneuf ayant pris un manteau,
D’un gros tolet de fer, qui lui sert de marteau,
Il fait rentrer la barre au fond de sa mortaise.
— « Que votre langue, ami, soit discrète et se taise
Sur tout ce qu’ont pu voir ou que verront vos yeux :
J’ai mes raisons pour être ainsi mystérieux. »
— « Je suis un peu bavard, c’est vrai, comme aubergiste,
Répond Guéneuf, d’un ton moitié gai, moitié triste ;
Mais le vieux soldat peut conserver ses secrets,
Et je sais, pour causer, trouver d’autres sujets. »
« Eh bien, qu’aujourd’hui donc votre talent s’essaie,
Et, sans plus de retards, nageons vers la Saulzaie . »
Sur leur rame, à ces mots, ils se courbent tous deux,
Et le canot, prenant un élan vigoureux,
Sous le coup cadencé de sa double nageoire,
Remonte obliquement le courant de la Loire,
Que le soleil levant couvrait de ses splendeurs.
Le vent et la marée aidaient aux deux rameurs,
En refoulant les eaux du côté de leur source ;
Aussi, quoique forcés d’éviter, dans leur course.
Vingt embarcations creusant, dans tous les sens,
Sous le jour qui renaît, le fleuve aux flots puissants,
Sans retard et sans peine ils accostent la grève,
Où de grands saules gris un long cordon s’élève.
Ces rivages, alors déserts, sont le berceau
Des splendides maisons de notre Ile Feydeau.
Quand à l’un des gros pieux enfoncés dans le sable
La barque fut fixée, à l’aide d’un fort câble ;
Quand chacun eut de l’œil fouillé tout l’horizon
Et fut sûr de n’avoir éveillé nul soupçon,
Le couple disparut sous un rideau de saules.
Là, rendant le manteau qui couvrait ses épaules :
—« Quittons-nous, dit Herblain, car, pour fuir tout danger,
Je ne veux pas qu’on sache où je dois me loger;
Donc, pendant que je vais remonter cette berge,
Allez seul, mon ami, m’attendre à votre auberge.
Sans doute qu’avant peu je vous y rejoindrai ;
Qu’en tout cas mon logis soit prêt quand je viendrai,
Et, veillez avec soin, si j’y viens, que personne,
Étranger ou valet, chez vous ne m’espionne. »
— « Maître, ne craignez rien, vous serez obéi :
Ce n’est pas chez Guéneuf que vous serez trahi.
Je vous servirai seul, et ma femme elle-même
Ne saura rien, si fort que son gros mari l’aime. »
VIII. – LES PONTS DE NANTES.
Guéneuf était parti depuis longtemps déjà,
Lorsquè de l’oseraie Herblain se dégagea.
Son immense douleur pâlissait son visage.
Les soucis de sa fuite, excitant son courage,
Avaient pu rejeter un moment dans l’oubli
Les souvenirs sanglants dont son cœur est rempli ;
Mais quand il se trouva seul avec sa pensée,
Il crut son énergie à jamais dépensée,
Tant il se sentit faible en son accablement.
Il invoqua la mort pour finir son tourment,
Et peut-être la Loire eût roulé son cadavre,
Si Dieu , pour alléger le chagrin qui le navre
Et qui lui fait souvent jeter les yeux sur l’eau,
N’avait dans son esprit retracé le tableau
De sa belle maîtresse, au calme et doux visage,
Lisant à ses enfants, comme un heureux présage,
La lettre dans laquelle, annonçant son retour,
Il lui laisse espérer encore un plus beau jour.
Son devoir qu’il comprend ranime son courage
Et, d’un pas résolu, s’éloignant du rivage,
A travers les osiers et de rares maisons,
Il arrive bientôt à la chaîne des Ponts ,
Qui s’allonge pendant plus d’une demi-lieue
Et forme à notre ville une longue banlieue ;
Mais, quoiqu’il ait repris ses forces, ses chagrins
Restent sur tous ses traits profondément empreints.
Il s’en allait traînant sa triste rêverie,
Quand, au tournant du pont de la Poissonnerie,
Quelqu’un qu’il ne voit pas, l’appelant par son nom,
Lui crie : « Attendez donc un ami de Clisson. »
Le fidèle écuyer, que cette voix consterne,
Voit, en se détournant, sortir de la Poterne
Un jeune chevalier, qui s’avance vers lui.
S’il l’avait cru possible, Herblain sans doute eût fui,
Car son âme est en proie à l’incessante crainte
De trouver un obstacle à sa mission sainte ;
Mais, la fuite pouvant devenir un danger,
Il affecte un air calme et marche à l’étranger.
Pendant que son esprit, qui s’inquiète, songe
A tromper le péril par quelque adroit mensonge,
Le chevalier l’a joint et lui serrant la main :
— « Silence ! dit-il bas, je sais tout, pauvre Herblain.
Ne parlons sur ce pont que de choses frivoles,
Mais cherchons un lieu sûr pour de graves paroles. «
« Votre air mystérieux, je ne le comprends pas ;
Je n’ai rien à cacher », répond Herblain tout bas.
« Me soupçonnez-vous donc de ruses déloyales ?
Eh bien, rien que deux mots : Montfaucon et les Halles! »
Herblain reprit tout haut : « Je vais aux Fleurs-de-Lis,
Venez-y, monseigneur ; l’hôte est de mes amis. »
Et tous les deux alors marchèrent côte à côte,
Affectant un air libre et parlant à voix haute ;
Mais tous deux, inquiets, s’assuraient avec soin
Qu’ils n’étaient surveillés ni de près ni de loin.
Non, la foule qui croît, affairée et bruyante,.
Vers la ville, autour d’eux, coulait indifférente.
C’était un jour de foire et, sur les ponts de bois,
Chevaux, bœufs et piétons les arrêtaient parfois ;
Mais ils s’applaudissaient de l’incessant obstacle
Qui dans leur but secret les servait à miracle ;
Car, dans ce tourbillon de peu ple, ils n’avaient pas
La crainte de laisser la trace de leurs pas.
Sur leur gauche bientôt, à l’angle d’une rue,
Une enseigne éclatante avait frappé leur vue :
Dans un écusson bleu brillaient trois fleurs de lis.
Herblain, montrant l’auberge au chevalier surpris,
Lui dit : « Pour des Français le gîte est bon sans doute,
Mais j’en sais un meilleur ; poursuivons notre route. »
— « Poursuivons notre route, avait dit l’inconnu ;
L’hôtel choisi par vous sera le bienvenu.
Un lieu discret et sûr est tout ce qui m’importe,
Pour les graves secrets que chacun de nous porte. »
— « Sachez donc, monseigneur, attendre ce lieu sûr.
Une rue a l’oreille aussi fine qu’un mur,
Et peut-être un seul mot suffirait pour nous perdre. »
— « J’ai cherché tout à l’heure à vous parler sur l’Erdre :
Là, pas un espion n’eût surpris nos propos. »
— « La rivière elle-même a souvent des échos ;
Je puis vous garantir qu’en mon hôtellerie
Nous serons beaucoup mieux qu’au pont de Casserie. »
— « Vous êtes un oracle, Herblain, et je me tais. »
Et nos deux compagnons, bien d’accord désormais,
Marchent sans échanger une seule parole,
De peur qu’à leur insu leur secret ne s’envole.
Quand ils eurent franchi le pont de Belle-Croix,
Noir sous le double rang de ses maisons en bois ;
Quand de la Magdeleine atteignant la chaussée,
Dans toute sa longueur ils l’eurent traversée,
Le pont du même nom déroula sous leurs yeux
Un de ces beaux tableaux dont Nante est orgueilleux.
Mais ces grands horizons où coule en paix la Loire,
Ce brouillard transparent, ce soleil dans sa gloire,
Blanchissant d’un rayon, là des prés verdoyants,
Ici les hauts sommets des arbres ondoyants,
Ces navires voguant le long des grandes îles
Ou dormant dans le port sous leurs mâts immobiles,
Ces maisons aux murs blancs au haut de noirs rochers,
Ce mélange de tours, de flèches, de clochers,
Que sais-je ? cet amas des plus charmantes choses
N’a pas le moindre attrait pour ces deux cœurs moroses.
Ils traversent le pont, sans même qu’un regard
Au sublime spectacle ait voulu prendre part.
Sur la Prairie au Duc, le laid faubourg des Biesses,
Dont le pont de Toussaint réunit les deux pièces,
Ouvre à leurs pas pressés ses défilés étroits ;
Puis voici devant eux le pont de Brise-Bois,
Où de noires maisons masquent de vertes îles.
Au moment de passer le court pont des Trois-Piles :
– « Ah ! ça, fit l’inconnu , dites-moi sans façon
Que l’entretien promis n’aura lieu qu’à Clisson,
Car vous me faites faire, Herblain, un vrai voyage :
Quand on a peu de temps, le perdre n’est pas sage…
Vous froncez le sourcil : j’ai donc tort et me tais. »
Ils poursuivent leur route et, dépassant Vertais,
Ce faubourg populeux, dont les deux vastes prées
Sont d’amont en aval par la Loire entourées,
Ils atteignent enfin le long pont de Pirmil,
Dont le nom est l’objet d’un si docte babil ;
Mais sa vue admirable et qui n’a pas d’égale,
Vainement à leurs yeux se déroule et s’étale.
Que leur font ces grands bois se mirant dans les eaux
Qui de Saint-Sébastien baignent les doux coteaux ?
Que leur font les rochers et le long pré de Mauves,
Dont l’herbe au soleil d’août a de si beaux tons fauves ?
Qu’ont pour eux de charmant ces filets de pêcheurs,
Et ces jeux de lumière, et ces tièdes fraîcheurs,
Et ces faubourgs assis en vaste amphithéâtre ?
Que leur fait ce grand fleuve et son mouvant théâtre,
Ses jaunes bancs de sable et ses profonds remous,
Plus loin son large lit au flot tranquille et doux,
Ici ses naufs légers fuyant chargés de toile,
Là ses chalands, si lourds sous leur immense voile ?
Que leur font ces îlots aux bleuâtres lointains ?
S’ils regardent la ville et ses créneaux hautains,
C’est que chacun nourrit un projet de vengeance
Contre cette cité vendue au roi de France.
Aux éclairs de leurs yeux leurs cœurs se sont compris
Et, sans s’être expliqués, ils se sentent amis.
Pendant que leur regard mariait sa menace,
Leurs pieds marchaient toujours et touchaient à la place
Qui devait voir surgir, quelque vingt ans plus tard,
Le château fort construit par l’amiral Bouchard
IX.- L’AUBERGE DU GRAND LION D’ARGENT.
Comme ils allaient du pont franchir la dernière arche :
– « Voici là-bas l’auberge où tendait notre marche,
Dit Herblain ; dans cent pas nous y serons rendus.
Nous pourrons y causer sans peur d’être entendus :
L’hôte est un vieux soldat de mon maître, et sa femme,
Élevée au château par les soins de Madame,
Fut par moi mariée au brave et gros Guéneuf,
Qui l’aime d’un amour de jour en jour plus neuf.
Il en parle sans cesse à qui veut bien l’entendre,
Et jamais tourtereau n’eut le regard plus tendre.
Tous deux pour les Clisson se jetteraient au feu :
Pour le mari, mon maître est presque le bon Dieu,
Et pour dame Guéneuf, Madame vaut la Vierge.
Leur dévoûment s’étale au-devant de l’auberge ;
Voyez leur Lion blanc à la couronne d’or :
Les armes des Clisson les protègent encor. »
Le fidèle Guéneuf se tenait sur sa porte ;
Pourtant dans son hôtel la cohue était forte,
Mais sa femme y pourvoit avec ses trois garçons.
Le compagnon d’Herblain éveille ses soupçons ;
Toutefois, au regard que ce dernier lui jette,
Il les conduit tous deux à sa chambre secrète.
La table était servie et servie avec soin :
— « Heurtez-là, si de moi l’un de vous a besoin ;
A vos ordres bientôt vous me verrez paraître.
Comment cela se fait ? C’est mon secret, mon maître. »
Et l’on entend Guéneuf descendre l’escalier.
« Discret et dévoué ! mais, dit le chevalier,
Il vaut son pesant d’or, votre gros aubergiste. »
Herblain distrait s’assied , et parcourt d’un œil triste
Cette chambre carrée aux grands panneaux de bois,
Où son bon maître et lui dormirent tant de fois.
Il en connaît à fond les plus secrets mystères,
Car, dans ces temps, troublés par d’incessantes guerres,
Le plus brave a souvent besoin de se cacher ;
Or, ici, les parois, le plafond, le plancher,
Sous de secrets ressorts, vous offrent des retraites
A la fuite, au repos, selon le besoin, prêtes.
Ce mystère a son bon et son mauvais côté :
Derrière ces panneaux, l’espion aposté
Peut surprendre aisément tout acte qui se passe
Et tout mot qui se dit ici, même à voix basse ;
Mais Herblain sait qu’il n’a rien à craindre aujourd’hui,
Sûr qu’il est de Guéneuf tout autant que de lui.
Entre ces pans de bois, tout chargés de sculptures
Dissimulant aux yeux de secrètes serrures,
Il en est un surtout qui du mâle vieillard
Semble, comme un aimant, attirer le regard :
C’est qu’en poussant du doigt l’œil de ce lion fauve,
Derrière les panneaux roulants, s’ouvre une alcôve,
Et c’est là, dans ce lit, sur ce blanc oreiller,
Qu’il a vu si souvent son maître sommeiller.
Mais cette belle tête aux grands traits héroïques,
Où brillait le sang pur des races germaniques,
Et dont, quand il veillait, la nuit, à son côté,
Son regard admirait la calme majesté,
Malgré tous ses efforts, il se la représente
Pâle et les traits crispés sur la lance infamante.
Sa pauvre âme gonflée éclate en longs sanglots,
Et ses pleurs, qu’il croyait taris, coulent à flots.
N’osant pas consoler d’une façon directe
Cette grande douleur qu’il comprend et respecte,
Le chevalier debout laisse pleurer Herblain ;
Mais enfin il s’approche et lui serrant la main :
—« De pleurer devant moi n’ayez honte ni crainte ;
Dans les yeux d’un vieillard les pleurs sont chose sainte,
Surtout quand ces pleurs, purs de toute lâcheté,
Ne sont que le tribut de sa fidélité.
Pleurez donc sur Clisson, l’honneur de la Bretagne,
Sur ses pauvres enfants, sur sa noble compagne,
Puisqu’on ne sait quel est, quand on pèse leur sort,
Le plus infortuné, des vivants ou du mort.
» Mais pour une maison de si haute noblesse,
La plaindre, quand on peut la venger, c’est faiblesse.
Si je vous ai compris, vous voulez la venger. »
Herblain, se redressant, regarda l’étranger ;
Un éclair d’espérance avait séché ses larmes :
— « Continuez. Parfois la vengeance a ses charmes. »
« La dame de Clisson a des soldats nombreux.
Des vassaux dévoués… des amis chaleureux :
Eh bien ! si vous voulez, je puis tripler sa force. »
— « Vous tendez pour me prendre une excellente amorce :
Qui me fait hésitant, ce n’est pas le danger…
Mais quels droits croyez-vous avoir de nous venger ?
Avant de discuter l’offre que vous me faites,
C’est le moins que j’apprenne, à l’instant, qui vous êtes. »
L’inconnu s’asseyant dit : « Vous avez raison
Et je suis sans motifs pour vous cacher mon nom.
Quand vous aurez reçu toute ma confidence,
Vous jugerez mon titre à votre confiance,
Mais, Herblain, mon nom seul m’y donne déjà droit :
Il est connu ; je suis Péan de Malestroit . »
— « Péan de Malestroit, recevez mon hommage :
Bien jeune, vous avez prouvé votre courage.
Je me trouverais fier de serrer votre main. »
Le brillant chevalier serra la main d’Herblain :
— « Quoique ma modestie aisément s’effarouche,
D’un soldat tel que vous le compliment me touche,
Car toute la Bretagne a connu vos beaux faits :
Des lauriers de Clisson vous partagiez le faix. »
— « Dans sa moisson de gloire, oh ! ma part fut modeste :
Quand il en avait trop, il me laissait son reste.
Il s’est trouvé parfois que le reste était bon.
Mais pourquoi faire ainsi rougir un vieux barbon ?
» J’ai connu votre père en plus d’une bataille ;
C’était un beau vieillard, droit et de haute taille,
Et lorsque ses deux poings brandissaient son estoc,
Bien fort était celui qui résistait au choc.
» Quand le duc Jean le Bon , Dieu bénisse ses cendres !
Accompagna le roi de France dans les Flandres,
Je revis votre père au milieu des barons
Qui derrière le duc déployaient leurs pennons.
Près de lui chevauchait votre frère Guillaume,
Et j’ai vu rarement plus grand air sous le heaume.
» Depuis notre retour en Bretagne, je crois
Les avoir rencontrés à peine une ou deux fois,
Mais j’ai bien souvent eu les oreilles remplies
Du bruit des actions par vous trois accomplies ;
Et vos nobles aïeux doivent être contents,
Car leur nom a gardé son éclat des vieux temps.
X. – LE COMPLOT.
» Parlez donc, monseigneur ; ma foi vous est acquise :
Vous ne pouvez rêver qu’une noble entreprise.
Pour venger son outrage et rétablir son droit,
Clisson peut accepter l’aide de Malestroit.
» Mais, ô mon Dieu ! j’y songe… A ce tournoi funeste,
Où, violant tous droits, ce roi que je déteste
Fit arrêter Clisson et douze autres seigneurs,
Dont le sort inconnu doit coûter bien des pleurs,
Je crois me rappeler, Péan, que votre père
Geoffroy de Malestroit, Guillaume votre frère,
Et vous peut-être aussi ? vous étiez attendus.
Si vous étiez venus, ah! vous étiez perdus ;
Car les vils promoteurs de l’infâme tuerie
Voulaient découronner notre chevalerie…
» Eh ! quoi! vous pâlissez !… Ah ! je vous ai compris :
Guillaume et Geoffroy sont. » — « Prisonniers à Paris !
Oui, le jour même, Herblain, où du plus lâche crime
Clisson, en plein tournoi, devenait la victime,
Mon vieux père et son fils, de gloire tout couverts,
Se sont vus arrêtés et chargés de vils fers…
Je ne sais quel hasard, interrompant leur route,
Ne les fit arriver qu’à la fin de la joute ;
Mais, comme ils franchissaient l’enceinte du tournoi,
Ils furent désarmés par le prévôt du Roi,
Puis jetés sans pitié dans la prison du Temple.
Du sort qui les attend Clisson nous sert d’exemple.
» Les parents, les amis d’Alain de Quédillac,
De Jean de Montauban, de Denis de Callac
Et des autres Bretons qu’une injuste colère
Garde sous ses verroux avec mon pauvre père,
Ont, d’accord avec moi, tour à tour concerté
Vingt projets pour leur rendre à tous la liberté. »
— « Absorbé tout entier par le sort de mon maître,
Vos douleurs, Malestroit, je n’ai pu les connaître :
En me citant les noms des preux chargés de fers,
On ne m’avait pas dit les noms qui vous sont chers. »
— « Nous voulions, quand nous vint la nouvelle fatale,
Les arracher de force à la prison royale.
Chacun à l’entreprise apportant ses efforts,
Et prêts, s’il le fallait, à vider nos trésors,
Nous avons réuni, par bandes différentes,
Plus de trois cents soldats dans la ville de Nantes.
Ce sont d’anciens routiers, et, préparés à tout,
Pourvu qu’ils soient payés, ils iront jusqu’au bout :
Vrais dogues, pour qui c’est un plaisir que de mordre,
Pour marcher sur Paris ils n’attendent qu’un ordre ;
Mais à peine à mi-route ils seraient parvenus,
Que leurs secrets desseins là-bas seraient connus.
Oui, quand leur but se trouve à si longue distance,
Ces coups de main hardis n’ont pas la moindre chance ;
Bien avant nos soldats, le bourreau serait prêt :
Philippe a sous la main son sanglant couperet.
Ainsi, de sa vengeance à notre insu complices,
Nos efforts n’auraient fait qu’avancer les supplices
De ces chers prisonniers, notre unique souci,
Depuis que nous savons Philippe sans merci.
» Substituant la ruse à la force impossible,
Pour ouvrir en secret ce Temple inaccessible,
Nous avons essayé de nombreuses clefs d’or :
La haine qui veillait de nous se rit encor.
Après avoir scruté, dans leur chance diverse,
Tour à tour les chemins directs ou de traverse,
Nous avons vu qu’aucun ne nous conduit au but :
Il ne nous reste, Herblain, qu’un moyen de salut.
» Si la mort de Clisson est largement vengée,
Si la noblesse, en lui se trouvant outragée,
Se soulève, et, marchant contre Charles de Blois,
Le punit de livrer ses amis au Valois,
Le Roi, qu’Edouard trois d’Angleterre menace,
En face du péril peut-être fera grâce. »
« Péan de Malestroit, si je vous ai compris,
L’aide que vous m’offrez, vous la mettez à prix.
Il faut que les enfants de Clisson et sa veuve
Fassent de votre plan, à leurs risques, l’épreuve. »
« Les risques, quels qu’ils soient, nous les partagerons :
Nous tomberons ensemble ou nous vous vengerons.
Sachez qu’un Malestroit n’a pas l’âme assez lâche,
Pour que, lorsqu’il convie à quelque rude tâche,
Dans le terrible enjeu son bras n’apporte rien :
Je demande du sang, mais j’offre aussi le mien.
» Oubliez-vous, d’ailleurs, la cruelle sentence
Qui, poursuivant Clisson jusqu’en sa descendance,
Prive à jamais ses fils de tous droits féodaux
Et livre aux mains du Roi leurs biens et leurs châteaux ? »
— « Oh ! vous ne savez pas tout ce que mon cœur souffre.
Pauvres enfants! tombés aux profondeurs du gouffre,
Pourront-ils remonter aux sommets radieux
Que leur avait conquis le bras de leurs aïeux ? »
— « La cime est escarpée et, s’ils veulent l’atteindre,
Le moyen le plus sûr, c’est de se faire craindre.
» Herblain, c’est dans ce but que je viens vous chercher :
Un mot, et nos soldats avec vous vont marcher. »
— « Ce mot, je le dirais, et d’une âme ravie,
S’il ne fallait risquer pour enjeu que ma vie.
Mais, fidèle vassal, je ne sais qu’obéir
Et me trouve trop vieux pour apprendre à trahir :
Or, je ne serais plus, même à vos yeux, qu’un traître,
Si, seul, sans consulter la veuve de mon maître,
J’attirais sur ses fils, en aggravant leur sort,
La persécution et peut-être la mort. »
— « Vos scrupules, Herblain, n’ont rien dont je me blesse ;
Allez donc consulter votre noble maîtresse. »
— « Jeanne de Belleville, avant qu’il soit midi,
Saura de point en point ce que vous m’avez dit.
Qu’elle accepte nos plans ou bien qu’elle y renonce,
Je vous rapporterai dès ce soir sa réponse.
A dix heures soyez dans ce même réduit
Et veuillez-y m’attendre au moins jusqu’à minuit.
» A marcher sans retard tenez prêtes vos troupes,
Ou plutôt, dès ce jour, dirigez-les, par groupes,
Sur les divers chemins qui mènent à Clisson,
De manière à ne pas éveiller le soupçon :
Plus je lui montrerai de moyens de défense,
Mieux Jeanne accueillera nos projets de vengeance. »
XI. – L’AUBERGISTE PRÉVOYANT.
Herblain, heurtant au point par leur hôte indiqué,
Sous le jeu d’un ressort secret et compliqué,
Fait entendre à Guéneuf un appel énergique.
Nul bruit n’a résonné dans la chambre magique,
Mais, un moment après, apparaît sur le seuil
Un gros homme joufflu, qui n’est pas sans orgueil.
— « Je ne me suis pas fait, messeigneurs, trop attendre. »
— « Fermez donc cette porte et veuillez bien m’entendre.
A dix heures du soir, ce gentilhomme-ci
Doit revenir chez vous et veut m’attendre ici,
Sans qu’aucun indiscret le voie ou le dérange.
A qui l’aurait suivi sachez donner le change.
Quant à moi, vous allez me seller à l’instant
Un cheval, car Madame avant midi m’attend. »
— « J’aurai dans un clin d’œil exécuté votre ordre.
Mais quoi donc ! à mon pain nul de vous ne veut mordre ?
Ces mets ont pourtant l’air assez appétissant
Et d’un mourant mes vins ranimeraient le sang…
Quels que soient les projets dont un brave s’occupe,
Il a tort de jeûner; c’est un métier de dupe.
L’estomac doit toujours venir en aide au cœur :
L’un donne le courage et l’autre la vigueur.
Par Satan !… non, que Dieu contre lui me protège !
Mais enfin, quand un fort est menacé d’un siège,
On a beau le bourrer d’armes et de soldats,
Pas de provisions, et le fort ne tient pas.
Ventre affamé n’a point de bras plus que d’oreilles ;
Videz donc, messeigneurs, ces plats et ces bouteilles :
Vous me ferez plaisir., et vous verrez chacun
Que l’homme bien repu vaut deux fois l’homme à jeun. »
Et le brave hôtelier, admirant sa faconde,
Sans attendre qu’Herblain ou son ami réponde,
Les force à s’assurer si ses vins et ses mets
Valent les compliments que sa voix en a faits.
Les deux nouveaux amis que la vengeance assemble,
Herblain et Malestroit sont descendus ensemble,
Montrant dans leurs regards échangés sur le seuil,
Celui-ci quelque espoir, celui-là tout son deuil.
Le chevalier salue Herblain d’un dernier signe
Et des Ponts, tout rêveur, reprend la longue ligne .
Herblain sur son cheval s’élance sans retard,
Serre à Guéneuf la main, pique des deux et part.
Son vif coursier s’allonge et dévore l’espace ;
Sous son triple galop la distance s’efface ;
Herblain l’excite encore, et son cœur agite
Trouve un soulagement dans sa rapidité.
Mais, songeant tout à coup à l’horrible message
Qu’il apporte et qui fait le but de son voyage,
Il s’arrête, et, n’allant qu’à pas lents désormais,
Il demande au Seigneur de n’arriver jamais.
XII. – UN DOULOUREUX MONOLOGUE.
Le voyage se fait lentement, mais s’achève.
Tout entier absorbé dans son horrible rêve,
Le loyal écuyer lui-même ne sait pas
Tous les sentiers suivis par son cheval au pas.
Il a dû bien souvent s’écarter de la route,
Car au ciel le soleil est bien haut ; et sans doute
Un voyageur à pied, ne marchant qu’à pas lents,
De Nantes à Clisson aurait mis moins de temps.
Devant Herblain se dresse une tour, que traverse
La voûte noire où pend la grille de la herse.
Il est donc arrivé sous les murs de Clisson.
Hélas ! son but atteint lui donne un long frisson.
L’heure écartant alors toute crainte d’alerte,
Le pont-levis était baissé, la porte ouverte ;
Le cheval entra donc librement, et son trot
Fit retentir le pont du bruit de son sabot.
Quand Herblain, dont le front, lourd de soucis, se baisse,
A passé sous la tour de la muraille épaisse
Dont Olivier le Vieux, ce preux de grand renom,
Fit entourer le bourg dont il portait le nom
Il voit d’un œil surpris la foule qui serpente
Gravir du noir château la tortueuse pente,
Où bruissait gaîment un son confus de voix.
Tous étaient confondus, serfs, artisans, bourgeois ;
Mais sur cinq rangs marchaient, devant, vingt jeunes filles,
L’espérance et l’orgueil des plus riches familles.
En longs habits de fête, aux riantes couleurs,
Chacune a dans ses bras sa corbeille de fleurs.
Vingt jeunes gens, portant des rameaux de verdure,
A ce groupe charmant forment une bordure.
Ces fidèles vassaux ont su que, dans Paris,
Clisson s’est du tournoi vu décerner le prix :
Tous réclament leur part de sa gloire nouvelle,
Et, pour qu’en plein soleil leur amour se révèle,
Avec leur châtelaine ils vont, d’un pas joyeux,
Fêter le jour natal du maître glorieux.
L’air retentit de cris où le bonheur éclate.
Herblain, à qui son cœur a rappelé la date,
Étouffe un long soupir et, terrifié, sent
Se dresser ses cheveux et se glacer son sang.
La nouvelle qu’il porte et dont le coup foudroie
Va tomber au milieu de ces transports de joie.
De son message affreux jamais, jamais son cœur
N’avait comme à présent compris toute l’horreur.
Ah! depuis Montfaucon jusqu’à Nantes, sans doute
Son unique penser sur cette longue route,
C’était le désespoir où l’atroce récit
Allait bientôt plonger les êtres qu’il chérit ;
Mais, pour leur adoucir le coup et sa blessure,
Il avait cru trouver une recette sûre.
Or, ces ménagements, avec soin préparés
Et qui leur partageaient la douleur par degrés,
Comment y recourir devant tant d’allégresse ?
Encor, si l’on avait du temps !…
Non, l’aveu presse : Un vassal de Clisson à Nantes pourra voir
Sa tête ; et son récit, circulant, dès ce soir,
De la ville au château, du château dans la ville,
En plein cœur frappera Jeanne de Belleville.
Ah ! ce n’est pas cela qu’aux prisons de Paris,
Le fidèle écuyer à son maître a promis ;
C’est lui qui doit porter le premier la nouvelle…
Il fera son devoir, puisqu’il se le rappelle ;
Mais l’acte qu’il promet à sa fidélité,
N’est-il pas déloyal et plein de lâcheté ?
Quoi! c’est quand du bonheur Jeanne a gravi la cime
Et lève au ciel ses yeux oublieux de l’abîme,
Qu’il va, lui, comme un traître en silence approchant,
La lancer sans pitié dans le gouffre béant !
Entre ses deux devoirs, dont chacun le déchire,
L’âme du vieil Herblain est en proie au délire :
Du rôle affreux qu’il vient remplir avec terreur,
Sa pensée exaltée accroît encor l’horreur.
Tout se présente à lui sous un aspect sinistre :
Il lui semble qu’il est des bourreaux le ministre
Et va faire subir à Jeanne, devant tous,
La dégradation que subit son époux…
— « Mon Dieu, pardonnez-moi mon atroce franchise !
Ma maîtresse adorée, il faut que je lui dise :
L’époux que votre cœur attendait, il est mort.
Philippe, roi de France, et le bourreau, d’accord,
N’en ont fait qu’un cadavre, à la place des Halles..
De l’enfeu paternel ne levez pas les dalles :
Ce cadavre à vos mains ne sera pas rendu.
Le corps est au gibet de Montfaucon pendu,
Et sa téte, aux créneaux de Nantes exposée,
N’est pour ses ennemis qu’un objet de risée.
» Vous songez à vos fils, et leur bras généreux
Doit rendre son éclat au nom de leurs aïeux?
Cet espoir n’est chez vous que folie ou faiblesse ;
Car votre époux est mort dégradé de noblesse,
Et, ses juges étant de loyaux chevaliers,
Vos deux fils ne sont plus que de vils roturiers…
» A défaut des honneurs, vous gardez la puissance,
Votre or et vos châteaux ? Chassez cette espérance :
Vos châteaux et votre or, le Roi vous les a pris
Et va les partager entre ses favoris ;
Car votre époux est mort traître au Roi : la loi juste
A confisqué vos biens pour ce monarque auguste…
» Vos vassaux dévoués ne le souffriront pas ?
Comme aujourd’hui leurs fleurs, ils offriront leurs bras ?
De leur zèle pour vous, comme de leur courage,
Leurs acclamations sont aujourd’hui le gage ?
Oh ! renoncez encore à ce dernier espoir :
Vous les verrez soumis, et tel est leur devoir,
Aux nouveaux possesseurs de votre baronnie ;
Car votre époux est mort taché de félonie,
Et, puisqu’il a foulé ses serments sous ses pieds,
Ses vassaux sont, de droit, envers lui déliés.
» Ne conservez donc plus d’espoir d’aucune sorte :
La maison de Clisson est complétement morte,
Et, pour me résumer en trois mots, sachez bien
Qu’époux, richesse, honneur, vous n’avez plus rien, rien !
Pendant qu’il soulageait sa pauvre âme insensée
Dans ce discours grondant au fond de sa pensée,
Herblain avait suivi, jusqu’au haut du coteau,
La foule, qui montait lentement au château.
A ses bouquets de fête ouvrant la citadelle,
Le pont-levis s’était abaissé devant elle,
Et déjà les échos des tours et du donjon
Répétaient ses vivat en l’honneur de Clisson.
Appelant un valet, Herblain, qui saute à terre,
Lui laisse son cheval tout couvert de poussière,
Et, par le haut arceau, qu’il franchit à son tour,
Va se mêler au peuple assemblé dans la cour.
Sa première pensée est que de sa venue
La châtelaine soit à l’instant prévenue ;
Mais la voyant entrer dans cette cour d’honneur,
Le front tout rayonnant d’espoir et de bonheur,
Sa résolution, qu’il croyait ferme, ploie
Et n’ose pas briser un cœur si plein de joie.
Remettant à plus tard ses récits effrayants,
Il s’enfonce muet dans les groupes bruyants
Et, de son chaperon se voilant le visage,
Laisse se reformer dans son cœur son courage.
XIII. – COMPLIMENTS ET BOUQUETS.
Écoutant leur respect autant que leur amour,
Les bons vassaux, rangés en cercle dans la cour,
Laissent un large vide entre eux et leur maîtresse.
S’avançant lentement, le front plein de noblesse,
Jeanne sur un fauteuil, qu’apporte un grand varlet,
S’assied majestueuse, ainsi que pour un plaid.
Ses Ailles sont près d’elle avec leurs gouvernantes ;
Derrière son fauteuil se groupent ses suivantes,
Variant d’âge, mais rivalisant d’atours ;
Puis quelques officiers en cottes de velours.
La joie et la bonté brillent sur ses traits calmes.
Les vingt jeunes garçons aux verdoyantes palmes,
S’alignent sur deux rangs, et le chef des bourgeois
S’avance alors vers Jeanne et lit à haute voix
Un long discours en vers, où , dans sa courtoisie,
Il semait à deux mains les fleurs de poésie,
Pour vanter de Clisson les exploits merveilleux.
— « Un trône l’attendait parmi les demi-dieux ;
Mais, avant qu’il montât aux célestes demeures,
On devait voir longtemps le chœur joyeux des Heures
Applaudir chaque jour à ses nobles travaux ;
Car Jupiter, cédant aux vœux de ses vassaux,
Et rognant au besoin leurs propres destinées,
Accordait à Clisson tout juste autant d’années
Que Jeanne offrait aux yeux de vertus et d’attraits :
La Mort désespérée avait brisé ses traits.
» Comme ils doivent bénir leur douce châtelaine
De leur garder ainsi, de grâce toute pleine,
Le héros glorieux, l’invincible lion,
Qui daigne les couvrir de sa protection.
Ils voudraient sur son front, et parmi ses longs voiles,
Poser un diadème étincelant d’étoiles,
Ou, si quelque dragon leur livrait son trésor,
Enchâsser pour ses mains les diamants dans l’or ;
Mais le sort les condamne aux offrandes modestes :
Puisse Jeanne accepter, riche des dons célestes,
A défaut de présents plus chers, mais non meilleurs,
Les fleurs de leurs jardins et les vœux de leurs cœurs ! »
Quand il eut achevé de lire ce chef-d’œuvre,
Qui de quelque trouvère était sans doute l’œuvre,
Lui cherchant dans son cœur une péroraison,
L’honnête et bon bourgeois cria : « Vive Clisson ! »
Ce cri trouve un écho dans toutes les poitrines :
Les soldats sur les tours et le long des courtines,
Et le peuple assemblé par groupes dans la cour,
Tous confondent leur voix dans un élan d’amour.
Les cris « Vive Clisson ! » et « Vive Belleville ! »
Roulent… et sont au loin répétés dans la ville ;
Mais ces cris triomphants ont éveillé soudain,
Et dans le château même, un écho plus prochain.
C’est le jeune Olivier et sa joyeuse bande ;
Rangeant derrière lui les enfants qu’il commande :
– « Crions : Vive Clisson ! et crions-le trois fois. »
Quand tous eurent crié, dociles à sa voix,
Imitant de son mieux l’air guerrier de son père,
Il marche d’un pas ferme au fauteuil de sa mère :
— « D’une offense je viens vous demander raison.
Vrai Dieu ! ne suis-je plus l’aîné de la maison ?
Est-ce donc là le cas que d’un Clisson vous faites ?
On donne en ce château les plus brillantes fêtes,
Et des fêtes qu’on donne on me tient à l’écart !
Oh ! dites-moi, du moins, que ce n’est qu’un hasard. »
Et, lui sautant au cou, d’un geste plein de grâce,
Vingt fois sur chaque joue, en riant, il l’embrasse.
— « En entendant là-bas les cris de cette cour,
J’ai cru qu’ici d’Herblain vous fêtiez le retour.
Est-il donc arrivé, Madame, et de mon père
M’apporte-t-il enfin les récits que j’espère ? »
« Pas encor, mon enfant, mais il ne peut tarder ;
Toute promesse faite, Herblain sait la garder…
Ce sont nos bons vassaux que leur amour rassemble
Et qui, le cœur heureux de nous fêter ensemble,
Mon noble époux et moi, m’apportent aujourd’hui,
Pour moi de fraîches fleurs, des vœux ardents pour lui.
Mais laissez, mon enfant, continuer la fête. »
Et, de ses blanches mains pressant la blonde tête,
Jeanne place son fils entre ses deux genoux
Et fait pleuvoir sur lui ses regards les plus doux.
Ému de ce tableau, qu’un gai soleil éclaire,
Tout le peuple applaudit et le fils et la mère.
Les amis d’Olivier, que gonfle un peu d’orgueil,
Sont allés se ranger derrière le fauteuil,
Tout heureux de toucher de près la grande dame.
La fête alors reprend et poursuit son programme.
Les vingt jeunes garçons, élevant leurs rameaux,
Les croisent devant eux et forment des arceaux
Rappelant vaguement la voûte des charmilles.
Sous cet arc triomphal, les blanches jeunes filles,
S’avançant deux par deux, en inclinant le front,
Vont offrir leur bouquet et leur salut profond ;
Et chacune reçoit, rougissante et vermeille,
Un long et doux baiser pour prix de sa corbeille ;
Puis leur chaîne charmante, en passant, au retour,
Derrière les garçons les encadre à son tour.
Voici leur joli groupe à sa première place ;
Près de Jeanne, là-bas, leurs bouquets leur font face :
Et l’on ne sait vraiment, jeunes filles ou fleurs,
Ce qui réjouit l’œil de plus fraîches couleurs.
Jeanne se lève et dit, versant de douces larmes :
— « Pour moi cette journée a d’ineffables charmes ;
Mon âme en gardera l’éternel souvenir.
Clisson, mon noble époux, va bientôt revenir :
Quand ma voix lui fera le récit de ces fêtes,
Qu’il connaîtra les vœux qu’ici pour lui vous faites,
La part que vous prenez à ses succès nouveaux,
Ce grand cœur sera fier d’avoir de tels vassaux
Et leur bonheur sera le souci de sa vie.
» En son nom comme au mien, amis, je vous convie
A célébrer ici dans un festin le jour,
Le jour tant désiré qui doit voir son retour.
Oui, mais en attendant que ce beau jour se lève,
Qu’au moins cette journée en plein bonheur s’achève :
Donnez un libre cours à vos secrets désirs
Et que chacun pour tous invente des plaisirs.
Que sous ce beau soleil la gaîté se déploie
Et que pendant la nuit brillent nos feux de joie.
N’ayez pas peur du prix que coûte le bonheur :
Tous mes trésors vous sont ouverts comme mon cœur.
C’est mon amour qui crie à tous ici : Largesse !
» Faites donc éclater vos transports d’allégresse,
Et puisse un voyageur, de nos grandeurs surpris,
Redire sur sa route, et surtout à Paris :
Les jaloux de Clisson sont atteints de démence,
S’ils osent contre lui rêver même une offense ;
Il peut braver en paix leur souffle envenimé,
Car Clisson est puissant, autant qu’il est aimé. »
Et Jeanne se mêlant à la foule enivrée,
Lui semble à son bonheur tout entière livrée ;
Mais ses discours ont beau ne parler que d’espoir,
Moi je sais qu’elle a peur et regarde un point noir.
Le long retard d’Herblain et sa lettre ambiguë
Ont glissé dans son cœur comme une épine aiguë ;
Ses doutes ne vont pas jusqu à l’épouvanter,
Mais la vive alouette a cessé de chanter.
XIV. – HERBLAIN ET JEANNE.
En n’entendant parler que de jeux et de fêtes,
Herblain sentait grandir ses angoisses secrètes :
Il s’indignait de voir éclater sans remord
Tant de joie et de bruit dans la maison d’un mort.
Il a voulu vingt fois s’élancer, sombre et pâle,
Sur la foule qui rit comme dans une halle ;
Il a voulu vingt fois chasser tous ces hurleurs
Qui par leurs sots vivat outragent ses douleurs ;
Il a voulu vingt fois crier à cette veuve
Qui de tous les plaisirs provoque ici l’épreuve :
« Madame, faites donc finir ces fols ébats,
Car ce jour est le jour des sanglots et des glas…
Non, pas de glas ! Clisson n’a pas de sépulture :
Les corbeaux de Paris en font large pâture. »
Pour ne pas succomber à sa brutalité,
Le vieillard se cramponne à sa fidélité.
Cette femme, après tout, c’est de Clisson la femme,
La mère de ses fils et de ces lieux la dame :
De quel droit, lui vassal, irait-il l’outrager ?
Elle peut le chasser comme un simple étranger…
Et d’ailleurs, ô Dieu juste, est-elle donc coupable
De ne connaître pas le destin qui l’accable ?
Son bonheur qu’il maudit dans son emportement,
N’est que de son amour l’épanouissement.
Eux-mêmes, ces vassaux, ces soldats, dont l’ivresse
Jette à tous les échos sa bruyante allégresse,
Leur folie est témoin de leur fidélité :
Tout pleurerait ici, sachant la vérité.
N’importe ! cette joie est aussi par trop dure
Et voilà trop longtemps que le contraste dure.
C’est le moins que Clisson, qui n’a pas de tombeau,
Obtienne enfin des pleurs dans son propre château.
D’un courroux mal éteint sentant gronder la flamme,
Herblain du mieux qu’il peut la comprime en son âme
Et s’esquive, à travers les groupes de bourgeois
Organisant les jeux et disputant du choix.
Dans la dernière cour il trouve un jeune page
Et le charge d’aller, grave et secret message !
Prévenir sans retard la dame de Clisson
Qu’un étranger l’attend, mais sans suite, au donjon.
De Jeanne, à ce rapport, l’effroi secret redouble ;
Mais aux yeux de son fils dissimulant son trouble :
— « Pendant que pour la fête on dispose ces lieux,
Dans le parc, mon enfant, va reprendre tes jeux,
Et dès qu’Herblain viendra nous t’en ferons instruire.
— « Ma mère, j’y consens, et sans peine, à vrai dire,
Car vos bourgeois n’ont rien de bien récréatif. »
Et le jeune Olivier, toujours gai, toujours vif,
Emmenant après lui sa turbulente armée,
Fait bientôt retentir ses cris sous la ramée.
Jeanne, le front serein, mais le cœur soucieux,
Adresse à ses vassaux un adieu gracieux,
Puis, sous quelque prétexte, écartant toute suite,
Gagne enfin le donjon. — Comme son sein palpite !
Dans la rapide nuit de son anxiété,
A vingt doutes poignants son esprit s’est heurté :
— « Quel est cet étranger qu’entoure le mystère ?
Il n’a pas dit son nom. Pourquoi veut-il le taire ?
D’où vient-il ? Dans quel but ce secret entretien ?
Apporte-t-il le mal ? apporte-il le bien ?
Non, le malheur ici malgré lui se révèle :
On ne cache pas tant une heureuse nouvelle…
Quel est donc ce malheur inconnu , mais certain ?
Menace-t-il Clisson ou frappe-t-il Herblain?
Herblain est en retard, mais d’une heure, et sa lettre
Ne datait que d’un jour quand il l’a fait remettre :
Non, ce n’est pas Herblain pour qui vient l’étranger.
C’est sur un front plus haut que plane le danger :
Il s’agit de Clisson… J’avais raison!… L’envie
Menace son honneur et peut-être sa vie… »
Et Jeanne gravissait à grands pas l’escalier.
Elle aperçoit Herblain debout sur le palier,
D’où l’étroite fenêtre à peine écartait l’ombre.
Il appuyait son bras et son front au mur sombre ;
Mais à son large dos, mais à son grand front nu,
Sans hésitation Jeanne l’a reconnu,
Et dans un cri perçant tout son bonheur déborde :
— « Oh! sois béni, mon Dieu, de ta miséricorde !
Soyez béni vous-même, Herblain, d’être venu !
Mais pourquoi donc vouloir jouer à l’inconnu ?…
Oh! s’il savait la peur atroce qu’il m’a faite !
Mais je ne me plains pas. tout mon cœur est en fête.
Vous êtes du bonheur l’éternel messager :
Je sais qu’Herblain ici, Clisson est sans danger. »
Herblain sent sous les pleurs son pauvre cœur se fondre
Et, faisant un effort, il cherche à lui répondre ;
Mais Jeanne l’arrêtant d’un signe de la main :
— « J’aime à lire ma joie aux yeux du vieil Herblain.
Pour que je goûte mieux le bonheur qu’il m’apporte,
Qu’il nous laisse le temps de franchir cette porte. »
Bientôt la porte s’ouvre et se ferme sur eux ;
Un jour éblouissant les entoure tous deux :
Aux quatre coins du ciel une fenêtre ouverte
Laisse au loin l’œil plonger sur la campagne verte.
— « Herblain, vous m’avez fait longtemps attendre ici,
Mais soyez pardonné puisqu’enfin vous voici…
Mais, grand Dieu ! qu’avez-vous ? votre poitrine râle !
Vous êtes tout en pleurs et vous êtes tout pâle !
Avez-vous donc souffert d’un malheur imprévu ?
Sur cet obscur palier, oh ! je n’avais pas vu
Se coller à vos os vos pauvres chairs fanées.
En deux mois vous avez vieilli de dix années ! »
Herblain pleurait toujours et demeurait sans voix :
La honte et la douleur l’accablent à la fois :
Aussi cruel qu’ingrat, cette douce maîtresse,
Dont l’âme à ses chagrins à ce point s’intéresse
Que d’un époux absent elle en perd le souci,
Il va broyer son cœur pour prix de sa merci.
XV. – LE RÉCIT D’HERBLAIN.
Songeant à son serment, songeant à sa vengeance,
Craignant les indiscrets et l’heure qui s’avance :
— « O Madame, dit-il enfin avec effort,
Qu’importe d’un vassal le misérable sort ?
Gardez votre pitié pour quelque autre infortune…
Il en est de plus grande… et j’en connais plus d’une. »
—« Herblain, vous m’effrayez, mais ce n’est plus pour vous.
Répondez sans retard : comment va mon époux ? »
— « Dieu dispose à son gré des choses et des hommes :
Il nous brise à son heure… et tous tant que nous sommes.
Le faible et le puissant sont au même niveau
Devant la maladie et devant le tombeau. »
— « Oh ! Clisson est malade ! Oui, la chose est trop sûre…
A-t-il dans le tournoi reçu quelque blessure ?
Partons ! Mais que Paris va donc me sembler loin »
— « De vos soins ni des miens Clisson n’a plus besoin. »
Jeanne s’appuie au mur et devient toute pâle ;
Son haleine n’est plus un souffle, mais un râle.
« Malheur ! malheur sur nous, ô mes pauvres enfants !
Celui qui nous serrait dans ses bras triomphants,
Il est mort!… Il est mort ! Vous n’avez plus de père !…
Parle donc ! ton silence, Herblain, me désespère.
Mon bien-aimé Clisson, ne te verrai-je plus ?…
Mes vœux pour le sauver sont-ils donc superflus ? »
— « Oh ! Madame, songez que vous êtes chrétienne…
Et demandez à Dieu que son bras vous soutienne ;
Car,… il n’est que trop vrai,… vous n’avez. plus d’époux,
Et sur vous Dieu suspend de plus horribles coups :
La maison de Clisson tout entière s’écroule. »
Jeanne sur le plancher est tombée, et se roule,
Et de ses doigts crispés déchire ses cheveux :
— « Pas de ménagements! Dis-moi tout ; je le veux »
— « Ah ! maudit soit le jour où dans le roi de France
Je vous fis partager ma folle confiance !
Quand Dieu dans votre esprit éveillait le soupçon,
C’est qu’alors Dieu voulait nous conserver Clisson.
Votre amour vous donnait une seconde vue,
Et notre destinée, ah ! vous l’aviez prévue.
» Quand vous m’avez parlé, Madame, il était temps
D’écraser sous nos pieds ce groupe de serpents ;
Mais ils l’ont enlacé de leurs nœuds, et leur bave
Souille à jamais le nom de ce baron, si brave,…
Si bon. et si loyal,… qu’on admirait partout. »
— « Pas de phrases, Herblain ! Dis-moi tout, dis-moi tout. »
— « Je vous fais bien souffrir, mais je n’en suis pas cause :
Mon récit, c’est Clisson mourant qui me l’impose.
Il devinait qu’ici l’on voudrait tout savoir,
Et, pour tout raconter, il m’a fallu. tout voir. »
— « Pauvre ami! cher époux ! il m’avait bien comprise.
Ce qu’ont vu tes regards, que ta langue le dise,
Herblain,. car, tu le vois, je suis forte à présent :
Obéis donc sans crainte au cher agonisant. »
— « Ce que j’ai vu, Madame, est tellement horrible.
Que je ne puis le dire ; oh ! non, c’est impossible !… »
— « Je le veux. »— « Non, Madame, oh ! pas dans ce moment !
Vous mourriez. Plus tard je tiendrai mon serment. »
— « Ah ! que tu comprends mal tous lesmaux que j’endure !
Tous ces ménagements prolongent ma torture…
Oui, cher Clisson, mon cœur, du début jusqu’au bout,
Veut dans ta passion t’accompagner partout. »
Jeanne, à demi-couchée au milieu de la chambre,
Folle de désespoir, se tordait chaque membre,
En levant vers Herblain un regard suppliant.
— « Eh bien, écoutez donc ce récit effrayant.
J’abrège les détails, mais je jure, Madame,
De vous les dire un jour, ou Dieu damne mon âme. »
Herblain relève Jeanne et la force à s’asseoir ;
Puis, domptant comme il peut son propre désespoir,
Lui conte la prison, les affronts, l’agonie
Et la mort de l’époux qui, mourant, l’a bénie.
Son âme délicate a beau choisir les mots,
Tous ces détails pour lui sont autant de sanglots.
Jeanne, que sa douleur comme un poison enivre,
Sur le chemin sanglant se complaît à le suivre :
Jeanne lui crie : « Encor ! » s’il suspend son récit,
Et quand il le reprend, Jeanne lui dit : « Merci ! »
Mais cette femme faible en vain fait la Romaine :
Tant d’effroi ne tient pas au fond d’une âme humaine,
Ou son explosion doit la faire éclater.
Herblain, qui continue à tout lui raconter,
Lui montre de Clisson, sous des couleurs poignantes,
Le corps à Montfaucon, la tête aux murs de Nantes ;
A ce dernier détail, Jeanne pousse un grand cri,
Et sur le dur plancher tombe son corps meurtri.
Herblain bondit vers elle et sur son corps se penche :
Vains secours ! C’est la mort, car elle est froide et blanche.
La bouche et les yeux sont ouverts!… Oh! c’est trop tard,
Car la bouche est sans souffle et les yeux sans regard,
Mon Dieu ! que peut-il faire ? Appeler ? Il ne l’ose :
Il faudrait expliquer de cette mort la cause.
Attendre ? Mais, s’il reste encor quelque chaleur,
Le moindre retard peut compléter le malheur.
Pendant qu’il se meurtrit la poitrine et la tête,
Herblain entend monter vers lui des chants de fête,
Et dans le bois, là-bas, retentissent les cris
Du joyeux Olivier et de ses vingt amis.
Au rayon du soleil qui sur son front se joue,
Jeanne reprend ses sens ; le sang monte à sa joue ;
Un souffle semble avoir soulevé son beau sein.
Herblain espère. Hélas ! s’il espérait en vain !
Car cette teinte rosej elle est bien pâle encore :
C’est la faible lueur qui précède l’aurore ;
Herblain a vu souvent ces lueurs s’effacer
Et des nuages noirs venir les remplacer.
Ah ! ce semblant de vie est peut-être un vain leurre ?
Jeanne a rejoint au ciel l’époux que son cœur pleure.
XVI. – LE DÉFI.
Non, non, Dieu soit béni ! ce n’était pas la mort :
Jeanne devient moins froide et respire plus fort ;
Son œil a retrouvé son rayonnement d’ange.
Oh ! que le cœur de l’homme est un mystère étrange !
Malgré le désespoir qui l’écrase aujourd’hui,
Dans l’âme du vieillard un vrai bonheur a lui.
Quand sous les mers du Sud quelque sourd volcan gronde,
On voit parfois surgir des bouillons de leur onde
Un îlot enchanté, bientôt couvert de fleurs.
Jeanne vit !… Oui ! sa joue a toutes ses couleurs,
Et son beau corps raidi se détend et s’allonge.
Mais elle garde encor l’apparence du songe.
Bientôt se soulevant et se frottant les yeux :
« Où suis-je donc ? dit-elle , et quels rêves affreux !
C’est vous, Herblain; merci ! car j’aime à vous entendre.
Parlez-moi de l’époux qui se fait tant attendre. »
Herblain ne répond pas, mais éclate en sanglots :
Toute la vérité reparaît à ces mots.
Jeanne a bondi soudain sur ses pieds, et s’élance
Vers Herblain, en criant : « Oh ! vengeance ! vengeance !
Je n’ai rien oublié de ce qu’Herblain m’a dit…
Philippe, roi de France, ô lâche, sois maudit !
Les calculs d’un tyran ne sont pas sans mécompte :
Ah ! tu m’as abreuvée et de sang et de honte !
Ah ! ta hache a frappé sans pitié mon époux !
Ah ! tu flétris mes fils ! Eh bien donc, coups pour coups!
» La cruauté n’est pas chose si difficile ;
D’ailleurs, à ton école on y devient habile.
Je saurai comme toi verser des flots de sang,
Car la lutte est ouverte entre nous, roi puissant,
Et tu seras, cruel ! vaincu par une femme :
Je porterai partout et la mort et la flamme…
Et ne m’accuse pas ! Je fais ce que tu fis,
Heureuse de venger mon époux et mes fils. »
En soulageant ainsi sa pauvre âme ulcérée,
Jeanne marche à grands pas, de folie enfiévrée ;
De ses yeux, autrefois si calmes et si doux,
Partent de longs éclairs tout chargés de courroux ;
Sur sa lèvre blanchit parfois comme une écume.
Prenez garde au volcan, car la menace y fume !
En voyant ces regards plus ardents qu’un tison,
Herblain plaint sa maîtresse et craint pour sa raison.
Lui qui voulait naguère enflammer sa vengeance,
Il a peur et voudrait calmer sa violence :
— « Oh ! Madame, dit-il, montrez un cœur clément :
Clisson a pardonné dans son dernier moment. »
— « Tant mieux ! sa palme au ciel n’en est que plus certaine,
Mais mon devoir, à moi sa femme, c’est la haine…
Je n’ai pas de remords, car j’obéis à Dieu.
Violer tous les droits, oh ! ce n’est pas un jeu,
Et ce grand crime, il faut que mon bras le punisse :
Le Roi dira : Vengeance ! et Dieu dira : Justice ! »
Jeanne continuait de marcher à grands pas ;
Soudain, elle s’arrête et, d’un ton calme et bas :
— « Tu ne reconnais plus, pauvre Herblain, ta maîtresse,
Et ta douce baronne est changée en tigresse :
Nos états divers font nos devoirs différents
Et la mort de Clisson m’en laisse de bien grands.
Je les remplirai tous. Ma mission commence.
» Fuis-moi, si tu me crois atteinte de démence,
Fuis-moi, si la justice est pour toi cruauté ;
Mais si, gardant au cœur ta vieille loyauté,
Tu m’honores autant, vieil Herblain, que je t’aime,
Jure de m’obéir toujours, partout, quand même,
Sans jamais discuter mon ordre, quel qu’il soit.
J’ai besoin d’un appui : tu seras mon bras droit. »
Herblain plie aussitôt un genou devant elle :
— « Autant qu’à votre époux je vous serai fidèle.
Clisson me trouvera toujours reconnaissant :
Vous pouvez disposer, Madame, de mon sang. »
— « J’y comptais, mais merci !… Descendez donc et faites,
Au château comme en ville, organiser nos fêtes…
Oui, je veux des plaisirs, malgré votre récit :
J’ai de graves raisons pour en agir ainsi.
Tâchez jusqu’à demain qu’ici rien ne révèle,
Pas même à mes enfants, l’effroyable nouvelle.
Qu’au loin de nos chansons l’écho porte le bruit,
Et que nos feux de joie illuminent la nuit ;
Puis quand la nuit fuira l’aurore qui la chasse,
Nous tenterons peut-être une joyeuse chasse :
Il faut bien dissiper ses fâcheuses humeurs…
» Mais tiens un canot prêt avec trois bons rameurs. »
— « Madame, vous voyez que je vous ai comprise :
Mon visage est riant, quoique mon cœur se brise. »
A peine Herblain sorti, Jeanne fait sans retard
Tous les préparatifs de son prochain départ.
Conquérant sur son cœur un effrayant empire,
Elle force ses yeux et sa bouche à sourire ;
Mais on peut deviner ses horribles soucis,
En voyant par moments se froncer ses sourcils.
Un grand mont abritait un lac pur et limpide ;
L’ouragan n’y pouvait creuser même une ride ;
Les grâces du matin et les splendeurs du soir
Aimaient à regarder dans son calme miroir…
D’une convulsion la terre est ébranlée :
Le mont déraciné roule dans la vallée.
Vous plaignez le grand mont, brisé, broyé, perdu ;
Plaignez surtout le lac qui n’est plus défendu !
Les vents, de tous côtés bouleversant son onde,
Le font aussi cruel qu’une mer plus profonde,
Et vous pourrez le voir, envahissant son bord,
Y porter trop souvent la ruine et la mort.
Ayant tout préparé pour l’entreprise ardue,
Avec son jeune fils Jeanne était descendue ;
Herblain à sa maîtresse avait dit en secret
Que pour tous ses desseins tout se trouverait prêt ;
Quand soudain dans la cour, où la fête commence,
On voit, ivre de joie, Olivier qui s’avance,
En triomphe porté par ses jeunes amis.
Les airs en son honneur retentissent de cris :
— « Oh ! je me suis montré digne fils de mon père ;
Le vainqueur du tournoi vous salue, ô ma mère. »
Jeanne embrasse son fils et dit aux vingt bambins :
— « Continuez ici vos plaisirs enfantins.
Pour toi, par ta valeur, Olivier, tu m’enchantes
Et je t’en dois le prix. Nous partons tous pour Nantes.
Il n’est pas de plaisir plus justeent vanté
Que de voguer.^ur l’eau par un oeau soir d’été. »